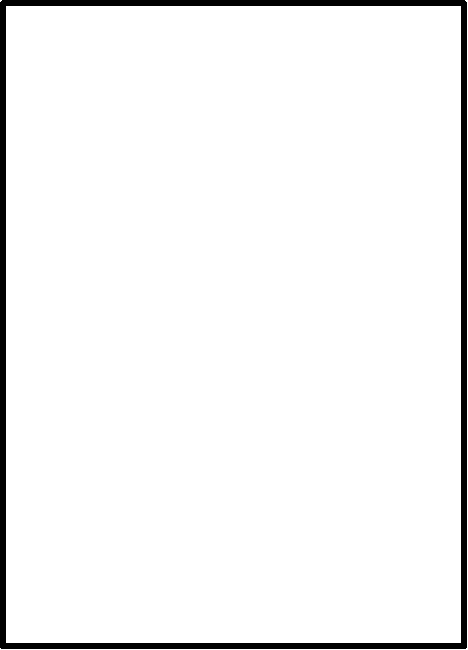
Université Jean MOULIN Lyon III 1996-1997
Faculté des Lettres et Civilisations
Maîtrise de Lettres Modernes
UN PERSONNAGE INSAISISSABLE :
DANS LA REINE MORTE
DE MONTHERLANT.
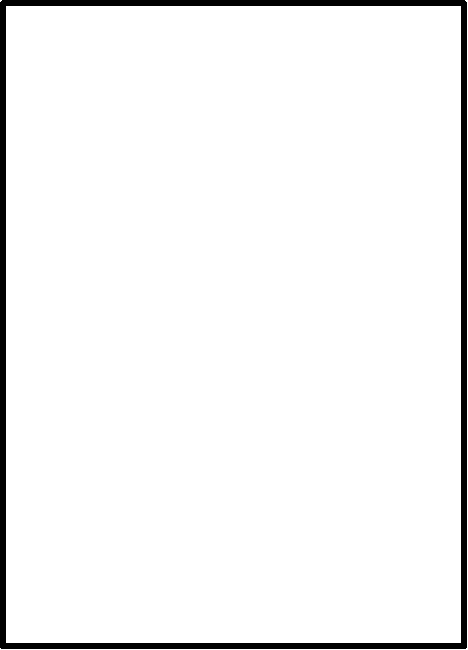
mémoire dirigé par Monsieur Guy LAVOREL
Magali PERRIOL
INTRODUCTION
En 1949, à la question posée par l'hebdomadaire Carrefour « Quel écrivain français vivant sera le plus lu en l'an 2000 ? », Henry de Montherlant arrivait en tête des réponses données. En 1995, Lancrey-Javal estime que sa pièce La Reine morte « mérite de retrouver le public scolaire, mais aussi le public théâtral qu'elle a perdus. »1.
La Reine morte, écrite en 1942, peut être considérée comme la première pièce de théâtre de Montherlant : il faut excepter L'exil, écrite dans sa jeunesse, en 1914, et publiée seulement en 1928, et deux pièces qu'il n'a jamais finies, Les Crétois en 1928 (dont il est resté Le chant de Minos, dans Encore un instant de bonheur, 1934, et le « poème dramatique » Pasiphaé, 1936), et Don Fadrique (dont il reste des fragments dans Pour une vierge noire, 1930, et Service inutile, 1935.).
Elle sera suivie de onze autres pièces (pour seulement trois romans), classées par Montherlant en fonction du cadre et de l'intrigue : certaines pièces nourrissent une « veine profane », les autres une « veine chrétienne » ; celles dont l'action est contemporaine sont dites pièces « en veston », et celles dont l'action se situe dans le passé (Moyen - Âge, Renaissance, Âge classique mais aussi Antiquité) sont dites « en pourpoint ». C'est cette dernière catégorie qu'ouvre donc La Reine morte.
Pour Bordonove, La Reine morte est une « tragédie de l'ambivalence »2 ; selon Montherlant, elle est celle « de l'homme absent de lui-même »3... Au regard de son personnage principal, le Roi du Portugal Ferrante, on peut s'interroger sur la pièce comme sur tout son théâtre : se demander qui est Ferrante, c'est se demander comment caractériser la production théâtrale de Montherlant ; s'agit-il d'un théâtre de la « cruauté », ou plus, « au sens étymologique du mot [...], un théâtre de la passion » ?4
Le dramaturge lui-même s'est interrogé, dans la postface de La guerre civile (1964) : « Un « théâtre de la faiblesse » ? Le mot serait séduisant. Mais inexact. Un théâtre de la force et de la faiblesse, et c'est cela qui est la vie. »5.
Et Blanc de reprendre : « théâtre ambigu », « se nourrissant à la fois de force et de faiblesse, dont on ne peut vraiment savoir s'il témoigne d'abord de la misère de l'homme ou de sa grandeur. »6.
Le personnage de Ferrante pose ces questions à lui seul, il en concentre tous les aspects ; même, il nous en pose sur Montherlant en personne, car celui-ci prétend à un regard objectif sur la vie et ici sur « le clair-obscur de l'homme »7, et pourtant entremêle ce regard à un regard indéniablement subjectif, voire autospectif... Comme le dit joliment Sipriot : « Montherlant a voulu se comprendre pour comprendre les hommes. Il les a étudiés en lui et aussi regardés avec curiosité. »8.
A toutes ces questions qui n'en font qu'une, comment répondre ? Le personnage insaisissable semble lui-même vainement se chercher. Tous les critiques ont tôt ou tard essayé de cerner Ferrante, et beaucoup Montherlant à travers ce dernier ; peu donnent une réponse catégorique, et aucun n'est totalement d'accord, au moment de conclure, avec un autre ou avec l'auteur lui-même... Mais Robichez a pourtant raison, de souligner que Montherlant peut ne pas avoir toujours « le privilège d'infaillibilité pour autant »9 sur son œuvre en général ou sur l'identité de son personnage.
Au sujet de Ferrante, on voudrait mimer sa complexité et tout dire en même temps, ce qui n'est évidemment pas possible : il faudrait procéder par circonvolutions autour du personnage, en cercles concentriques de plus en plus resserrés pour parvenir à le cerner.
Dès lors, il ne nous est possible de l'approcher que par l'alternance de deux points de vue, l'un « horizontal », plus intérieur à la pièce, et l'autre « vertical » ou plus extérieur. D'abord nous essaierons de définir Ferrante tel qu'il se présente au sein de la pièce, pour constater que son double statut de Roi et de père, il le nie constamment ; devons-nous le croire alors que c'est justement lors de notre quête de son identité « sociale » que nous le voyons montrer ses premières contradictions ?
Nous devrons alors chercher à expliquer la non-coïncidence entre ce que Ferrante semble être et ce que Ferrante dit être... pour déboucher sur une nouvelle dualité, car il n'y a pas non plus coïncidence absolue entre ce que Ferrante veut être et ce que Ferrante pense être : quelle identité « psychologique » lui donner dès lors ?
Force nous sera ainsi de constater que cette dualité, ou plutôt ces dualités, fait - ou font - la dimension tragique du personnage de Ferrante, dont l'identité « théâtrale » oscille entre sublime et pathétique…
Nous aurons alors recours à l'examen de ce que fait Ferrante dans la pièce, pour voir si l'on peut résumer Ferrante à ses actes, dans une optique existentialiste ; mais ce que Ferrante fait est dissocié de ce qu'il est et ne coïncide donc pas, encore une fois.
Enfin, devant le problème de cette identité « existentialiste », nous formulerons l'hypothèse d'une identité « zéro » ou « pathologique », d'une absence d'identité de Ferrante qui ferait sa faiblesse, avant d'aboutir à celle d'une identité possible « au-delà » qui ferait sa force, donc d'une identité « absolue » ou « mystique », pour peut-être accorder au personnage l'unité à laquelle il aspire…
PLAN
INTRODUCTION 1
I. « PERSONNAGE », « PERSONNE », « PERSONNALITÉ »... 7
A. UN « PERSONNAGE » ET UNE « PERSONNE ». 8
IDENTITÉ SOCIALE
(= le personnage démenti par la personne).
1. UN ROI... SANS PUISSANCE ? 8
(apparent renoncement aux valeurs de la politique).
2. UN PÈRE...SANS FILS ? 14
(apparent reniement des valeurs de l'amour).
B. UNE « PERSONNE » ET UNE « PERSONNALITÉ ». 21
IDENTITÉ PSYCHOLOGIQUE
(= la personnalité affirmée par la personne).
1. UNE « THÉORIE » APPLIQUÉE PAR FERRANTE. 22
(dualisme).
2. UNE « THÉORIE » APPLIQUÉE À FERRANTE. 38
(dualité).
II. PERSONNAGE PRINCIPAL DE L'ACTION ET ACTE PRINCIPAL DU PERSONNAGE. 48
A. PERSONNAGE PRINCIPAL DE L'ACTION. 49
IDENTITÉ THÉÂTRALE
(= Ferrante, personnage sublime ou pathétique?).
1. UN HÉROS DE TRAGÉDIE. 49
(statut de héros et univers tragique).
2. UN HÉROS TRAGIQUE. 61
(héros sublime et héros pathétique).
B. ACTE PRINCIPAL DU PERSONNAGE. 75
IDENTITÉ EXISTENTIALISTE
(= ce que fait le personnage est-il ce qu'il est?).
1. IMPORTANCE DE L'ACTE. 76
(question de sa(ses) motivation(s)).
2. IMPORTANCE DES ACTES. 93
(question de leur responsabilité).
III. VERS UNE UNITÉ PAR LE DÉPASSEMENT DE L'UNITÉ ?
102
A. FAIBLESSE ? 103
IDENTITÉ « ZÉRO » OU PATHOLOGIQUE
(= une « crise d'identité »?).
1. DUALITÉ ET CRISE 104 (sa faiblesse, une maladie ; sa maladie, une faiblesse).
2. CRISE ET DÉDOUBLEMENT. 117
(crise de la parole et crise de l’image).
B. FORCE ? 129
IDENTITÉ « ABSOLUE » OU MYSTIQUE
(= une identité possible « au-delà »?).
1. DUALITÉ EFFECTIVE DU PERSONNAGE : DUALITÉ POTENTIELLE DU JUGEMENT. 130
(Ferrante entre condamnation et absolution).
2. SUSPENSION EFFECTIVE DU JUGEMENT : SUSPENSION POTENTIELLE DU PERSONNAGE ? 140
(un statut de « grâce théâtrale »...)
CONCLUSION 151
A la première lecture de la pièce, une chose frappe d'emblée : c'est la difficulté de comprendre le Roi Ferrante, qui ne cesse d'affirmer une chose et son contraire au sujet de lui-même. L'effet provoqué est l'impression d'un décalage constant, en même temps que chaque fois sensiblement différent, entre ce qu'il semble être et ce qu'il est réellement ; aussi avons-nous pris le parti de parler d'un « personnage » et d'une « personne » pour nommer Ferrante, car ce décalage est flagrant du point de vue « social » : il semble renoncer ensemble à la « valeur » sociale du Pouvoir et à celle de la paternité. Mais son apparent renoncement au statut royal et son apparent reniement du statut paternel sont-ils vraiment révélateurs de sa « personne » ?
Ferrante, en tant que Roi du Portugal, est le personnage de Puissance, de toute-puissance de la pièce : l'Infante de Navarre elle-même lui est inférieure. Il incarne la majesté, la dignité, la grandeur absolues, et le langage des protagonistes se fait le révélateur de cette distinction sociale10. Le Roi est celui qui parle dans le « ton royal », et à qui tous s'adressent avec déférence :
« Magnanime Ferrante... » [A. 1, sc. 2, p.24.]
« Grand Roi, notre chef et notre père... » [A. 2, sc. 2, p. 71.]
L'Infante, seule protagoniste susceptible d'égaler « socialement » le Roi, parce qu'elle a « été élevée pour le règne », et qui affirme « Où je suis, il n'y a pas de rang. »11, s'adresse à lui dans la scène d'ouverture de façon élogieuse :
« Je me plains à vous, je me plains à vous, Seigneur ! Je me plains à vous, je me plains à Dieu ! » [A. 1, sc. 1, p. 17.]
Cette quadruple répétition opère un rapprochement entre Ferrante et Dieu, le plaçant trois fois en première place : ce rapprochement souligne à la fois le respect et l'autorité que l'on doit au souverain. Ferrante, lui aussi, opère ce rapprochement pour légitimer son autorité comme absolue :
« Moi, le Roi, me contredire, c'est contredire Dieu. » [A. 1, sc. 3, p. 29.]
Le Roi est le détenteur du Pouvoir absolu, et notamment du pouvoir de décision : c'est une requête qu'adresse violemment l'Infante à Ferrante. Sa plainte ouvre la pièce pour nous révéler la situation initiale, en mettant en valeur l'autorité royale :
« Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre (que Dieu protège !) pour vous y entretenir avec le Roi mon père des affaires de vos royaumes. Vous m'avez vue, vous m'avez parlé, vous avez cru qu'une alliance entre nos couronnes, par l'instrument du Prince votre fils, et de moi, pouvait être faite pour le grand bien de ces couronnes et pour celui de la Chrétienté. Vous deux, les Rois, vous décidez d'un voyage que je ferai au Portugal, accompagnée de l'Infant, mon frère, peu après votre retour. Nous venons [...] » [p.18.]
Un dessein politique est ici clairement résumé, et l'Infante insiste sur la décision royale par le contraste des pronoms personnels « vous » / « nous » qui montre son obéissance à cette autorité.
Ferrante a le pouvoir de décision, le droit de vie et de mort sur tout sujet : c'est ce que souligne son ministre Egas Coelho :
« Si doña Iñès vous disait : « Pourquoi me tuez-vous ? », Votre Majesté pourrait lui répondre : « Pourquoi ne vous tuerais-je pas ? ». » [A. 2, sc. 1, p. 64.]
La première scène du deuxième acte le montre en conseil des Ministres, sous un jour cynique dont on est en droit de penser qu'il est né de l'exercice du pouvoir :
dès le départ, mensonge et manipulation sont de mise pour traiter les affaires politiques :
« De quoi s'agit-il ? D'obtenir. Et se plaindre est un des moyens d'obtenir. La pitié est d'un magnifique rapport. » [A. 2, sc. 5, p. 55.]
« Je répugne au style comminatoire, parce qu'il engage. Je préfère le style doucereux. Il peut envelopper tout autant de détermination solide que le style énergique, et il a l'avantage qu'il est plus facile de s'en dégager. » [p. 57.]
Toute la scène montre complaisamment le Roi et ses conseillers travailler à pouvoir s'échapper des obligations du royaume ; la notion d'aisance dans ce jeu est lancée par don Eduardo, et rectifiée par Ferrante :
« Il faut être dans la mauvaise foi comme un poisson dans l'eau.
- Il ne faut pas être dans la mauvaise foi comme un poisson dans l'eau, mais comme un aigle dans le ciel. » [p. 57.]
L'image royale rehausse la comparaison, et rappelle qu'en des occasions sérieuses comme en ces situations plus détendues, Ferrante est et reste le symbole de la puissance.
Ce statut de Puissance absolue, Ferrante semble en être l'incarnation, il semble coïncider avec cette identité sociale : avec ses ministres mais déjà la première fois qu'il parle, quand l'Infante lui a révélé le refus du Prince de l'épouser, il se définit socialement, et avec la dignité que son statut suppose :
« Si moi, le Roi, je vous dis que je comprends votre mal, et si votre mal n'en est pas adouci, à votre tour vous m'aurez offensé. » [A. 1, sc. 1, p. 19.]
L'apposition, enclavée entre les deux pronoms, insiste sur cette identité ; de même dans la juxtaposition de ces deux phrases :
« [...] il ne faut pas qu'elle me gêne. Un Roi se gêne, mais n'est pas gêné. » [A. 1, sc. 3, p. 28.]
Le problème est que très vite, Ferrante va se désolidariser de cette identité sociale, et faire apparaître son statut royal comme un rôle imposé auquel il ne s'assimile pas : dès la troisième scène, il prononce cette affirmation surprenante :
« Je suis las de mon trône, de ma cour, de mon peuple. » [A. 1, sc. 3, p. 25.]
Nous pourrions penser que l'homme et le Roi sont alors distincts : d'une part le « personnage », le rôle social, et de l'autre l'homme réel, la « personne »... C'est ce que laissent penser certaines remarques, quand il s'adresse à son fils dans cette même scène :
« Je songeais aussi : « À cause des affaires de l’État, il me faut perdre mon enfant ». » [A. 1, sc. 3, pp. 26-7.]
« Vivre partie avec l'Infante, et partie avec Iñès... Vivre déchiré entre une obligation et une affection...
- Je ne vois pas là déchirement, mais partage raisonnable.
- Je n'ai pas tant de facilité que vous à être double. » [p. 30.]
Le dialogue entre Ferrante et son fils tend à montrer cette « double » identité sociale et réelle, publique et privée, comme très nette, évidente.
Le problème est cette lassitude du pouvoir affirmée par Ferrante, parallèlement à un intérêt politique qui va contradictoirement rester constant...
Au rythme ternaire de sa lassitude, « je suis las de mon trône, de ma cour, de mon peuple », vont s'en ajouter d'autres, alternés et successivement opposés :
« Regardez : la route, la carriole avec sa mule, les porteurs d'olives,- c'est moi qui maintiens tout cela. J'ai ma couronne, j'ai ma terre, j'ai ce peuple que Dieu m'a confié, j'ai des centaines et des centaines de milliers de corps et d'âmes. » [A. 1, sc. 5, p. 46.]
« Je suis las de mon royaume. Je suis las de mes justices, et las de mes bienfaits. » [A. 2, sc. 3, p. 77.]
« [...] j'ai mon royaume, j'ai mon peuple, j'ai mes âmes ; j'ai la charge que Dieu m'a confiée et j'ai le contrat que j'ai fait avec mes peuples... » [A. 3, sc. 8, pp. 145-6.]
Cette dernière affirmation, Ferrante la prononce à la fin de la pièce, lors de la dernière scène, après avoir dénoncé sa lassitude du pouvoir...
Apparemment, sa lassitude du pouvoir se double au fil de la pièce d'une lassitude générale, une lassitude qui mêle celle du statut royal et de l'existence, quand il dit à Iñès :
« Et le règne est comme la charité : quand on a commencé, il faut continuer. Mais cela est lourd, quelquefois. [Désignant la fenêtre.] Regardez ce printemps. Comme il est pareil à celui de l'an dernier ! Est-ce qu'il n'y a pas de quoi mourir d'ennui ? [...] Pour moi tout est reprise, refrain, ritournelle. Je passe mes jours à recommencer ce que j'ai fait, et à le recommencer moins bien. Il y a trente-cinq ans que je gouverne : c'est beaucoup trop. Ma fortune a vieilli. Je suis las de mon royaume. Je suis las de mes justices, et las de mes bienfaits ; j'en ai assez de faire plaisir à des indifférents. Cela où j'ai réussi, cela où j'ai échoué, aujourd'hui tout a pour moi le même goût. [...] L'une après l'autre, les choses m'abandonnent. [...] Et bientôt, à l'heure de la mort, le contentement de se dire, songeant à chacune d'elles : « Encore quelque chose que je ne regrette pas. » » [A. 2, sc. 3, pp. 76-7.]
La lassitude sociale mise en valeur par des rythmes binaires ou ternaires semble englober une lassitude plus profonde, celle du roi mais aussi celle de l'homme... N'est-ce pas plus la « personne » qui éprouve la fatigue d'une longue existence ? Qui dit :
« Mais que le pardon est vain ! [...] Et puis, j'ai tant pardonné, tout le long de ma vie ! Il n'y a rien de si usé pour moi, que le pardon. » [A. 1, sc. 3, p. 28.]
« Les remords meurent, comme le reste. Et il y en a dont le souvenir embaume. » [A. 3, sc. 6, p. 124.]
Mais cette apparente absence d'émotion reste essentiellement le fait du Roi. C'est lui qui paraît exprimer un désabusement, alors même qu'il parle d'indifférence, indifférence aux choses dont il affirme qu'il « ne [les] regrette pas » :
« Les parfums qui montent de la mer ont une saveur moins âcre que celle qu'exhale le cœur d'un homme de soixante-dix ans [...]. Je vois tout ce que j'ai fait et défait, moi, le Roi de Portugal, vainqueur des Africains, conquêteur des Indes, effroi des rebelles, Ferrante le Magnanime, pauvre pécheur. Et je vois que de tout ce que j'ai fait et défait, pendant plus d'un quart de siècle, rien ne restera, car tout sera bouleversé, et peut-être très vite, par les mains hasardeuses du temps ; rien ne restera qu'un portrait. [...] Je ne suis pas un roi de gloire, je suis un roi de douleur. » [A. 3, sc. 1, pp. 107-9.]
Ce désabusement, dont on pourrait penser qu'il concerne plus le « cœur d’un homme de 70 ans », se mêle à la conscience de la vanité des choses du « Roi de Portugal, Ferrante le Magnanime »...
On le voit, la distinction entre l'identité sociale et l'identité « réelle » n'est pas si claire. Ferrante est-il sincère dans ses moments royaux de cynisme, ou au contraire dans ses confidences humaines à Iñès ?
Un décalage existe pourtant : cette conscience est douloureuse, puisqu'il se définit comme un « roi de douleur », mais à plusieurs reprises il s'en défend en affirmant son indifférence : a priori, il ne croit plus à ce qu'il fait, la puissance ne l'intéresse plus :
« Quand je vous ai dit : « Il y a mon peuple... », je ne mentais pas, mais je disais des paroles d'habitude, auxquelles j'avais cru un jour, auxquelles je ne croyais plus tout à fait dans l'instant où je les disais. [...] Je me suis lamenté devant vous comme une bête ; j'ai crié comme le vent. Croyez-vous que cela puisse s'accorder avec la foi dans la fonction royale ? Pour faire le roi, il faut une foi, du courage et de la force. Le courage, je l'ai. La force, Dieu me la donne. Mais la foi, ni Dieu ni moi ne peuvent me la donner. [...] je suis crucifié sur moi-même, sur des devoirs qui pour moi n'ont plus de réalité. » [A. 3, sc. 6, pp. 127-8.]
Ferrante nie, alors qu'il se confie à Iñès, son identité sociale : le statut de puissance n'est qu'un rôle qu'il joue mais ne vit pas, il ne s'agit pas de lui, du moins plus de lui, car l'expérience du pouvoir en a usé l'idée. Il semble ne jouer ce rôle que par « habitude », mais sans y accorder d'importance :
« J'ai atteint l'âge de l'indifférence. Pedro, non. Que faire de sa vie, si on ne s'occupe pas de ces sortes de choses ? [...] A mon âge on a perdu le goût de s'occuper des autres. Plus rien aujourd'hui qu'un immense : « Que m'importe ! » que recouvre pour moi le monde... » [pp. 128-9.]
Les critiques, à quelques exceptions près, sont unanimes : par exemple, pour Stéphan, « Ferrante [...] se détermine par son désenchantement. [...] il est rassasié de pouvoir et de gloire et aspiré par le néant. »12. Pour Mohrt, « le roi Ferrante, c'est l'homme arrivé au sommet de sa puissance, fatigué de son pouvoir, excédé des hommes et de lui-même. [...] parvenu au terme de sa vie, il éprouve une immense lassitude et ce détachement, cette indifférence royale qui sont les fleurs extrêmes de la puissance. [...] Il a déjà abdiqué au monde. »13.
Comment expliquer alors sa volonté que Pedro lui succède en épousant l'Infante ? Dès le départ, Ferrante semblait réellement s'intéresser à l’État :
« Seigneur, laissez-moi retourner maintenant dans mon pays. [...]
- Partir ! Tout ce que nous perdrions ! Tout ce que vous perdriez ! » [A. 1, sc. 1, p. 20.]
Cette triple exclamation lors de la scène d'ouverture révèle pourtant bien un goût du pouvoir politique... Le paradoxe de Ferrante est là : constamment il va affirmer, parallèlement à sa lassitude, sa passion politique. Déjà son discours à Pedro le « trahit » :
« Toujours je vous ai vu [...] croire que je faisais par avidité ce que je faisais pour le bien du royaume ; croire que je faisais par ambition personnelle ce que je faisais pour la gloire de Dieu. » [A. 1, sc. 3, p. 27.]
S'il parle ainsi de son comportement passé, son intention présente ne semble guère différer :
« [...] épousez l'Infante, et ne vous interdisez pas de rencontrer Iñès [...]. L'Infante aura le règne, et le règne vaut bien ce petit déplaisir. [...] Vous m'entendez ? Je veux que vous épousiez l'Infante [...]. C'est elle, oui c'est elle qu'il faut à la tête de ce royaume. Et songez à quelle force pour nous : le Portugal, la Navarre et l'Aragon serrant la Castille comme dans un étau ! Oui, je suis passionné pour ce mariage. » [p. 29.]
Il serait simple de penser que Ferrante a réellement renoncé à son « personnage » et qu'il semble « passionné » par habitude, parce que si « le roi et lui n'ont pas toujours été deux, ils le sont devenus du fait de l'âge et de l'approche de la mort »14 ; mais outre l'impression de sincérité de ses exclamations, il est incompréhensible que cette attitude se répète tout au long de la pièce, si sa passion pour la puissance est fausse... Or sa réaction en apprenant le mariage secret d'Iñès et de Pedro semble bien spontanée :
« Ah ! Malheur ! Malheur ! Marié ! Et à une bâtarde ! Outrage insensé et mal irréparable, car jamais le Pape ne cassera ce mariage [...] » [A. 1, sc. 5, p. 47.]
Et, encore à la moitié du dernier acte, on voit Ferrante toujours soucieux de ce mariage politique, puisqu'il prend mal le refus du Pape de l'aider :
« Vous êtes liée à don Pedro, et ce lien ne peut être brisé que par la mort du Pape, et des dispositions différentes de son successeur à mon égard. Oh ! Je suis fatigué de cette situation. Je voudrais qu'elle prît une autre forme. [...] Et je suis fatigué de vous, de votre existence. Fatigué de vous vouloir du bien, fatigué de vouloir vous sauver. » [A. 3, sc. 4, p. 118.]
La triple répétition du participe passé met cette fois l'accent sur la fatigue du roi, et non plus sur l'homme derrière ce roi...
Ferrante se situe-t-il entre les deux, entre le personnage et la personne ? C'est l'opinion de Blanc : « entre l'homme et la fonction, il n'y a plus ni vraie distinction ni coïncidence15.
On pourrait le penser en considérant qu'il a discuté cyniquement avec des conseillers, alors que par ailleurs il s’en méfie :
« La cour est un lieu de ténèbres. [...] Le mensonge est pour mes Grands une seconde nature. De même qu'ils préfèrent obtenir par la menace ce qu'ils pourraient obtenir par la douceur, [...] ils préfèrent obtenir par l'hypocrisie ce qui leur serait acquis tout aussi aisément par la franchise : c'est le génie ordinaire des Cours. » [A. 1, sc. 5, p. 43.]
« Les Africains disent que celui qui a autour de lui beaucoup de serviteurs a autour de lui beaucoup de diables. J'en dirais autant de mes ministres. Ils sont là à vivre de ma vieille force [...]. Des coquins qui m'enterreront ! » [A. 2, sc. 3, p. 75.]
Mais on pourrait le penser plus encore en considérant qu'il fera tuer celle à qui il avouait sa lassitude du pouvoir, justifiant son irritation face à elle par une curieuse pirouette oratoire :
« [...] il vous semble que j'ai dit que je ne croyais pas à l’État. Je l'ai dit, en effet. Mais j'ai dit aussi que je voulais agir comme si j'y croyais. » [A. 3, sc. 6, p. 138.]
Il s'agit pour le moment de s'arrêter à ce constat : celui d'un être de contradictions, agissant comme un Roi ivre de puissance puis comme un homme las et désabusé, qu'il semble impossible d'identifier par son seul statut social. Nous reviendrons abondamment sur ses contradictions, sur leurs conséquences effectives et leurs causes potentielles. En ce qui concerne son autre statut, celui de père, le décalage est le même : est-ce l'homme qui fait face à son fils, ou le Roi ?
Au début de la pièce, c'est l'identité sociale de Ferrante qui est mise en avant, nous l'avons vu, par la plainte de l'Infante. Il est le Roi qui peut autoriser l'Infante humiliée à repartir, mais il est aussi le père du Prince qui refuse le mariage avec elle.
Mais cet autre aspect de ce que nous avons appelé son identité sociale, son statut paternel, pose encore un problème : Ferrante est-il vraiment un père, alors qu'il affirme ne pas aimer son fils et le fait emprisonner ? De la même façon qu'il y a chez lui un apparent renoncement à cette valeur sociale qu'est sa Puissance, il y a apparent reniement de celle de l'amour...
Lors de la scène d'ouverture, c'est l'Infante qui apprend à Ferrante que Pedro la rebute parce qu'il aime Iñès ; le Roi l'apprend avec une colère qu'on ne peut au départ que pressentir :
« [...] quand je revins de Navarre et annonçai au Prince mes intentions, je vis bien à sa contenance qu'il en recevait un coup. Mais je crus qu'il n'y avait là que l'ennui de se fixer, et d'entrer dans une gravité pour laquelle il n'a pas de goût. Doña Iñès de Castro ne fut pas nommée. Il me cacha son obstination. Et c'est à vous qu'il la jette, avec une discourtoisie qui m'atterre. » [A. 1, sc. 1, p. 20.]
Ses propos révèlent que Ferrante peut reprocher à son fils trois choses : son simple refus d'épouser l'Infante, le fait qu'il n'ait pas été franc avec lui, et celui qu'il ait été incorrect avec l'Infante. Mais ils révèlent aussi et surtout une absence totale de communication entre le père et le fils : non seulement Pedro n'a pas évoqué sa liaison avec Iñès, mais Ferrante n'a ni parlé des projets qu'il avait pour lui avant de partir, ni cherché à vérifier les raisons du malaise de son fils. Cette « rupture » visible dans la communication trouve un écho juste ensuite :
« Introduisez le Prince. Je ne sais jamais que lui dire ; mais, aujourd'hui, je le sais. » [A. 1, sc. 2, p. 24.]
Lors de la courte seconde scène, Ferrante se retrouve seul avec un serviteur avant de voir Pedro, ce qui permet de montrer la colère qu'il éprouve mais aussi de rendre plus évidente cette distance qu'il y a entre eux :
« Que [Pedro] attende un peu, que ma colère se soit refroidie. J'ai pâli, n'est-ce pas ? Mon cœur qui, au plus fort des batailles, n'a jamais perdu son rythme royal, se désordonne et palpite comme un coq qu'on égorge. Et mon âme m'est tombée dans les pieds. » [p. 23.]
La violence des images rend compte de l'intensité de cette colère et des troubles physiques qui l'accompagnent. Mais cette colère contre Pedro est-elle celle du Roi contrarié dans sa politique, ou du père déçu de sa conduite ? Car Ferrante ajoute ensuite :
« J'ai honte. Je ne veux pas que mon fils sache ce qu'il peut sur moi, ce que ne pourrait pas mon plus atroce ennemi. [...] Ah ! Pourquoi, pourquoi l'ai-je créé ? Et pourquoi suis-je forcé de compter avec lui, pourquoi suis-je forcé de pâtir à cause de lui, puisque je ne l'aime pas ? » [p. 24.]
Au moment où nous pourrions penser que l'« impact » négatif qu'a Pedro sur Ferrante est révélateur d'un attachement en proportion, celui-ci affirme ne pas l'aimer, se plaint de « pâtir » personnellement de lui, et va jusqu'à regretter de l'avoir mis au monde...
La première scène où père et fils sont confrontés débute par une tirade impressionnante de Ferrante, qui tend à expliquer la distance qui existe entre eux :
« Je suis las de mon trône, de ma cour, de mon peuple. Mais il y a quelqu'un dont je suis particulièrement las, Pedro, c'est vous. Il y a tout juste treize ans que je suis las de vous, Pedro. Bébé, je l'avoue, vous ne me reteniez guère. Puis, de cinq à treize ans, je vous ai tendrement aimé. [...] Treize ans a été l'année de votre grande gloire ; vous avez eu à treize ans une grâce, une gentillesse, une finesse, une intelligence que vous n'avez jamais retrouvées depuis. [...] A quatorze ans, vous vous étiez éteint ; vous étiez devenu médiocre et grossier. [...] Vous avez aujourd'hui vingt-six ans : il y a treize ans que je n'ai plus rien à vous dire. » [A. 1, sc. 3, pp. 25-6.]
Ferrante parle de « lassitude », comme pour le statut royal ; mais il semble bien que Ferrante ressente surtout de la déception : il aimait ce que son fils était, et n'aime pas ce qu'il est devenu : « médiocre et grossier ». L'imparfait qu'il emploie ensuite confirme ce sentiment de déception :
« « Mon père » : durant toute ma jeunesse, ces mots me faisaient vibrer. Il me semblait - en dehors de toute idée politique - qu'avoir un fils devait être quelque chose d'immense... » [p.26.]
Mais de la même façon que Ferrante se disait « roi de douleur » pour ensuite n'avouer qu'indifférence, il n'admet pas cette déception :
« Quand [Pedro] me mépriserait [...], ou quand il m'aimerait [...], cela me serait indifférent encore. » [A. 1, sc. 7, p. 50.]
Ce qu'affirme Ferrante, c'est le détachement : il semble renier son fils :
« Sa présence m'ennuie et m'est à charge. Oh ! Ne croyez pas qu'il soit amer de se désaffectionner. Au contraire, vous ne savez pas comme c'est bon, de sentir que l'on n'aime plus. [...] Que m'importe le lien du sang ! Il n'y a qu'un lien, celui qu'on a avec les êtres qu'on estime ou qu'on aime. Dieu sait que j'ai aimé mon fils, mais il vient un moment où il faut en finir avec ce qu'on aime. » [A. 2, sc. 3, pp. 81-2.]
Cette distance, ce reniement semblent donc dus à la médiocrité que Ferrante voit en son fils et ne supporte pas :
« [...] nous vivons, moi et lui, dans des domaines différents. » [p. 81.]
C'est ce qu'il lui dit dans une autre image, où la « différence » est plus précise (nous reviendrons sur les implications de cette précision ) :
« Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. » [A. 1, sc. 3, p. 27.]
Son exigence a apparemment tué l'amour qu'il lui portait : ses baisers sont sans signification, et son attitude lui vaut la prison :
« Embrassons-nous, si vous le désirez. Mais ces baisers entre parents et enfants, ces baisers dont on se demande pourquoi on les reçoit et pourquoi on les donne... » [A. 1, sc. 3, p. 34.]
La dureté de Ferrante s'exprime plus clairement encore quand il apprend de la bouche d'Iñès qu'ils se sont mariés en secret :
« Et depuis un an mon fils me cache cela. Depuis un mois, il connaît mes intentions sur l'Infante, et il ne dit rien. Hier, il était devant moi, et il ne disait rien. Et c'est vous qu'il charge d'essuyer ma colère, comme ces misérables peuplades qui, au combat, font marcher devant elles leurs femmes, pour se protéger ! » [A. 1, sc. 5, p. 48.]
Aussi la sentence tombe, sentence dont la concision rend plus fort le contraste entre l'effet et la cause :
« Allez, allez, en prison ! En prison pour médiocrité. » [A. 1, sc. 6, p. 50.]
Mais doit-on prendre cette dureté extrême, disproportionnée, pour une preuve d'absence d'amour ? Car à l'occasion de cette condamnation, Ferrante se contredit de façon flagrante à propos de ses rapports à Pedro, en déclarant devant Iñès :
« Il savait bien qu'un jour il devrait subir [ma colère], mais il préférait la remettre au lendemain, et sa couardise égale sa fourberie et sa stupidité. [...] A moins que... à moins qu'il n'ait compté sur ma mort. Je comprends maintenant pourquoi il se débat contre tout mariage. Je meurs, et à l'instant vous régnez ! Ah ! J’avais bien raison de penser qu'un père, en s'endormant, doit toujours glisser un poignard sous l'oreiller pour se défendre contre son fils. Treize ans à être l'un pour l'autre des étrangers, puis treize ans à être l'un pour l'autre des ennemis : c'est ce qu'on appelle la paternité. » [p. 48.]
Nous savons que devant Pedro, Ferrante a reconnu l'avoir aimé au moins les treize premières années de sa vie : est-ce par aigreur que son discours varie soudain ? Car le doute qui vient à son esprit, visible dans l'hésitation de ses paroles, se mue directement en une certitude dont Ferrante affirme qu'il l'a toujours eue... En outre, l'invraisemblance de son hypothèse, en regard du caractère de Pedro dans la pièce (bien qu'elle ne soit pas strictement vérifiable), prend un accent paranoïaque d'autant plus frappant qu'il l'énonce en mettant en avant son statut paternel, en usant des termes de « père » et de « paternité » : n'est-ce pas là au contraire la sentence du Roi, se méfiant d'un calcul politique du Prince, et condamnant celui-ci plus que le « fils » ?
L'indétermination de l'identité sociale de Ferrante en regard de son statut paternel est liée à celle sur laquelle nous avons débouché, en regard de son statut royal... Si Ferrante coïncidait malgré ses dires avec sa fonction de Roi, peut-être renierait-il Pedro pour sa médiocrité politique, son refus de régner, plus que pour sa médiocrité « humaine »...
La difficulté réside ici dans le fait que les reproches que Ferrante lui adresse, comme nombre de ses propos, mêlent un aspect royal et un aspect personnel... Là encore, ces aspects doivent-ils être pris pour respectivement « social » et « réel » ?
« Vous m'entendez ? Je veux que vous épousiez l'Infante. Elle est le fils que j'aurais dû avoir. Elle n'a que dix-sept ans, et déjà son esprit viril suppléera au vôtre. A votre sens, l’État marche toujours assez bien, quand il vous donne licence de faire tout ce que vous voulez ; gouverner vous est odieux. L'Infante, elle... Enfin, je l'aime. » [A. 1, sc. 3, p. 29.]
L'opposition qu'exprime Ferrante entre son fils et l'Infante, et sa préférence, concernent-elles le domaine public, ou privé ? L'indétermination se poursuit toute la scène :
« Assez d'absurdités. En vous ma suite et ma mémoire. Même si vous n'en voulez pas. Même si vous n'en êtes pas digne. » [p. 32.]
Est-ce le Roi ou l'homme qui parle ainsi ? Si nous prenons le parti de penser que c'est la « personne », le père, et non le « personnage » qui exprime cette dureté, il reste contradictoire que Ferrante tienne tant à ce mariage politique, et il est encore plus contradictoire de voir que d'autres propos de Ferrante laissent à penser que malgré tout il aime son fils...
Nous l'avons vu, Ferrante a affirmé ne pas l'aimer, ses paroles et ses attitudes sont excessivement dures ; mais comment expliquer, dans la scène même où Ferrante adresse à Pedro des reproches qui le condamnent et le renient autant que la mise en prison qui les suit, l'attitude évoquée par Pedro ?
« Jamais, depuis combien d'années, jamais vous ne vous êtes intéressé à ce qui m'intéresse. Vous ne l'avez même pas feint. Si, une fois... quand vous aviez votre fièvre tierce, et croyiez que vous alliez mourir ; tandis que je vous disais quelques mots auprès de votre lit, vous m'avez demandé : « Et les loups, en êtes-vous content ? ». Car c'était alors ma passion que la chasse au loup. Oui, une fois seulement, quand vous étiez tout affaibli et désespéré par le mal, vous m'avez parlé de ce que j'aime. » [A. 1, sc. 3, pp. 26-7.]
Cet intérêt, même « feint », n'est-il pas révélateur d'une volonté d'être agréable dont Ferrante ne l'aurait pas eue s'il n'aimait pas Pedro ? La proposition temporelle peut être prise pour une causale : Ferrante aurait eu cette attention parce qu'il se croyait mourant... D'autre part, la distance existant entre eux en temps normal rend surprenante la promptitude que montre Ferrante à évoquer le passé commun à lui et son fils : or, à chacun des trois actes, il va s'attendrir chaque fois plus éloquemment sur ses souvenirs... Déjà dans cette scène, il coupe son fils brutalement :
« [...] il y a treize ans que je n'ai plus rien à vous dire.
- Mon père...
- « Mon père » : durant toute ma jeunesse, ces mots me faisaient vibrer. Il me semblait... » [p.26.]
Les jeunes pages qui jouent lui font instantanément penser à Pedro :
« Vous les avez entendus, comme ils rient : un jour de leur vie s'est écoulé, et ils ne le savent pas. Ils n'ont pas plus peur de moi que n'en avait peur mon fils à leur âge. » [A. 2, sc. 3, p. 75.]
Mais c'est surtout lors du troisième acte que Ferrante va sembler trop tendre pour que l'on puisse ne pas penser que cet amour a totalement disparu : devant Iñès, qui évoque son futur fils avec transport, il va d'abord tenter de l'en dégoûter puis apparemment céder à sa nostalgie, avant de se ressaisir :
« [...] Je souhaite avec passion qu'il me ressemble dans ce que j'ai de mieux.
- Et, ce qu'il vous reprochera, c'est cela même : d'avoir voulu qu'il fût pareil à vous. Allez, je connais tout cela.
- [...] Il est le rêve de mon sang. Mon sang ne peut pas me tromper.
- Le rêve...Vous ne croyez pas si bien dire. Vous êtes en pleine rêverie.
- [...]
- J'ai connu tout cela. Comme il embrassait, ce petit ! On l'appelait Pedrito (mais quelquefois, s'il dormait, et qu'on murmurât son nom, il disait dans son sommeil : « Pedrito ? Qui est-ce ? »). Son affection incompréhensible. Si je le taquinais, si je le plaisantais, si je le grondais, à tout il répondait en se jetant sur moi et en m'embrassant. Et il me regardait longuement, de près, avec un air étonné...
- Déjà !
- Au commencement, j'en étais gêné. Ensuite, j'ai accepté cela. J'ai accepté qu'il connût ce que je suis. Il m'agaçait un peu quand il me faisait des bourrades. Mais, lorsqu'il ne m'en a plus fait... Car il est devenu un homme, c'est-à-dire la caricature de ce qu'il était. Vous aussi, vous verrez se défaire ce qui a été votre enfant. [...] » [A. 3, sc. 6, pp. 134-5.]
Ces évocations avec exclamation, parenthèses, silences semblent durer bien longtemps chez quelqu'un qui a dénoncé « la plupart des affections » comme « des habitudes ou des devoirs »... il est caractéristique que l'intervention d'Iñès ne soit d'aucun effet sur Ferrante, alors qu'elle va dans le sens d'une pérennité des traits infantiles de Pedro...
On peut malgré cela considérer que cette nostalgie est révélatrice non d'un simple amour, mais d'un amour révolu, mort ; qu'elle est l'expression du regret mais pas de l'amertume. Mais il reste encore une incohérence dans l'attitude de Ferrante : malgré toute la distance et l'absence de communication que nous avons constatées entre eux, il semble s'inquiéter de la réaction qu'il suppose à Pedro, quand ses conseillers lui soufflent l'idée d'éliminer Iñès :
« Quoi ! La faire mourir ! Quel excès incroyable ! Si je tue quelqu'un pour avoir aimé mon fils, que ferais-je donc à qui l'aurait haï ?
[...] Et je dresse contre moi mon fils, à jamais. Je détruis entre moi et lui toute possibilité de rémission, de réconciliation ou pardon aucun, irrévocablement. » [A. 2, sc. 1, pp. 61 et 66.]
Si Ferrante n'aime pas son fils, comme il le prétend, pourquoi se soucie-t-il de le « dresser » contre lui ? S'il le trouve médiocre, et si cette médiocrité est ce qui l'empêche de l'aimer comme il l'a aimé, pourquoi y a-t-il encore cette triple « possibilité » ?
Il répétera pratiquement la même phrase à la fin de la pièce... après avoir ordonné le meurtre de la jeune femme, alors qu'il avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'il ne le ferait pas :
« Pourquoi est-ce que je la tue ? Il y a sans doute une raison, mais je ne la distingue pas. Non seulement Pedro n'épousera pas l'Infante, mais je l'arme contre moi, inexpiablement. » [A. 3, sc. 8, p. 143.]
La question que se pose Ferrante est la nôtre, pourtant il justifiera son geste par la raison d’État et fera arrêter son ministre Egas Coelho comme instigateur du meurtre... Il est d'ailleurs encore plus contradictoire qu'en disant cela Ferrante semble plus s'assimiler à son « personnage » de Roi et de père, alors qu'au moment du meurtre « tout se passe comme si, en condamnant successivement la cérébralité cynique de l'instance de pouvoir [Egas Coelho] et la sentimentalité naïve de l’instance parentale [Iñès], le personnage condamnait successivement ces deux parts de lui-même, alternativement développées », comme le remarque Lancrey-Javal16.
Nous atteignons là, à la fin de La Reine morte, à la plus grande incohérence de Ferrante, à l'aboutissement ultime de ces multiples contradictions, qui font à notre sens tout l'intérêt du personnage, si ce n'est de la pièce : pourquoi ce geste si Ferrante n'a pas la passion du pouvoir, et même s'il l'a ? Pourquoi ce geste si Ferrante aime son fils, et même s'il ne l'aime pas ? Pourquoi ce geste qui cumule les échecs politique et paternel ? Ferrante lui-même n'en a aucune idée... Ne serait-ce pas pour cela qu’il est, selon Montherlant, « désespéré des autres et de soi » ?17
Pour l'instant, un seul constat peut être fait : celui que les contradictions incessantes de Ferrante ne nous permettent pas de l'identifier socialement. Il n'est pas simplement un Roi et un père, nous ne pouvons l'assimiler strictement à son « personnage »... Mais où est la « personne » dans toutes ces affirmations contraires, dans toutes ces contradictions ? Pouvons-nous le savoir en tentant de les expliquer ?
En faisant le constat d'un décalage existant entre ce que Ferrante semble être au premier abord et ce qu'il prétend être, nous avons vu que le « personnage » était démenti par la « personne ».
Cette « personne », a priori plus réelle, il serait tentant de l'assimiler strictement à l'homme qu'est Ferrante - et le « personnage » au Roi -, mais cette distinction s'avérerait hasardeuse du fait qu'homme et Roi restent dans la pièce étroitement liés, et même, inextricablement. De plus, il ne faut pas oublier l'étymologie du mot « personne » : persona signifiant en latin « masque », il désigne l'être en ce qu'il a d'immuable, de fixe...Peut-être vaut-il mieux parler de ce qui change, sa « personnalité », pour aborder maintenant son « identité psychologique », en tentant de vérifier le mot de Delay : « Dans une façon de voir se projette une façon d'être. »18.
Le théâtre de Montherlant est, de son propre aveu, une tentative de définition de l'homme, un regard porté sur « le clair-obscur de l'homme »19. Mais quel regard ?
La vision de l'homme telle qu'elle nous est donnée dans La Reine morte s'assimile à une analyse, presque à une entreprise de dissection de ce qui fait l'humain... Et elle nous est donnée essentiellement par Ferrante lui-même. De fait, cette personnalité affirmée par la personne de Ferrante comporte de nombreux points communs avec celle de son auteur lui-même...qu'il s'agira de dégager, dans la seule ambition d'éclairer celle du personnage.
C'est donc presque exclusivement par les yeux de Ferrante qu'on est amené à considérer l'individu comme une somme d'éléments :ces éléments constituent une gamme très étendue dont chacun hérite dans une certaine mesure, et permettent ensemble de rendre compte de la complexité d'un être... Mais ces éléments sont évidemment classifiables et il apparaît au fil de la pièce que Ferrante use d'une conception de l'existence proche de la taxinomie : une « grille » de classification particulière, qui fait qu'il établit un classement qualitatif des éléments et, par extension, de leur somme : l'individu. En un mot, il s'agit au bout du compte - car c'en est un - d'une préférence pour certains êtres plutôt que pour d'autres, en vertu de cette grille d'évaluation : nous débouchons sur la notion de « valeur » d'un individu. Cette valeur va prendre le nom de « qualité » ou de « médiocrité », et vaudra le mépris ou l'estime, selon.
Comment nommer cette grille, cette conception de l'existence, qui semble très proche de celle de l'auteur ?
Certains critiques ont parlé de « philosophie » de la vie, comme Mohrt : « Cette philosophie que Montherlant s'était fabriquée à son usage, assez bien résumée par le « es igual » espagnol, [ _ ] cette indifférence supérieure. »20, ou de « métaphysique », comme Simon : « Sa vision de l'homme et de la vie est marquée par une métaphysique, en vérité plus affective que réfléchie, où triomphe l'idée du Néant. »21. Blanc va quant à lui jusqu'à parler, du fait que Montherlant avait écrit des essais de moraliste, de « morale de la qualité », pour ensuite la juger « parfois excessive »22 ; nous reviendrons sur les points communs aux conceptions de Montherlant et à celles de Ferrante, au fil de l'étude ; mais en ce qui concerne le personnage, l'excès de sa conception (que nous verrons dans son application) nous fait préférer le terme de « théorie » de la qualité : il rend déjà le côté froid, dénué de vie d'un système qui s’avérera voué à l'échec.
Cette théorie oppose donc la « qualité » à la « médiocrité », et par excès dans son application par Ferrante, à la norme (car cela ne devrait pas revenir tout à fait au même : si les deux termes, médiocrité et norme, désignent ce qui se situe au milieu, seul le premier est négativement connoté), et détermine la valeur d'un individu, soit en prônant sa « qualité » soit en condamnant sa « médiocrité » et/ou sa « normalité » : c'est donc une échelle de valeurs spécifique et élitiste.
Nous avons tenté de synthétiser cette théorie en ayant recours à un tableau résumé, présenté page suivante, et à des termes spécifiques, car dans la pièce, celle-ci se dévoile par un foisonnement d'images ; images de multiple nature, images énoncées par Ferrante mais aussi par tous les personnages jusqu'aux moins importants, gentilshommes, dames d'honneur, pages... Elles concernent essentiellement Ferrante, mais là encore d'autres personnages tels que l'Infante, Iñès et Pedro, et certains conseillers du Roi. Nous avons donc classé ces images en un tableau synthétique puisqu'il apparaît qu'elles symbolisent ce qu'il nous faut appeler des « principes » :ces grands principes sont peu nombreux, et en même temps très proches les uns des autres ; la hauteur, opposée à la bassesse, la grandeur, opposée à la petitesse, la profondeur, opposée à la platitude, et finalement la verticalité opposée à l'horizontalité.
Le principe de verticalité résout l'apparent paradoxe entre le principe de hauteur et celui de profondeur ; il s'agit d'une orientation plus que d'une direction, de la même façon que leurs principes contraires, bassesse et platitude, sont des principes différents mais pas opposés23.
Nous allons expliquer la conception du tableau par quelques citations parmi les plus éclairantes.
Ce qui est prôné d'abord par Ferrante est la hauteur, hauteur que l'on trouve chez lui mais pas chez Pedro :
« Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. » [A. 1, sc. 3, p. 27]
« ... je suis pour moi-même la forêt et la montagne. Mes âmes enchevêtrées sont les broussailles de la forêt, et j'ai dû, puisque j'étais Roi, me faire de ma propre pensée un haut lieu et une montagne. » [A. 3, sc. 2, p. 110]
On la trouve aussi chez l'Infante :
« Pampelune est comme la cour intérieure d'une citadelle, encaissée entre de hautes montagnes ;et il y a mon âme, alentour, qui va de hauteur en hauteur, qui veille... » [A. 2, sc. 5, p. 102]
La grandeur est un principe voisin, évidemment prôné par le Roi, que l'on trouve beaucoup chez l'Infante :
« Sa sagesse est grande et sa mesure. » [A. 1, sc. 1, p. 19]
|
THÉORIE APPLIQUÉE À FERRANTE |
|
|
|
|
|
(poule – œufs) |
lion poule – œufs (taureau) (arbre) |
lion coq |
(eau) (flamme) (statue) (vent) (aigle) |
armure (coq) poule – œufs vent |
luciole arbre (forêt) |
Le « pire » ? |
|
(échelle) (arbre) (forêt) (montagne) (aigle) (flamme) (armure) (statue) (serpent) |
montagne (arbre) (forêt) aigle |
échelle (lion) cerf arbre (forêt) aigle |
aigle (eau) |
taureau (aigle) lion vent (armure) (flamme) arbre chat |
(taureau) chat (aigle) (coq) (lion) (serpent) (armure) (œuf) |
|
|
(taureau) (arbre) (forêt) (chat) (montagne) (armure) (statue) |
(montagne) (forêt) |
luciole serpent aigle |
Le « meilleur » ? |
|
|
THÉORIE APPLIQUÉE PAR FERRANTE |
HORIZONTALITÉ |
BASSESSE |
PETITESSE |
PLATITUDE |
LE FAIBLE |
LE FEMELLE |
LE VIEUX |
LE MALADE |
LE MOL (FLUIDE – AÉRIEN) |
LE VIDE |
L’OBSCUR |
MÉDIOCRITÉ |
|
VERTICALITÉ |
HAUTEUR |
GRANDEUR |
PROFONDEUR |
LE FORT |
LE MÂLE |
LE JEUNE |
LE SAIN |
LE DUR |
LE PLEIN |
LE LUMINEUX |
QUALITÉ |
|
|
|
LES
PRINCIPES
GRANDS
|
CRITÈRES |
LEUR « VALEUR » |
|||||||||
« Vous êtes aussi grande que vous êtes noble. » [A. 1, sc. 1, p. 22]
« ... toutes les choses grandes qu'il y a en moi ... » [A. 1, sc. 1, p. 23]
« Moi, je suis grande. Et ce qui est beau n'a jamais pu égaler ce qui est grand. » [A. 2, sc. 5,
Cette grandeur a disparu chez Pedro :
« Treize ans a été l'année de votre grande gloire[ ... ]Vous êtes petit, et rapetissez tout à votre mesure. » [A. 1, sc. 3, pp. 25-7]
Le principe de profondeur est - sans paradoxe, donc - allié chez Ferrante à celui de la grandeur et de la hauteur :
« Mon âme [ ... ] comme un grand aigle affamé de profondeur [ ... ] » [A. 2, sc. 3, p. 77]
« [L'Infante]est brusque, profonde, singulière. » [A. 1, sc. 3, p. 29]
« Selon moi, le Prince est...comment dire ? Le Prince est une eau peu profonde. » [A. 1, sc. 5, p. 45]
Ce principe de profondeur mais aussi ceux de grandeur et de hauteur, sont subordonnés au principe de verticalité. Les images de verticalité ou d'horizontalité sont par conséquent les plus nombreuses, même si elles ne sont pas les plus évidentes.
Ainsi Ferrante évoque sa colère en déclarant :
« Et mon âme m'est tombée dans les pieds. » [A. 1, sc. 2, p. 23]
Et il évoque celle de l'Infante par l'image opposée de verticalité :
« ...elle dansait devant moi le pas de l'honneur (ma foi, elle ne touchait pas terre.) » [A. 1, sc. 3, p. 29]
« Votre exaltation était pareille à celle de la vague qui se soulève. Avec elle, vous nous avez tous soulevés. » [A. 1, sc. 1, p. 22]
Chez Pedro, mais aussi dans une moindre mesure chez Iñès, se retrouve le principe opposé :
« On peut avoir de l'indulgence pour la médiocrité qu'on pressent chez un enfant. Non pour celle qui s'étale chez un homme. » [A. 1, sc. 3, p. 27]
L'horizontalité est moins évidente chez Iñès, mais se retrouve avec le principe de platitude :
« Son âme est lisse comme son visage. »[A. 3, sc. 7, p. 144.]
« ses yeux comme deux lacs tranquilles... »[p. 145.]
L'oiseau est un symbole évident de verticalité ; pourtant le choix des images révèle les mêmes oppositions :
verticalité chez Ferrante :
« Bientôt mon âme va toucher la pointe extrême de son vol, comme un grand aigle affamé de profondeur et de lumière. » [A. 2, sc. 3, p. 77]
verticalité également chez l'Infante :
« Comme elle dresse la tête, avec la brusquerie de l'oiseau de proie ! » [A. 1, sc. 1, p. 22]
« l'Infante, ce gerfaut. » [A. 2, sc. 2, p. 78]
Mais chez Iñès, l'oiseau ne vole pas, ou peu :
« Toute ma vie se rouvre, comme la queue d'un paon qui se déploie. » [A. 2, sc. 3, p. 80]
« Quand l'oiseau de race est capturé, il ne se débat pas. Vous parliez d'un nuage en forme d'aile. Si j'avais une aile, ce ne serait pas pour fuir, mais pour protéger. » [A. 2, sc. 5, p. 99]
« L'hirondelle est blessée, doña Iñès. Combien de temps volera-t-elle encore, si elle ne trouve abri ? » [A. 2, sc. 5, p. 102]
Et chez Pedro, l'image est celle d'un animal rampant :
« ... chez l'homme, c'est le papillon qui devient un ver » [A. 1, sc. 3, p. 25]
Ce principe a priori spatial est présent dans le temporel : ce qui est irrégulier est vertical, par opposition à ce qui est constant, linéaire dans la durée :
ainsi Ferrante est en « dents de scie » de par ses contradictions, il a ce qu'on appelle familièrement « des hauts et des bas » ; l'Infante, avec ses revirements vis-à-vis d'Iñès, est dite « convulsive » par Montherlant24 :
« Déjà toute pleine du large, déjà mon âme, à contrevent, était rebroussée vers toi. » [A. 3, sc. 6, p. 131]
L'expression hachée, avec ses antépositions et répétitions enclavées, cette « chanson heurtée, elliptique » selon le mot de Barrès cité par Montherlant, reflète le chaos des sentiments et l'irrégularité de la personnalité ; tandis que Pedro et Iñès restent eux-mêmes, constants lui dans la médiocrité et elle dans l'amour, « étales »25 : ce sont les images d'eau, Pedro comparé à une « eau peu profonde » et Iñès à des « lacs » ou des « étangs » :
« [L'Infante] répète toujours le même cri, comme l'oiseau malurus, à la tombée du soir, sur la tristesse des étangs. » [A. 3, sc. 6, p. 131]
A l'examen de ses seuls principes, la théorie de Ferrante semble d'un dualisme très net, sans nuances...Que penser de cette horizontalité toujours réprouvée chez Iñès, alors que le personnage va au fil de la pièce incarner l'Amour, en être la personnification absolue ? Cette question, sur laquelle il nous sera ultérieurement nécessaire de revenir, amène une remarque frappante : l'absence d'amour dans le tableau. L'amour ne semble pas être un principe, ni même un critère...Est-ce à dire qu'il n'est donc pas considéré par Ferrante comme une valeur ?
Ces quatre grands principes sont décomposés en ce que nous avons appelé des « critères », plus nombreux et dont le sens symbolique rejoint et parfois recoupe celui des principes ; précisons que notre choix de ces appellations et de leur classement ne peut être qu'arbitraire, dans un souci de clarification. Ces critères déterminent donc, conjointement aux principes, la « valeur » des individus qui les incarnent par le biais des images. Le principal critère est celui de la force, opposé à la faiblesse, car tous les autres s'y rattachent symboliquement (ceci, en lien avec le principe de verticalité) : le mâle opposé au femelle, le jeune au vieux, le sain au malade, le dur au « mol » (nous incluons dans ce critère le fluide et l'aérien), le plein au vide, enfin le lumineux à l'obscur. Bien évidemment, le dualisme de cette théorie fait qu'il serait possible d'allonger la liste de ces critères à l'infini : le blanc et le noir, l'intérieur et l'extérieur, le pur et l'impur...Mais dans La Reine morte, ces critères suffisent du fait qu'ils se recoupent la plupart du temps.
À nouveau, nous devons justifier la conception de notre tableau par quelques exemples.
Le mâle est un critère qui rejoint toujours celui de la force, et que l'on retrouve chez l'Infante, en opposition à Pedro :
« [L'Infante]est le fils que j'aurais dû avoir. Elle n'a que dix-sept ans, et déjà son esprit viril suppléera au vôtre. » [A. 1, sc. 3, p. 29]
« Si j'avais épousé don Pedro, c'est moi qui aurais été l'homme [ ... ] » [A. 2, sc. 5, p. 101]
À l'inverse, le critère du femelle et celui de la faiblesse sont confondus ;ainsi Ferrante demande à son fils :
« Votre bonheur!...Êtes-vous une femme ? » [A. 1, sc. 3, p. 32]
De même, le jeune et le sain, critères différents mais évidemment liés, se retrouvent chez l'Infante, en opposition à Ferrante :
« Si je n'étais jeune et vigoureuse [ ... ] » [A. 1, sc. 1, p. 19]
« Et cette énergie pleine d'innocence... Son visage est comme ces visages de génies adolescents qu'on voit sculptés sur les cuirasses [ ... ] » [A. 1, sc. 3, p. 29]
« [Mes ministres] sont là à vivre de ma vieille force [ ... ] » [A. 2, sc. 3, p. 75]
Le dur est un critère associé principalement à l'Infante, qui partage notamment l'image du taureau avec Ferrante, comme nous le verrons par la suite :
« Je vous en prie, ne me faites pas l'éloge de la mollesse :vous me blessez personnellement. » [A. 2, sc. 5, p. 101]
« La Navarre est un pays dur. Les taureaux de chez nous sont de l'Espagne ceux qui ont les pattes les plus résistantes, parce qu'ils marchent toute la journée sur de la rocaille... » [A. 1, sc. 1, p. 21]
« L'Infante [ ... ] dans ces salles souffletées de tous côtés par son génie [ ... ] est une fille inspirée et fiévreuse :elle a été bercée sur un bouclier d'airain [ ... ] » [A. 2, sc. 3, p. 78]
Enfin, le critère du lumineux opposé à celui de l'obscur est presque tout entier dans l'image des lucioles auxquelles aime à se comparer Ferrante :
« Il dit qu'elles lui ressemblent : alternativement obscures et lumineuses, lumineuses et obscures. » [A. 3, sc. 2, p. 115]
Le lumineux, dans l'absolu et dans cette image, apparaît comme un critère positivement connoté, une marque de qualité...Mais le dualisme de la théorie s'avère moins net qu'il n'y paraît du fait que les images énoncées mêlent souvent différents principes et différents critères qui devraient être inconciliables ; ainsi le personnage d'Egas Coelho se trouve, dans la même scène, comparé par Ferrante à deux éléments différents :
« Vous êtes ondoyant comme une flamme, comme une de ces mauvaises flammes qu'on voit se promener sur les étangs pourris, et qui s'éteignent quand on veut les toucher. » [A. 2, sc. 2, p. 70]
« C'est entendu, il me plaît qu'il y ait un peu de boue chez les êtres. Elle cimente. En Afrique, des villes entières ne sont bâties que de boue. Elle les fait tenir. » [A. 2, sc. 2, pp. 71-2]
Il y a double contradiction, puisque ces deux éléments, flamme et boue, sont négativement connotés alors que la première image se rattache au critère du lumineux et l'autre à celui de l'obscur, et alors que toutes deux se rattachent au principe prôné de la verticalité (ici, la boue apparaît comme un élément obscur, mais pas horizontal, puisque c’est lui qui fait « tenir » des « villes entières »)...
De la même façon que l'amour n'apparaît pas comme un principe du tableau, il semble ne pas y exister de critères du bon et du mauvais : les individus sont a priori classés en fonction de la distinction entre qualité et médiocrité et non entre Bien et Mal, parallèlement à des connotations positives ou négatives, qui semblent rester indépendantes de la théorie.
La subjectivité extrême de cette théorie constitue sa faille, en ce qu'elle va inévitablement entraîner de graves confusions : confusion de Ferrante dans ses rapports à autrui, évidemment, mais aussi dans ses rapports à lui-même...Car l'excès est dans La Reine morte toujours voué à l'échec.
Notre tableau synthétise donc en même temps la grille qu'utilise Montherlant pour exposer ses personnages, et celle qu'applique Ferrante constamment dans ses rapports aux autres, ce qui dénote déjà chez le personnage une volonté implacable de cerner, d'identifier ceux qui l'entourent, et de se cerner lui-même. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.
Cela dénote aussi et surtout une extrême dureté, puisque Ferrante passe les êtres au crible - et quel crible - pour y trouver une somme de principes et de critères, et appréhender ces êtres à travers eux... Or ce qui est frappant, nous l'avons constaté, c'est l'absence dans la grille de critères explicites de bon ou de mauvais, et l'absence d'amour, comme si ces notions n'étaient pas considérées comme des valeurs... Quel jugement peut-il alors en retirer, comment applique-t-il sa théorie ?
Nous parlions de la dureté donc de l'excès de la théorie, nous allons voir celui de son application, qui prend les formes de l'estime ou du mépris, selon : c'est là l'explication du décalage constaté entre le « personnage » et la « personne » de Ferrante, l'explication de l'indétermination de son identité sociale... Car Ferrante est un « père sans fils » à cause de la théorie appliquée par lui, et un « Roi sans pouvoir »... à cause de la théorie appliquée à lui.
Des quelques exemples que nous avons pris pour expliquer la vision théorique du personnage, ressort un parallèle flagrant entre lui et l'Infante de Navarre ; ce parallèle serait étonnant s'il ne trouvait sa cohérence depuis le point de vue de Ferrante, au travers de sa théorie. En effet, ces deux personnages sont opposés, en apparence, radicalement26.
Or, les principes de grandeur, de hauteur, de profondeur et de verticalité sont tous réunis chez chacun d'eux, les plaçant dans la catégorie des êtres de qualité. Leurs différences de sexe et d'âge, et même d'origine, se fondent dans des images majestueuses ;ils sont comparés lui à l'« aigle », elle au « gerfaut », tous deux au « taureau »... Et le point commun à ces images animales est le critère de la dureté, plus encore que celui de la force. Cette dureté exprimée par les images reflète celle de leur vision du monde ; car si rien dans la pièce ne permet de voir chez l'Infante une théorie, un système construit semblable à celui du Roi, leur parallèle met en lumière un même élitisme, une même dureté qui transparaît dans l'excès de leur personnalité : excès dans l'absence d'amour, l'indifférence vis-à-vis d'autrui et excès dans l'omniprésence d'orgueil, l'amour vis-à-vis de soi-même.
L'Infante semble en effet totalement dépourvue d'amour pour autrui :
« La froideur du Prince, à mon égard, ne me surprend ni ne m'attriste. [ ... ] il m'eût conté ses amours de bout en bout et dans le détail : tant les gens affligés du dérangement amoureux ont la manie de se croire objet d'admiration et d'envie pour l'univers entier. » [A. 1, sc. 1, p. 18]
« Je ne suis pas encore parvenue à comprendre comment on peut aimer un homme. Ceux que j'ai approchés, je les ai vus, presque tous, grossiers, et tous, lâches. [ ... ] Si un homme s'était donné le ridicule de m'aimer, j'y aurais prêté si peu d'attention que je n'en aurais nul souvenir. » [A. 2, sc. 5, pp. 99-100]
La dureté dont l'Infante fait preuve vis-à-vis de l'humain ne semble pas l'épargner elle-même : à son cri du cœur, lors de la première scène d'exposition :
« Ce n'est pas la femme qui est insultée en moi, c'est l'Infante. Peu m'importe le Prince ! » [p. 20]
fait écho cette affirmation à Iñès :
« ... la nature m'ordonnerait plutôt de vous haïr. Mais je fais peu de cas de la nature. » [A. 2, sc. 5, p. 96]
Pourtant, cette dureté souffre une exception, Iñès justement. Il est difficile de se l'expliquer : s'il s'agissait de générosité, vraie donc désintéressée, elle n'aurait pas pour strict objet la personne d'Iñès27; s'il s'agissait seulement de sa « gloire », comme elle le prétend 28, celle-ci l'aurait poussée à feindre et rester au palais sans que Ferrante ait besoin de provoquer cette réaction ; certains ont vu là une attirance homosexuelle. Mais cela paraît peu probable.
Contentons-nous de voir dans cette exception une faille de sa vision du monde propre, tout comme Ferrante possède la sienne, et que c'est de là que viendra leur échec à l'un comme à l'autre : l'insupportable constat que la réalité ne soit pas l'application stricte de ce qu'ils désirent en fonction de cette vision excessive.
Dans le cas de Ferrante, nous avons constaté qu'il avait apparemment renié son fils, mais que de nombreuses contradictions dans ses propos tendaient à laisser penser qu'il n'en était rien ; ces contradictions maintenant s'éclairent : il l'a, pour ainsi dire, « théoriquement » renié... Car, comme l'Infante, le Roi semble dépourvu d'amour ; l'amour est non seulement totalement absent de sa théorie, puisqu'il n'y est pas pris en compte, mais il est aussi totalement nié directement dans les propos du personnage, pour qui les sentiments n'existent plus :
« Et [l'Infante]ne vous aime pas, non plus que vous l'aimez, ce qui est bien la meilleure condition pour que votre union soit heureuse à l'État, et même heureuse tout court. » [A. 1, sc. 3, p. 29]
« Ne me parlez pas de tendresse. Il y a longtemps que ces sentiments-là ont cessé de m'intéresser. » [A. 2, sc. 3, p. 81]
« Les amours sont comme ces armées immenses qui recouvraient hier la plaine. Aujourd'hui on les cherche : elles se sont dissipées. » [A. 2, sc. 3, p. 81]
« La plupart des affections ne sont que des habitudes ou des devoirs qu'on n'a pas le courage de briser. » [A. 2, sc. 3, p. 82]
Si le sentiment d'amour n'est pas nié dans le passé, ce qui laisse un doute sur la bonne foi de telles affirmations dans le présent, il l'est complètement par l'excès de leur expression. L'amour charnel, lui aussi, est re-nié, exprimé par des images qui évoquent la mort :
« Péché aussi de vous dire trop comment je me représente ce que les hommes et les femmes appellent amour, qui est d'aller dans des maisons noires au fond d'alcôves plus tristes qu'eux-mêmes, pour s'y mêler en silence comme les ombres. » [A. 1, sc. 5, p. 45]
Ce point de vue pourrait souffrir une exception, si le parallèle entre lui et l'Infante se vérifiait pleinement : Pedro, son fils. Mais il ne se vérifie qu'à moitié : Ferrante a aimé Pedro, puis a renié et cet amour, et ce fils... au nom de sa théorie, à laquelle Pedro ne correspondait plus. L'excès de la théorie aboutit à celui de son application : en effet, la distinction entre qualité et médiocrité, qui débouche sur l'estime ou sur le mépris, remplace celle, absente, entre le bon et le mauvais, qui devrait déboucher sur l'amour ; l'élitisme remplace le sentiment et, fatalement, le remplace mal... Il est évident que chez Ferrante, la confusion entre les deux est très importante, ses contradictions le soulignent assez : il apparaît ainsi que s'il y a pour lui une grande différence entre l'amour et l'estime, il y en a une très ténue entre l'estime et l'amour...29
Ferrante confond en effet le sentiment d'amour avec l'estime qu'il nourrit pour l'Infante, mais aussi, et cela est plus surprenant, pour son ministre Egas Coelho.
« A votre sens, l'État marche toujours assez bien, quand il vous donne licence de faire tout ce que vous voulez ;gouverner vous est odieux. L'Infante, elle... Enfin, je l'aime. » [A. 1, sc. 3, p. 29]
Toutes les coïncidences entre les principes ou critères de sa théorie et le caractère de l'Infante expliquent cette « attirance », qu'il compare au lien communément le plus fort, le lien filial : « elle est le fils qu['il] aurait dû avoir », mais aussi « [sa] fille dans l'amertume affreuse » [A. 1, sc. 2, p. 65].
Ce qui l'attire chez Egas Coelho est une forme de mérite perverse : c'est sa qualité dans le vice qu'il apprécie. L'oxymore dont il use pour en faire le portrait à Iñès est révélateur :
« Des coquins qui m'enterreront ! Mon premier ministre est un diable merveilleux. Il m'a joué à moi-même quelques tours, mais avec un art infini. Aussi lui ai-je pardonné. » [A. 2, sc. 3, p. 76]
Au nom de sa théorie, Ferrante en arrive donc à estimer Egas, ce qui est déjà un paradoxe, mais aussi à l'aimer, ce qui fait du paradoxe une absurdité :
« Je sais qu'en tout vous avez vos raisons, et ne regardez qu'elles, plutôt que mon service, et que ce sont des raisons ignobles, mais je vous fais confiance quand même. Cela est étrange, mais il n'y a que des choses étranges par le monde. Et tant mieux, car j'aime les choses étranges. Ou plutôt je sais bien pourquoi je vous aime :parce que vous avez su capter ma confiance sans la mériter, et j'aime les gens adroits. » [A. 2, sc. 2, p. 73]
La difficulté même qu'éprouve Ferrante à exprimer cette préférence dénonce l'incohérence à laquelle l'amène sa théorie de la qualité30... Qui plus est, Ferrante confond l'estime avec l'« amour », alors qu'à l'inverse, il distingue l'amour porté à son fils de l'estime, à laquelle ce dernier n'a pas droit... Cette incohérence, aussi étonnante soit-elle, est flagrante dans son affirmation à Iñès:
« Que m'importe le lien du sang ! Il n'y a qu'un lien, celui qu'on a avec les êtres qu'on estime ou qu'on aime. » [A. 2, sc. 3, p. 82]
Cela n'est pas très clair, puisque finalement, les êtres qu'il aime sont ceux qu'il estime... Avec Pedro, Ferrante oscille entre le mépris et un reste d'amour qu'il a du mal à assumer :
« Dieu sait que j'ai aimé mon fils, mais il vient un moment où il faut en finir avec ce qu'on aime. On devrait pouvoir rompre brusquement avec ses enfants, comme on le fait avec ses maîtresses. »
Ce sentiment d'une nécessité de la rupture naît de sa théorie, qui lui impose littéralement de se détacher de ce qui ne s'assimile pas à la qualité, parallèlement à la conscience que cette attitude est hors-normes, donc « ne se fait pas » ; aussi, quand Iñès, qui a senti cela, s'exclame « Mais vous l'aimez encore, voyons! », ce que répond Ferrante n'est pas un réel démenti :
« Il ne le mérite pas. »
Là encore, l'amour n'est pas pris en ligne de compte, il n'est pas une valeur parce que sans rapport avec le mérite :
« Quand [Pedro] me mépriserait, quand il aurait fait peindre mon image sur les semelles de ses souliers, pour me piétiner quand il marche, ou quand il m'aimerait au point d'être prêt à donner pour moi sa vie, cela me serait indifférent encore. » [A. 1, sc. 7, p. 50]
Ce mépris de Ferrante vis-à-vis de Pedro se constate à de nombreuses reprises, et notamment par les deux comparaisons animales qu'il établit avec lui :
« Ce n'est pas par bonté que je ne punis pas plus rudement le Prince, c'est par raison :parce qu'un âne a fait un faux-pas, devrait-on lui couper la jambe? » [A. 2, sc. 3, p. 79]
« On dit toujours que c'est d'un ver que sort le papillon ;chez l'homme, c'est le papillon qui devient un ver. A quatorze ans, vous vous étiez éteint ;vous étiez devenu médiocre et grossier. » [A. 1, sc. 3, p. 25]
C'est bien la médiocrité de son fils qui insupporte Ferrante, et qu'il condamne :
« On peut avoir de l'indulgence pour la médiocrité qu'on pressent chez un enfant. Non pour celle qui s'étale dans un homme. » [A. 1, sc. 3, p. 27]
« ... vous allez arrêter sur-le-champ le personnage que j'ai pour fils. [...] Allez, allez, en prison ! En prison pour médiocrité. » [A. 1, sc. 6, pp. 49-50]
Si, selon le mot de Genêt, « vivre, c'est survivre à un enfant mort », on peut dire qu'aux yeux de son père Pedro n'a pas survécu...Le culte de l'enfant a fait place au mépris de l'adulte, qui d'une certaine façon n'existe pas... La déception qu'éprouve Ferrante le fait osciller entre un réel mépris pour ce que Pedro représente à ses yeux, qu'il renie, et un réel amour pour ce qu'il représentait, qu'il nie, dont il tente de se défaire plus ou moins efficacement et qui transparaît par moments. L'incohérence qui en résulte, Ferrante s'en débarrasse par une pirouette :
« Mettons que je l'aime assez pour souffrir de ne pas l'aimer davantage. » [A. 2, sc. 3, p. 82]
Il devient plus clair maintenant que la contradiction que nous constations entre le Ferrante « extérieur », le personnage, et le Ferrante « intérieur », la personne, vient en fait d'une contradiction interne, entre la personne et la personnalité... Et cette personne est toujours dominée par le personnage et plus encore par la personnalité : l'excès de Ferrante dans sa dureté envers Pedro en est la conséquence ; il fait passer sa théorie avant tout, « ce qui doit être » étant supérieur à « ce qui est »31, et donc ne supporte pas que la réalité démente l'idéal ou plutôt son idéal. Cette faille de la théorie annonce déjà sa faillite, son échec ; cet excès, en fin de compte, ressemble fort à un égotisme et un égocentrisme exacerbés. Pedro n'en est pas dupe, mais Ferrante s'en défend par une de ses pirouettes :
« Ce que vous me reprochez, c'est de n'avoir pas votre caractère. Est-ce ma faute, si je ne suis pas vous ? [...]
- Vous croyez que ce que je vous reproche est de n'être pas semblable à moi. Ce n'est pas tout à fait cela. Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. » [A. 1, sc. 3, p. 27]
Notons que Pedro se croit un être de « qualité » ; c'est ainsi que le révèle sa tirade lors de sa mise en prison :
« Ah ! J'ai été trop courageux. [...] Iñès est menacée parce que je n'ai pas eu peur. [...] C'est curieux, les hommes de valeur finissent toujours par se faire arrêter. Même dans l'Histoire, on n'imagine guère un grand homme qui ne se trouve à un moment devant un juge et devant un geôlier ; cela fait partie du personnage. » [A. 2, sc. 7, pp. 52-3]
Cette réaction surprenante est-elle due à une conception des choses personnelle, est-elle sincère, ou ne s'agit-il que de mauvaise foi, en réaction à l'humiliation qu'il subit ? En tous les cas, le contraste avec la conception de Ferrante au nom de laquelle il est puni crée un effet de ridiculisation : il le rend grotesque, et accentue l'idée de médiocrité qui lui est liée.
L'orgueil de Ferrante provient directement de sa théorie : c'est une tension, gage de verticalité et de hauteur donc de qualité, et c'est le sentiment de sa propre qualité qui nourrit l'orgueil. Là encore, se retrouve le parallèle avec l'Infante que caractérise le même excès ; car à l'absence d'amour, donc de tout apport venant d'autrui, correspond l'omniprésence de la satisfaction de soi-même, l'orgueil excessif.
Il apparaît que Montherlant a mis de son « culte du moi » dans l'exigence de soi et la satisfaction qui en résulte : dès 1916, il affirmait dans une lettre à son ami Faure-Biguet : « Dans ce fait de la supériorité, il y a quelque chose qui m’enivre ; les valeurs m'excitent comme des femmes. »32.
Pour Montherlant l'exigence dans l'idée de soi aboutit à devenir un « homme libre » ; Fongaro résume parfaitement les implications de ce culte du moi : « Une telle exaltation, fondée uniquement sur la volonté personnelle, a besoin de se soutenir par la conscience de sa propre supériorité en face de la pusillanimité des hommes ordinaires. Voilà la raison profonde de l'orgueil des héros de Montherlant. »33.
En 1936, dans Service inutile, l'auteur distingue orgueil, vanité et fierté : « La vanité, qui mène le monde, est un sentiment ridicule. L'orgueil, fondé, n'ajoute rien au mérite [...]. Non fondé, il est lui aussi ridicule. [...] A mi-chemin entre la vanité et l'orgueil, vous choisirez la fierté. ». Et dans cette pensée, le mépris ou l'estime devraient être moraux : « Le mépris fait partie de l'estime. On peut le mépris dans la mesure où on peut l'estime.[...] Ce n'est pas l'orgueil qui méprise, c'est la vertu. ». Dans la pièce, il est clair qu'il est plus question d'orgueil que de fierté de soi, et que c'est lui qui méprise autrui... De ce point de vue, La Reine morte peut être rapprochée de Fils de personne, « drame de la qualité humaine », et Ferrante de Georges Carrion qui sacrifie son fils au nom d'« une certaine morale qui est [s]ienne », « quelque chose de haut et de pur », »l'idée qu'[il] [s]e fai[t] de l'homme »... Nous allons le voir, cet orgueil sera voué à l'échec chez l'Infante comme chez Ferrante.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le personnage qui incarne l'orgueil par excellence n'est pas le Roi Ferrante, mais l'Infante de Navarre : sa jeunesse fait la force, la fougue de ce sentiment de supériorité. Les premières images que donnent d'elle ses dames d'honneur présentent cet orgueil comme la matière dont elle est faite, elle en devient l'incarnation :
« Elle est toute pétrie d'orgueil. Et c'est son orgueil que ce glaive transperce. »
« Elle est toujours crucifiée sur elle-même, et elle éparpille le sang qui coule de son honneur. » [A. 1, sc. 1, pp. 17-19]
Même si ces deux affirmations mettent sur le même plan les notions d'orgueil et d'honneur, c'est le sens de l'honneur poussé à l'excès qui fait l'orgueil de l'Infante.
L'exagération des images sanglantes de crucifixion rejoint l'excès des caractères :ainsi l'Infante s'exclame-t-elle avec conviction :
« Savez-vous que chez nous, en Navarre, on meurt d'humiliation ? »
A quoi renchérit une dame d'honneur :
« Mourir d'honneur blessé, c'est bien la mort qui convient à notre Infante. » [A. 1, sc. 1, pp. 18-19]
Notons que comme chez l’Infante, l'orgueil semble si naturel qu'il n'est pas pris comme tel ; ainsi elle affirmera, avec un aveuglement qui , s'il n'est pas aussi évident chez Ferrante, est pourtant le même :
« Oh ! Ne me croyez pas orgueilleuse : je n'ai pas d'orgueil, pas une once. Mais il n'est pas nécessaire, pour aimer les louanges, de s'en croire digne. » [A. 2, sc. 5, p. 100]
Cet orgueil ne semble avoir aucune limite, et la pousse à des propos quasi-blasphématoires :
« Si Dieu voulait me donner le ciel, mais qu'il me le différât, je préférerais me jeter en enfer, à devoir attendre le bon plaisir de Dieu. » [A. 1, sc. 1, p. 21]
La dureté de l'Infante vis-à-vis de Dieu est semblable à celle dont elle fait preuve vis-à-vis d'autrui : il ne s'agit pas d'elle-même.
Au-delà de l'orgueil, on pourrait parler d'un quasi-solipsisme34, tant la personnalité des personnages empiète sur la réalité de ceux qui les côtoient. L'analyse de l'Infante par Montherlant et par ses personnages est la même :
« Elle pense qu'elle est seule au monde à se faire une notion de l'honneur. » [A. 2, sc. 1, p. 56]
« Je sais que son Altesse souffre avec impatience tout ce qui n'est pas elle. » [A. 2, sc. 1, p. 56]
Ces paroles de don Alvar et Don Eduardo rejoignent l'affirmation de Montherlant dans La création de La Reine morte :
« Que ce soit avec Iñès ou avec le Roi, l'Infante se bat contre un monde peuplé d'êtres qui l'étonnent et l'irritent (...) » [p. 166]
S'il n'existe que soi, que l'idée de soi, les autres ne sont pas considérés... L'Infante affirme ainsi :
« Il y a deux gloires :la gloire divine, qui est que Dieu soit content de vous, et la gloire humaine, qui est d'être content de soi. » [A. 2, sc. 5, p. 96]
A partir d'un tel point de vue, toute attirance pour autrui semble une incohérence (comme l'attirance de Ferrante pour Egas Coelho mais aussi l'attirance de l'Infante pour Iñès) et cet autre, considéré sous conditions, doit répondre à ces conditions - l'idée qu'on s'est faite de lui - sous peine de provoquer l'« irritation »... Ainsi Ferrante fait temporairement emprisonner son propre fils, et l'Infante malgré un ultime revirement s'emportera contre Iñès :
« Laissez-moi croire que je puis trouver encore les mots pour vous convaincre. Penser que vous aurez passé à côté de moi ! Et moi, être l'Infante de Navarre, et échouer à convaincre ! [...]Ah ! La chose insensée, qu'un désir violent ne suffise pas à faire tomber ce qu'on désire. [...] Vous avez laissé passer le moment où je vous aimais. Maintenant, vous m'irritez. [...] Vous me décevez. Allez donc mourir, doña Iñès. Allez vite mourir, le plus vite possible désormais. Que votre visage n'ait pas le temps de s'imprimer en moi. [...] » [A. 2, sc. 5, pp. 102-4]
L'Infante perd peu à peu de vue son objet - Iñès - au profit d'elle-même, donnant l'impression que ce qui la dérange est moins la mort potentielle de la jeune femme que la perspective, l'idée de son propre échec...
La recherche de « valeurs » serait assimilée à une quête d'absolu, un idéal... La théorie de Ferrante s'assimilerait alors moins à une satisfaction qu'à une exigence sans fin, une tension qui transparaît dans certaines images :
« [La boue] cimente. En Afrique, des villes entières ne sont bâties que de boue :elle les fait tenir. » [A. 2, sc. 2, pp. 71-2]
« Un jour vous serez vieux vous aussi. Vous vous relâcherez. » [p. 72]
« O Royaume de Dieu, vers lequel je tire, je tire, comme le navire qui tire sur ses ancres! » [p. 73]
« L'arc de mon intelligence s'est détendu. » [A. 3, sc. 4, p. 118]
L'idée de tension que montrent ces images du Roi se retrouve dans une affirmation d'Egas Coelho à Ferrante qu'il veut convaincre ; pour ce faire, il fait allusion à la théorie du Roi, dont il n'ignore pas le fonctionnement :
« [...] pour trouver la pitié il n'y a qu'à se laisser aller, mais pour trouver la dureté il faut qu'on se hausse. Or, on doit toujours se hausser. » [A. 3, sc. 5, pp. 121-2]
Cette tension évoque le contrôle de soi du stoïcisme ; mais l'« homme libre » de Montherlant ressemble à l'homme « léger » de Nietzsche, qui se veut toujours plus que ce qu'il est : un surhomme, ce qui n'est jamais atteint. « [Cette] conception pousse en avant et exige sans fin. Il s'agit de dépasser impitoyablement ce qui est donné [...]. Selon Nietzsche l'homme est [...] l'être qui ne se contente jamais de ce qu'il est. Il doit continuer à s'engendrer, au-delà de ce qu'il a déjà fait de lui-même, de ce qu'il est déjà devenu en fait. Il lui faut sans cesse dépasser ce qui est déjà réalisé. Le concept du surhomme exprime donc une insatisfaction irrémédiable quant à ce qui est. »35.
Nous retrouvons chez Montherlant cette quête perpétuelle et cette perpétuelle insatisfaction ; pour lui « ce qui est » a une importance très grande - on en veut pour preuve la fameuse locution latine chère à l'auteur, quod est -, équivalente à ce qui « doit être »... Et son idéal de tension rejoint cette volonté de dépassement, cette force que Nietzsche a appelée « volonté de puissance » dans sa métaphysique ; n'oublions pas que c'est justement lui qui a introduit en philosophie le terme de « valeur »36... Mais c'est l'ambiguïté qui rapproche peut-être le plus Montherlant de Nietzsche, pour lequel « l'homme inspiré par la volonté de puissance voit grandir sa liberté, son orgueil. Il en appelle à ce qui tend à la grandeur, à la noblesse, à ce qui dans l'homme rejette les compromis commodes de la vie médiocre et les petites satisfactions. Nietzsche détruit pour ainsi dire le Christ crucifié, symbole pour lui de tout ce qu'il déteste dans l'être humain :la faiblesse, la soumission [...]. Mais, d'autre part, on trouve chez Nietzsche des passages pleins d'admiration pour la personnalité du Christ, des passages où il célèbre la pitié, la douceur, l'humilité, l'amour. La faiblesse, chez lui, n'est pas toujours le contraire de la volonté de puissance. Il semble même que dans des cas-limites, la volonté de puissance puisse coïncider avec la plus extrême faiblesse, notamment lorsque celle-ci n'est pas un effet de la lâcheté, mais une attitude voulue, délibérée. « 37.
Nous allons retrouver dans La Reine morte ce paradoxe au sujet de la faiblesse ; mais plutôt que d'assimiler le « culte du moi » au concept du « surhomme », peut-être vaut-il mieux voir dans leur ambiguïté le plus grand parallèle entre les deux auteurs, et en même temps ce qui conduit à l'impossibilité, à l'échec...
Chez Ferrante également, l'intolérance excessive vis-à-vis d'autrui, entraîne le même sentiment d'un échec personnel : c'est sa théorie, l'application de sa théorie, donc lui qui échoue dans son rapport à Pedro :
« Il me donne honte de moi-même :d'avoir cru jadis à mon amour pour lui, et de n'être pas capable d'avoir cet amour. » [A. 2, sc. 3, p. 82]
Déjà au début de la pièce, Ferrante faisait mention d'un sentiment de honte :
« J'ai honte. Je ne veux pas que mon fils sache ce qu'il peut sur moi, ce que ne pourrait pas mon plus atroce ennemi. [...] pourquoi suis-je forcé de pâtir à cause de lui, alors que je ne l'aime pas ? » [A. 1, sc. 2, p. 24]
A nouveau, tout est lié : la honte est elle-même honteuse parce qu'elle devient une preuve de vulnérabilité, de faiblesse, ce qui est intolérable dans sa théorie...La faiblesse de la théorie appliquée par Ferrante devient une faiblesse de la théorie appliquée à Ferrante. Nous pouvions pourtant penser, du fait de l'exigence et de la dureté extrêmes de Ferrante envers autrui, qu'il était l'incarnation exacte de ce qu'il prône, le strict contraire de ce qu'il condamne. Mais nous allons le voir, il n'y a pas coïncidence exacte entre ce que Ferrante prône et ce qu'il est.
La théorie appliquée par Ferrante s'avère donc plus importante à ses yeux que les êtres auxquels il l'applique, puisque son attirance ou sa répulsion pour eux est fonction des critères qui les constituent, et des principes qu'ils incarnent. Mais Ferrante n'est pas pour autant aisément identifiable par la grille de sa propre théorie : il n'incarne pas strictement ses propres principes ni ne répond exactement à ses propres critères, il n'est pas l'application absolue de sa théorie ; sa personnalité « réelle » ne coïncide pas avec sa personnalité idéale, ou plutôt idéalisée...Nous voyons que déjà se profilent d'autres questions concernant de près son identité, à aborder ultérieurement : Ferrante a-t-il pleine conscience de cette nouvelle dualité, s'en aperçoit-il ? Le veut-il ? Et le peut-il ?38
Pour l'instant, nous voici à nouveau confrontés à la complexité de Ferrante. Déjà la multiplicité des images qui se rapportent à lui et la diversité de leur nature le montrent39. Notons que si quelques images sont développées par d'autres personnages - celles du « lion » et du « taureau » par l'Infante, et celle de la « statue » par Pedro -, toutes les autres le sont par lui-même, et il usera aussi des deux images animales.
Voyons toutes les images de Ferrante qui sont classées dans notre tableau ; quantitativement, le Roi est d'abord comparé au monde animal, à travers neuf images différentes :
comme l'Infante, au taureau, symbole de force et de virilité, mais aussi de dureté :
« [Mes Grands] sont acharnés après moi comme les chiens après le taureau. » [A. 2, sc. 3, p. 78]
« ...c'est à la fin du combat de taureaux que le taureau est le plus méchant. » [A. 2, sc. 5, p. 92]
au lion, autre symbole de force mais plus associé au pouvoir royal donc à la grandeur :
« Les princes mettent des lions sur leurs armoiries, sur leurs oriflammes. Et puis un jour ils en trouvent un dans leur cœur. [...] Et avec cela les yeux lourds des lions. Le Roi souffre de bientôt mourir. » [A. 2, sc. 5, p. 92]
« Les Rois ont des lions dans le cœur... » [A. 3, sc. 6, p. 130]
« Je suis comme un lion tombé dans une trappe. Je puis mordre, bondir, rugir... » [A. 3, sc. 4, p. 117]
dans la même idée, à l'aigle, qui y ajoute les notions de verticalité, de hauteur et de profondeur, de lumineux, et dont le « champ d'action », le ciel, le lie au critère du mol (l'aérien) :
« Il ne faut pas être dans la mauvaise foi comme un poisson dans l'eau, mais comme un aigle dans le ciel. » [A. 2, sc. 1, p. 57]
« Bientôt mon âme va toucher la pointe extrême de son vol, comme un grand aigle affamé de profondeur et de lumière. » [A. 2, sc. 3, p. 77]
au chat, qui n'incarne pas la grandeur comme le lion, mais les critères du mâle, du fort et du dur :
« On escompte que[...]souris ici, pour me revancher, je me ferai matou là. » [A. 3, sc. 6, p. 124]
« Si [Ferrante] vous taquine, c'est sans doute qu'il vous aime, au contraire. Le chat laisse toujours une marque à son ami. » [A. 3, sc. 2, p. 114]
au serpent, symbole de verticalité et de virilité, mais aussi associé au critère du lumineux :
« Je suis comme les autres :il arrive que je voie un serpent darder hors de moi sa tête brillante. » [A. 2, sc. 3, p. 79]
aux lucioles, qui associent l'obscur au lumineux :
« Il dit que [les lucioles] lui ressemblent :alternativement obscures et lumineuses, lumineuses et obscures. » [A. 3, sc. 2, p. 115]
au cerf, incarnant le seul principe de la grandeur :
« C'est un Roi de douleur qui vous fait ce grand brame de cerf dans la forêt. » [A. 3, sc. 1, p. 110]
au coq et à la poule ; le coq, élément mâle que l'on peut associer aux critères du malade et du vide, et la poule, élément femelle dont les œufs l'associent aussi au critère du vide :
« Mon cœur [...] se désordonne et palpite comme un coq qu'on égorge. » [A. 1, sc. 2, p. 23]
« J'étais comme une vieille poule qui pondrait des coquilles vides... » [A. 3, sc. 6, p. 127]
Il est aussi comparé au monde végétal, avec l'image de l'arbre, image récurrente de la verticalité, de la grandeur, de la hauteur, de la force et de la dureté, mais aussi de l'obscurité :
« [Mes ministres]sont là à vivre de ma vieille force comme un plant de lierre d'un tronc d'arbre rugueux. » [A. 2, sc. 3, p. 75]
« Je suis comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre à des centaines de milliers d'êtres. » [A. 1, sc. 5, p. 46]
« Un Roi est comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre... » [A. 3, sc. 8, p. 146]
Notons que cette image, si elle est répétée presque mot pour mot par Ferrante, a pris un sens très différent à la fin de la pièce : d'une image de protection, nous sommes passés à une image de mort... Qui, mêlant à l'idée de verticalité celle de noirceur (la noirceur comme absence de lumière) se retrouvera également dans la bouche d'Iñès, tragiquement :
« Seigneur, la gloire des grands hommes est comme les ombres :elle s'allonge avec leur couchant. » [A. 3, sc. 1, p. 109]
Ferrante est également comparé à la forêt, qui développe les mêmes significations, le mot « broussailles » suggérant la densité et la pénombre (voir plus bas).
Outre le végétal et l'animal, Ferrante est comparé aux quatre éléments, si l'on considère qu'il y comparaison à « l'eau de la mer » par contraste avec Pedro, « eau peu profonde »40, et par assimilation à d'autres images de la profondeur, par exemple :
« A l'heure la plus profonde de la nuit, profonde comme le point le plus profond du creux de la vague, couché dans la poussière de l'orgueil. » [A. 3, sc. 1, p. 108]
la montagne, image de la verticalité et de la hauteur, se rattache à la fois au critère du plein et à celui du dur :
« ...je suis pour moi-même la forêt et la montagne. Mes âmes enchevêtrées sont les broussailles de la forêt, et j'ai dû, puisque j'étais Roi, me faire de ma propre pensée un haut lieu et une montagne. » [A. 3, sc. 2, p. 110]
le feu, la flamme, symboles du lumineux au sein de l'obscur, de la force, et également du mol (l'impalpable) :
« Voilà une heure que vous tournaillez autour de moi, comme un papillon autour de la flamme. » [A. 3, sc. 6, p. 141]
enfin l'air, le vent, par excellence symbole du mol (l'aérien), se rattache au critère du vide, et à celui du fort :
« Je me suis écoulé comme le vent du désert, qui d'abord chasse des lames de sable pareilles à une charge de cavaliers, et qui enfin se dilue et s'épuise : il n'en reste rien. » [A. 3, sc. 4, p. 119]
Enfin, Ferrante est comparé au monde des choses, à des objets :
à une armure, symbole vertical de dureté et de force, mais rattaché au critère du vide :
« [...] comme cette armure vide de la légende, qui, dressée contre le mur, ... » [A. 3, sc. 6, p. 125]
« Je ne suis plus dans mon armure de fer. » [A. 3, sc. 6, P ; 128]
à une échelle, qui correspond au principe de verticalité :
« ... l'échelle de l'enfer aux cieux. Moi, toute ma vie, j'ai fait incessamment ce trajet ;tout le temps à monter et à descendre, de l'enfer aux cieux. » [A. 3, sc. 6, p. 142]
à une statue, qui comme l'armure symbolise verticalité et dureté et pourtant ne se rattache pas au plein, mais au mol (fluide) :
« Mais vouloir définir le Roi, c'est vouloir sculpter une statue avec l'eau de la mer. » [A. 2, sc. 5, p. 90]
Les images, à elles seules, montrent la complexité du personnage ; mais leur classement fait apparaître une nouvelle dualité de Ferrante, puisqu'il n'incarne pas exactement la « qualité » au sein de sa théorie dualiste.
Nous avons classé les images de Ferrante de façon cohérente par rapport à sa théorie : les images sont entre parenthèses quand les citations ne montrent pas directement, explicitement leur(s) lien(s) avec un principe ou/et un critère(par exemple, l'image de l'aigle se trouve entre parenthèses dans le principe de verticalité et dans le critère du fort, et sans, notamment, dans le principe de profondeur et dans le critère du lumineux, parce que la citation l'exige.).
Ces images peuvent donc être directement ou non liées à des principes et/ou critères auxquels la logique, du moins une logique autre, ne les rattacherait pas ; et inversement (par exemple l'image de la luciole ne se trouve ni dans le principe de verticalité ni dans celui de petitesse, parce que son intérêt strict est d'incarner les seuls critères du lumineux et de l'obscur...).
Ainsi certaines images sont absentes du tableau, dans lequel elles ne seraient pas cohérentes : il s'agit de l'image du « bébé » - « Mon père dit du Roi Ferrante qu'il joue avec sa perfidie comme un bébé joue avec son pied. » [A. 2, sc. 5, p. 94] - à laquelle le personnage est comparé et directement associé, mais qui n'est pas réellement représentative de lui : ce que veut signifier l'Infante et dont nous discuterons ultérieurement est sans rapport avec les critères du sain et du jeune ; inversement l'image de l'« échelle » - que nous avons déjà citée - est une image représentative du personnage, qui n'est pourtant pas directement comparé et associé à elle.
Au sein du tableau, nous constatons que les images de Ferrante se répartissent dans les critères de « qualité » et ceux de « médiocrité ». Ainsi nous trouvons plusieurs égalités quantitatives :
l'image du lion incarne le grand et le fort, mais aussi le vieux et le malade ; la luciole incarne le lumineux et l'obscur, et l'eau le profond et le mol. Doit-on considérer que ces critères de valeur opposée s'annulent deux à deux ?
Car il se trouve plus d'inégalités dans les images dont les critères majoritaires sont ceux de la qualité ; seules deux images incarnent deux critères de médiocrité « contre » un de qualité, c'est le coq (il incarne le mâle, contre le malade et le vide) et le vent (qui incarne le fort contre le mol et le vide) ;nous donnons les autres dans un ordre croissant :
- deux critères de qualité contre un seul de médiocrité :la flamme (elle incarne le vertical et le fort, contre le mol) et la statue (le vertical et le dur, contre le mol) ;
- trois critères contre un seul : le taureau (il incarne le mâle, le fort et le dur, contre le vieux) ;
- quatre critères contre un : l'armure (elle incarne le vertical, le mâle, le fort et le dur contre le vide) ;
- six contre deux : l'arbre(il incarne le vertical, le haut, le grand, le fort, le dur et le plein, contre l'obscur et le vieux), et la forêt ;
- enfin sept critères contre un seul : c'est l'aigle (il incarne verticalité, hauteur, profondeur, et le fort, le mâle, et le lumineux, contre le mol).
Enfin, cinq images ne se rattachent qu'à des critères de qualité : la montagne, qui en incarne quatre (le vertical, le haut, le dur et le plein), le serpent et le chat qui en incarnent trois (respectivement le vertical, le mâle, le lumineux, et le fort, le mâle et le dur) enfin l'échelle et le cerf qui en incarnent deux (le vertical et le grand, et le mâle et le grand).
Et une seule image se rattache uniquement à des critères de médiocrité, au nombre de trois : la poule (qui incarne le femelle, le vieux et dont les œufs incarnent le vide).
C'est un constat évident : si les images de Ferrante n'incarnent absolument aucun principe condamné dans sa théorie (il n'y a rien en haut à droite dans le tableau), il n'en va pas de même avec les critères qui les déterminent : certes une grande majorité de ces critères est « positive » (quarante-cinq occurrences dans la colonne de gauche dont vingt-sept dans les critères, et dix-huit seulement dans celle de droite), mais si Ferrante correspondait à son propre idéal, s'il coïncidait avec sa personnalité telle qu'il l'affirme, il ne devrait rien y avoir à droite dans ce tableau.
Stéphan résume bien cette dualité : « Ferrante est essentiellement représenté par des animaux de prestige royal, à la fois puissants et nobles. Il a le vol de l’aigle, le brame du cerf, la fierté du coq, la dignité du taureau ou du lion […] les animaux royaux qui représentent Ferrante ne sont pas dans la plénitude de leur force ; ils sont atteints, blessés, au seuil de la mort : le cerf fait un brame de souffrance ; le taureau est poursuivi par des chiens ou parvenu à la dernière phase de la corrida ; le lion a les yeux lourds, il est tombé dans un piège ; le coq est égorgé. »41.
C'est là une faille du « système » de Ferrante ; car si la faiblesse, condamnée chez lui, est pour une part due aux circonstances naturelles et inévitablement indépendante de sa volonté, hors de son contrôle (affaiblissement de la vieillesse et de la maladie)42, il n'en va pas de même en ce qui concerne, notamment, le critère de l'obscur et plus encore celui du vide. Il s'agit d'une observation cruciale dans notre recherche de l'identité de Ferrante, car cette faille est pour beaucoup dans la complexité du personnage43.
En effet s'il y a faiblesse chez Ferrante, il y a forcément volonté de la pallier et/ou de la masquer, puisqu'elle est condamnable dans sa théorie... A une dualité théorique répond une dualité « pratique », observable dans le comportement du Roi : c'est l'ambivalence qui le fait agir.
Il est ici nécessaire d'établir un parallèle avec la pensée de Montherlant, car la dualité, l'ambivalence de Ferrante semblent bien correspondre à ce que l'auteur appelle le « syncrétisme et l'alternance » (il s'agit du titre d'un essai qui précède Aux fontaines du désir, datant de 1927.) : « L'univers n'a aucun sens, il est parfait qu'on lui donne tantôt l'un et tantôt l'autre. ». Déjà dans les Olympiques étaient présents ce « syncrétisme » - cette volonté de « garder tout en composant tout » : « bonheur, souffrance, candeur, souillure, sagesse, folie, tout m'appartient et je veux tout avoir, car tout m'est bon, si rien ne me l'est assez » - et cette « alternance » – « faire alterner en soi la Bête et l'Ange, la vie corporelle et charnelle et la vie intellectuelle et morale »... Le syncrétisme, c'est-à-dire le cumul, est évidemment moins facile à appliquer que l'alternance, mais ces deux attitudes se basent sur une même donnée, l'équivalence de toutes choses : « Si le monde n'a aucun sens, comme il est évident pour nous, tenir avec lui les conduites les plus différentes est le seul parti raisonnable. C'est l'équivalence. Et comme on ne peut les tenir toutes à la fois, il faut alterner. », résumera Montherlant dans Va jouer avec cette poussière...44 Le lien entre la pensée de l'auteur et la théorie de Ferrante est ici évident : « L'alternance, c'est le principe du dualisme. »45.
Mais attention : celui qui a pensé « Qu'il y ait eu dans notre vie une heure seulement de plaisir intense et il n'y a pas de Néant. » ( dans Aux fontaines...), est le même qui avouait ( dans ses Carnets XXX ) : « Je me demande si la pensée grecque n'avait pas raison de tenir l'alternance pour l'équivalent du Néant. ». Il n'est pas ici question de refuser l'idée du Néant, simplement de la combattre. Peut-on rapprocher cette attitude de celle, ambivalente, du personnage ? Si tel est le cas, on mesure alors tout l'enjeu de sa théorie, et surtout on commence à entrevoir la mesure d'un échec dans de telles conditions... Il convient pour l'instant de se pencher sur le comportement du personnage, avant de se pencher sur ses conséquences.
L'ambivalence est donc l'expression de sentiments contraires - sinon contradictoires -, que nous avons constatés chez Ferrante en ce qui concerne les « fonctions » royale et paternelle ; Ferrante peut ressentir donc affirmer une chose et son contraire, sans problème apparent.
L'exemple peut-être le plus flagrant de la pièce est celui d'un moment de grande humilité chez ce personnage d'orgueil :
« Telles sont les pensées profondes dont vous fait part le Roi Ferrante, pensées profondes dont cependant il ne garantit pas l'originalité. Car j'entendais un jour, en passant dans un couloir près d'une cuisine, un gâte-sauce qui proclamait avec des gestes emphatiques : »La culbute finale, tous, il faudra qu'ils y passent, oui, tous ! Le Roi comme les autres! ». Et j'ai approuvé qu'au bout de ma philosophie je trouve un valet de cuisine. Nous nous rencontrions plus tôt encore qu'il ne le disait. » [A. 3, sc. 4, p. 119]
Cet exemple montre bien que l'ambivalence présuppose l'équivalence ; ici, il y a par dérision équivalence entre Ferrante et son cuisinier, ce qui lui permet de faire preuve de modestie en même temps que d'orgueil.
Mais un paradoxe surgit ici : l'ambivalence présuppose l'équivalence des notions mises en balance, alors que d'après lui « qualité » et « médiocrité » sont des notions définitivement opposées et donc ne s'équivalent jamais...
Cela expliquerait le comportement d'alternance ou de syncrétisme chez le roi : il s'agirait de ne pas être uniquement dans la « médiocrité » si l'on ne peut être uniquement dans la « qualité »_
L'alternance chez Ferrante est symbolisée par la seule image des « lucioles », dont le page explique à Iñès qu'il aime à se comparer :
« Il dit qu'elles lui ressemblent : alternativement obscures et lumineuses, lumineuses et obscures. » [A. 3, sc. 2, p. 115]
L'insistance du répétitif rythme binaire montre assez combien la « fluence »46 du Roi est une de ses caractéristiques essentielles... C'est la même alternance dont il fait preuve envers son fils, passant tout au long de la pièce d'évocations de Pedro où la tendresse prédomine aux dialogues où sa dureté prend le pas sur toute autre attitude... Les didascalies lors de la première scène où nous les voyons confrontés sont à cet égard explicites :
« Embrassons-nous, si vous le désirez. Mais ces baisers entre parents et enfants, ces baisers dont on se demande pourquoi on les reçoit et pourquoi on les donne...
[Pedro, qui avait fait un pas vers son père, s'arrête court.]
- En ce cas, inutile.
[Ferrante, soudain dur.]
- Vous avez raison : inutile. » [A. 1, sc. 3, p. 34]
Les sentiments ou attitudes chez Ferrante peuvent ainsi changer très vite, s'accentuer ou s'affaiblir mais surtout varier d'un extrême à un autre, parfois en se cumulant dans le temps ou dans un même instant : le syncrétisme apparaît finalement comme une alternance sans prise en compte du temporel.
Ce syncrétisme chez Ferrante est résumé par les deux comparatifs qu'il s'attribue dans un rêve morbide, laissant penser qu'ils le définissent lui-même comme des superlatifs :
« J'écrivais sur ma peau, et elle était si pourrie que la plume par endroits la crevait.
- Et qu'écriviez-vous?
- J'écrivais : « Bien meilleur et bien pire... ». Car j'ai été bien meilleur et bien pire que le monde ne le peut savoir. » [A. 3, sc. 1, p. 109]
Cette phrase est parmi les dernières prononcées par le Roi au moment de mourir, elle est donc répétée à un autre moment symbolique de vérité, où il reconnaît son incohérence. Pourtant Ferrante dans cette conception même ne reste pas cohérent, dans la mesure où il ne l'applique qu'à lui : il a des moments de bonté, des moments contraires, mais il est seul à les conserver comme représentatifs de ce qu'il est en les cumulant. En effet, sa distinction de moments différents chez d'autres ne l'amène jamais à une synthèse dans l'idée qu'il se fait d'eux :ainsi, anticipant au vu de sa propre expérience parentale la déception que causera son enfant à Iñès, il lui déclare :
« Sa pureté n'est qu'un moment de lui, elle n'est pas lui. » [A. 3, sc. 6, p. 137]
Il ne s'agit donc pas simplement d'une perception de la durée particulière ;ce sont certains moments d'un être et cet être qui sont distincts, et non seulement ses moments qui le sont. Jamais Ferrante ne considère son fils comme un individu de qualité et de médiocrité au nom de ce qu'il a pu être : ce qu'il a été n'est pas pris en compte dans son jugement sur ce qu'il est, au contraire_
Le problème pour déterminer l'« identité psychologique » de Ferrante est que la « personne » réclame la cohérence d'une conduite unifiée ; lui sont nécessaires une unité (dans l'espace) en même temps qu'une identité (dans le temps, justement)...
Le comportement de Ferrante est-il dû à de la mauvaise foi ? Ferrante se définit souvent sans se définir, en usant de véritables « pirouettes », nous l'avons vu ; de plus, l'équivalence chez lui semble souvent seulement théorique :
« Regardez ce printemps. Comme il est pareil à celui de l'an dernier ! [...] Pour moi tout est reprise, refrain, ritournelle. [...] Cela où j'ai réussi, cela où j'ai échoué, aujourd'hui tout a pour moi le même goût. Et les hommes, eux aussi, me paraissent se ressembler par trop entre eux. » [A. 2, sc. 3, pp. 76-7]
Peut-être est-ce au contraire l'expression d'un idéal de pure sincérité, de la prise en compte de chaque sentiment successif, qui conduit Ferrante à l'incohérence ; nous savons qu'il établit des distinctions extrêmement précises entre les individus, et que pour lui Pedro et l'Infante, pour ne citer qu'eux, ne se « ressemblent » absolument pas... Cette incohérence, mauvaise foi ou non, vient à notre sens uniquement de l'absence de distinction entre Bien et Mal dans sa théorie ; les images qui montrent cette non-distinction rendent ainsi l'incohérence de la théorie qu'il applique : par exemple, dans deux affirmations de connotations contraires, positive puis négative, Ferrante use d'images qui se rattachent toutes deux au principe de la verticalité, pour le bon et le mauvais :
« Si, je suis bon quand il me plaît. Sachez que parfois le cœur me vient dans la bouche, de bonté. » [A. 1, sc. 3, p. 33]
« Je ne suis pas bon, mettez-vous cela dans la tête. [...] il arrive que je voie un serpent darder hors de moi sa tête brillante. » [A. 2, sc. 3, p. 79]
A l'échelle de la pièce se retrouve la même confusion, puisque l'image a priori négativement connotée du « serpent » se retrouve associée à Iñès, personnage, si l'on peut dire, « connoté » positivement par l'amour qui la caractérise :
« Où que [Pedro] soit, je me tourne vers lui, comme le serpent tourne toujours la tête dans la direction de son enchanteur. » [A. 1, sc. 5, p. 45]
De même, l'image du « chat » pose problème pour caractériser Ferrante parce qu'employée deux fois dans la pièce, par Ferrante et par Iñès, elle est différemment connotée :
« Si [le Roi] vous taquine, c'est sans doute qu'il vous aime, au contraire. Le chat laisse toujours une marque à son ami. » [A. 3, sc. 2, p. 114]
« On escompte que [...]souris ici, pour me revancher je me ferai matou là. Et matou contre qui ? Contre Pedro et vous. » [A. 3, sc. 6, p. 124]
Nous nous trouvons donc par moments devant deux images connotées différemment mais mises en parallèle, ou devant deux images connotées identiquement mais opposées par la voix des personnages... Les contradictions viennent-elles de ces voix, ou peut-on imaginer qu'au-delà de Ferrante c'est Montherlant qui, comme dit l'Infante, fait tout « afin de brouiller ses traces »47? N'insistons pas ; Montherlant s'est trop défendu de prêter ses idées à un seul personnage pour que nous voulions le prétendre...
Nous le voyons à présent, l'incohérence de Ferrante pour évidente qu'elle semble ne l'est pas ; la faille de sa théorie pose déjà le problème des actes, et surtout celui de l'exécution d'Iñès...
Tout ce que nous pouvons discerner de l'identité psychologique du personnage est qu'elle se fait l'écho d'une théorie qui serait en partie au moins celle de l'auteur ; théorie que, de toute façon, Ferrante n'incarne que partiellement... Sa personnalité ne reflète toujours pas l'unité nécessaire pour trouver son identité globale, au contraire : nous débouchons sur une « double dualité », une dualité dans la dualité...
Sur le plan théâtral, ces contradictions et non-coïncidences répétées, cette dualité complexe font pour beaucoup la dimension tragique du personnage ;Ferrante évoque « l'orgueilleuse faiblesse » d'Agamemnon dans l'Iphigénie de Racine ; même, n'est-il pas à lui-même une « obscure clarté », à moins qu'il n'existe dans La Reine morte une fatalité comparable à celle du Cid de Corneille ? Enfin, y a-t-il une identité théâtrale de Ferrante?
En axant notre réflexion sur l'identité sociale puis l'identité psychologique de Ferrante, nous avons dû tenter des distinctions entre les termes de personnage et de personne, de personne et de personnalité ;mais ces notions restant en l'occurrence indistinctes, nous allons en étudier les conséquences sur le plan théâtral...en revenant donc au simple terme de personnage, pour chercher à déterminer l'identité théâtrale de Ferrante :Ferrante est un personnage, mais est-il un héros ? Et quel héros ? Est-il sublime, ou au contraire pathétique?
Ferrante n'est pas le héros éponyme de la pièce, puisque son titre, La Reine morte, met en lumière le personnage d'Iñès :ce titre s'inspire de celui de la pièce de Guevara que Montherlant a complètement remaniée, mais dont il a gardé la trame : Régner après sa mort48.
Pourtant, il suffit de connaître cette trame pour lire non plus « La Reine morte », mais « la Reine assassinée »... Cela suppose évidemment la présence de Ferrante, l'assassin. De la même façon le sous-titre que Montherlant finit par enlever, « Comment on tue les femmes », sans nommer Ferrante lui accorde pourtant plus d'importance :le nom en est caché derrière ce pronom personnel vague, mais il est cette fois sujet de la proposition, tandis que le personnage d'Iñès est plus que caché, fondu dans un nom générique, qui plus est curieusement au pluriel.
Si Ferrante obtient en dépit du titre le statut de « héros » de la pièce, c'est parce qu'il en est le personnage le plus important, le personnage dit principal :et cette importance est quantitative, mais aussi qualitative.
Quantitativement, Ferrante est omniprésent : sur les vingt scènes de la pièce, Ferrante est présent dans quinze : cinq scènes sur sept au premier acte (la scène 4 correspond au second tableau et présente le couple Pedro - Iñès, et la 7 montre Pedro aux prises avec don Christoval) ; trois scènes sur cinq au second acte (la structure est la même : le second tableau correspond aux deux dernières scènes, qui montrent le couple Pedro - Iñès puis l'Infante - Iñès) ; enfin le troisième acte, qui "s'épanouit en une ombelle abondante"49, voit Ferrante présent dans sept scènes sur huit (l'exception étant la scène pendant laquelle Iñès renonce à interroger le page)...
Et, ce n'est guère étonnant dans ces circonstances, le Roi concentre à lui seul plus de la moitié de l'ensemble des dialogues de la pièce50 - sans parler de tous les propos d'autres personnages à son sujet... (voir page suivante le tableau II de Stéphan Andrée prouvant l'importance des images, consacrées à Ferrante pour l'essentiel, comparativement aux autres pièces de Montherlant.).
Qualitativement, c'est aussi le personnage le plus riche : bien sûr le plus complexe : citons son double aspect, dont nous avons vu que lui-même se subdivisait encore : il est le personnage le plus incohérent, plus que l'Infante malgré leur parallèle : Montherlant le répète, « il est ce que nous sommes tous, mais en tons très poussés », son « clair-obscur » est celui « de tous les êtres, mais poussé à un point extrême chez le Roi »51...
Les critiques n'ont de cesse d'insister sur son importance, au point qu'elle « a même tendu à concentrer tout l'intérêt de la pièce dans ce seul personnage »52 :
pour Blanc, quelque riches et intéressants que puissent être les autres personnages, La Reine morte a pour centre l'étrange et complexe figure du roi »53 ; pour Perruchot, « ce caractère du roi Ferrante est, à coup sûr, dans sa magnétique désolation, l'une des plus extraordinaires créations du théâtre de tous les temps. »54 ; « Qui est ce Ferrante ? »,
demande Robichez, ajoutant que « le spectateur commence à entrevoir à la fin de l'acte I que la pièce n'a pas d'autre sujet que cette question. »55.
L'auteur lui-même exprime cette importance : « Toute la pièce est dominée par la figure du roi Ferrante, qui grandit à chaque acte[...] », la « ligne d'action dramatique » correspond à une simple question : « par où Ferrante en viendra-t-il à tuer Iñès ? »56.
Pourrait-on lui attribuer le statut de héros en voyant dans la pièce, comme Banchini, un thème de l'héroïsme lié à celui du sacrifice ? En considérant, avec Perruchot, qu'un héros est « un homme qui sanctionne sa générosité ou son honnêteté par un acte cruel pour lui-même »57.
Il nous faudrait vérifier si le sacrifice, la mort d'Iñès, a ceci de comparable avec la mise en prison de Pedro qu'il lui est douloureux, et qu'il est lié à son sacrifice à lui...
Pourrait-on avancer que Ferrante est le héros de La Reine morte de par le parallèle que nous avons commencé de voir entre lui et Montherlant ? Car si ce dernier s'en défend le plus souvent, la proximité de l'auteur et de son personnage est indéniable : évidemment le dramaturge est partout et nulle part, en chaque personnage ; mais il dit de Ferrante qu'il est « pétri de moments de moi »58, son rôle est un « alliage bizarre de votre moi le plus intime et d'une personnalité autre que la vôtre »59... Admettons que l'auteur soit « chacun d'eux » et aucun, masqué par ses personnages comme Ferrante l'est par son incohérence : il nous semble que c'est là leur plus grand parallèle. De toute façon, Montherlant peut explicitement désavouer un de ses « héros », comme par exemple Carrion ( non dans Fils de personne, mais dans Demain il fera jour.).
Ferrante n'est pas seulement un personnage de la pièce, il en est le personnage principal, et cela est assez pour le qualifier de héros. Mais héros de quoi ? Il nous faut préciser la nature de la pièce : La Reine morte est une tragédie.
Certes ce genre a théoriquement disparu depuis le dix-huitième siècle, et l'on pourrait qualifier la pièce de drame ; Montherlant qualifie ses pièces tantôt de tragédies, tantôt de drames... Ainsi, dans ses Notes de 1948 sur Fils de personne, La Reine morte devient « essentiellement le drame de l'amour maternel et paternel »60, alors qu'en 1954 il dira de Ferrante que « sa tragédie est celle de l'homme absent de lui-même »61...
Cette différence de termes n’est en fait pas essentielle, d’autant que La Reine morte possède un aspect double : certains de ses thèmes la rattachent au drame contemporain : le thème de la famille et des liens entre ses membres, proche du thème de l'exigence dont les individus font preuve (thème repris et traité exclusivement dans Fils de personne et sa suite, Demain il fera jour) ; on y trouve celui de la cruauté, que Montherlant traite sous un angle essentiellement psychologique ;enfin le thème de l'absurde, mais Montherlant l'incorpore à une vision du monde particulière, sur laquelle nous nous pencherons ensuite. Ses pièces font la part belle à la réflexion, et ce au détriment de l'action même (du drama) ; sa sensibilité est classique le plus souvent, sa volonté d'exprimer les mouvements de l'âme humaine aussi - même si l'absence de cohérence est chez ses personnages caractéristique ; dans son théâtre se croisent des personnages au sens de l'honneur racinien, et austère le plus souvent (rappelons que Racine était janséniste ; le ton pris par Montherlant pour Port Royal ou Le Maître de Santiago peut être considéré comme tel.), à l'envergure shakespearienne (Montherlant n'hésite pas à qualifier Ferrante de « terrible Roi Lear » dans En relisant..., p.174.), et confrontés à des choix qui les supplicient tels les grands dilemmes cornéliens... D'ailleurs dans La Reine morte, on peut considérer que « l'univers des sentiments [est] opposé de manière cornélienne à l'intrigue politique, montrant cette fois des hommes et non plus des citoyens »62.
Mais l'élément classique décisif que l'on retrouve dans chaque pièce de l'auteur, même celles dites « en veston » qui ont un cadre contemporain, est celui d'une force, non pas toujours explicitement extérieure aux personnages, mais pourtant indépendante d'eux et à laquelle ils sont soumis :la Fatalité.
Fatalement, l'univers de la tragédie est là : la pièce est une pièce « en pourpoint » : l'image à laquelle l'auteur la compare est celle d'un « poignard au manche damasquiné, noir et or »63.
C'est là l'image de la mort, et de la mort violente... Et en effet, si le meurtre se produit hors-scène, nous pouvons néanmoins parler d'une présence du sang, dans la violence ou plutôt dans la cruauté (et étymologiquement, « cruor » signifie « sang ») des images qui traversent toute la pièce et notamment celles qui l'ouvrent :
"Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire." [p. 17.]
Ces images sanglantes, qui seront répétées au fil de la pièce, prennent d'emblée une résonance tragique : elles constituent à la fois l'annonce de l'échec des personnages dans leur combat intérieur, et la préfiguration de la mort dans leur combat « extérieur ». De fait, c'est cette notion de combat qui nous montre que nous sommes dans un univers tragique. Et cette notion se retrouve, bien plus que dans l'image du poignard, dans la comparaison de la pièce à une corrida.
Nous avons vu que Ferrante comme l'Infante étaient comparés aux "taureaux" ; pourtant c'est Iñès qui est mise à mort, sacrifiée ; et c'est Ferrante qui la tue... Il y a là double indétermination : indétermination quant à la nature des combattants, et indétermination quant à l'issue du combat tauromachique, la première amplifiant la seconde : Ferrante est-il le taureau ou le torero ? De toutes les façons, l’indétermination inhérente au combat mime le suspense théâtral : c'est un combat à mort, et dans le meilleur des cas, l'un des deux protagonistes au moins doit mourir...
L'univers de La Reine morte est donc bien un univers tragique, puisqu'il est traversé par les images du combat, du sang, de la mort : nous atteignons là à la notion fondamentale de Fatalité. Car il y a une fatalité dans la pièce ; avant d'être nommée, elle est sentie : c'est le poids de cette fatalité qui s'exprime chez les personnages à travers leur peur , et la peur est omniprésente dans la pièce... Car "tous les personnages vivent dans la peur."64.
Cette peur est assez souvent « directe », précise, chez certains personnages comme Pedro, notamment, mais aussi Egas Coelho :
Pedro redoute tant la colère de Ferrante qu'il lui cache les réelles raisons de son refus d'épouser l'Infante :
« Jugez-moi sévèrement : je n'ai osé lui avouer ni que nous étions mariés, ni que ce mariage allait faire en vous son fruit. Sa colère m'a paralysé. » [A. 1, sc. 4, p. 35]
« Je crains tout pour Iñès. » [A. 1, sc. 7, p. 52]65
Les conseillers et notamment Egas sont toujours dans la peur de déplaire au Roi et d'en payer les conséquences :
« Il y a deux coupables :l'évêque de Guarda et doña Iñès.
- Et don Pedro. Je n'aime pas votre crainte de le nommer. » [A. 2, sc. 1, p. 60]
Ainsi cette peur de Ferrante va devenir peur du nouveau Roi, à la fin de la pièce :
« Ne mourez pas, au nom du ciel ! [Bas] Pedro Roi, je suis perdu. [...] Vous me laissez en enfer. Mais non, vous n'allez pas mourir, n'est-ce pas ? [...] Non ! Non ! Ce n'est pas possible ! [...] Non !Non !Non ! » [A. 3, sc. 8, pp. 146-7]
Pedro, peut-être pour rassurer Iñès, affirme l'omniprésence de la peur, qui n'épargne pas Ferrante lui-même :
« [...] songez que le monde entier vit sous l'empire de la peur. Mon père a passé sa vie à avoir peur : peur de perdre sa couronne, peur d'être trahi, peur d'être tué. [...] J'ai vu bien des fois son visage au moment où il venait de marquer un point contre un adversaire ; ce qu'il y avait alors sur ce visage, ce n'était jamais une expression de triomphe, c'était une expression de peur :la peur de la riposte. Les bêtes féroces, elles aussi, sont dominées par la peur. Et regardez les poussières dans ce rayon de soleil :que j'avance seulement un peu ma main ici, au bas du rayon, et là-haut, à l'autre bout, elles deviennent folles, folles de peur. » [A. 1, sc. 4, pp. 38-9]
Les paroles de Ferrante vont également dans ce sens :
« Vous ne faites jamais confiance à l'homme, vous?
- Je fais quelquefois confiance à sa crainte. » [A. 3, sc. 6, p. 140]
La crainte a toujours un objet, est toujours présente pour une raison ou une autre chez tout individu...Chez Iñès, la peur est plus clairement liée à la notion de fatalité ;quand le Roi arrive à Mondego, elle s'exclame :
« Voici enfin cet instant redouté depuis toujours. » [A. 1, sc. 4, p. 41]
Pourtant, elle ne sait pas ce qui va se passer ; chez elle, la peur est une peur « indirecte », plus diffuse, plus vague :
« Je crois que [la colère du Roi] me sera plus facile à supporter que notre présente incertitude. Si étrange que cela puisse paraître, il me semble que lorsqu'elle éclatera, il y aura quelque chose en moi qui criera : « Terre ! ». » [A. 1, sc. 4, p. 36]
Cette affirmation trouve un écho peu après :
« A force d'être anxieuse sans que rien n’arrive, le jour où la foudre tombe on se trouve presque calme. » [p. 39]
Il s'agit donc d'une sensation d'« anxiété », en fait « peur » vague avec des pointes d'« angoisse » :
« Depuis deux ans, sur nous, cette menace, cette sensation d'une pluie noire sans cesse prête à tomber et qui ne tombe pas. [...] j'en ai assez d'avoir tous les jours peur. De retrouver chaque matin cette peur, au réveil, comme un objet laissé la veille au soir sur la table. La peur, toujours la peur ! La peur qui vous fait froid aux mains... » [p. 38]
« Souvent, au coucher du soleil, je suis envahie par une angoisse. Tenez, quand je vois les marchands qui ferment leurs volets. Un coup de lance me traverse : « En ce moment même on décide quelque chose d'effroyable contre moi... » Ou bien (comme c'est bête !) c'est le soir, quand je me déshabille, à l'instant où je dénoue mes cheveux. » [p. 39]
Iñès semble sentir un danger sans le comprendre, et presque s’en vouloir, comme le montre son commentaire entre parenthèses ; à l’acte suivant, elle reprendra :
« Non, ce n'est pas de lui que j'ai peur. Toute notre destinée dépend de lui, et de lui uniquement. Et cependant la peur que j'ai est une peur confuse, et qui ne provient pas de lui en particulier. » [A. 2, sc. 5, p. 90]
Là encore, cette phrase fait écho à sa tirade à Ferrante, au troisième acte :
« Vous vous étonnez peut-être, Sire, que je n'aie pas plus peur de vous. [...] je n'ai pas et ne peux pas avoir très peur de vous, bien que j'aie depuis longtemps une peur vague de quelque chose66. » [A. 3, sc. 6, p. 140]
C'est la peur de la « destinée », énoncée par Pedro parce qu'il l'assimile directement à son père :
« Nous sommes dans la main de la destinée comme un oiseau dans la main d'un homme. Tantôt elle nous oublie, elle regarde ailleurs, nous respirons. Et soudain elle se souvient de nous, et elle serre un peu, elle nous étouffe. Et de nouveau elle relâche l'étreinte, - si elle ne nous a pas étouffés tout de bon. » [A. 1, sc. 4, p. 37]
« Il y a là un signe :la destinée est venue au devant de nous. » [p. 41]
Ce n'est pas le cas d'Iñès, nous l'avons vu :
« [...] cette sensation d'une pluie noire sans cesse prête à tomber et qui ne tombe pas. La destinée qu'on sent qui s'accumule en silence. » [p. 38]
Quant à ce que Ferrante appelle « la tragédie des actes »67, n'est-ce pas encore le poids de cette fatalité ?
Il n'y a pas même l'Infante qui échappe à la peur, même si elle ne la nomme pas :c'est la peur qu'elle éprouve pour Iñès, dont elle sait qu'elle est en danger et qu'elle s'efforce de sauver ; nous pourrions dire qu'il s'agit d'une peur par procuration. L'exception, ce sont les jeunes pages de Ferrante :ils sont les seuls personnages qui ne vivent pas « sous l'empire de la peur », sans que l'on puisse déterminer la cause de leur tranquillité68.
La peur omniprésente se fait donc révélatrice, et la Fatalité, après avoir été suggérée est expressément nommée : Ferrante est parfois assimilé à elle, mais n'est pas toujours confondu avec ;il existe bien une force qui dépasse les personnages...
Cette situation crée dans les dialogues tout un réseau d'échos, de propos qui prennent au vu du déroulement de la pièce une résonance tragique ; certains vont s'avérer, et prennent une valeur prophétique : c'est Iñès affirmant « Mieux vaut [la] colère [du Roi] aujourd'hui que demain. »69 et Pedro « Elle sera terrible. Elle nous enveloppera comme une flamme. »70, Ferrante « Je ne suis pas bon, mettez-vous cela dans la tête. »71 ou « On peut connaître qu'un acte est pis qu'inutile, nuisible ; et le faire quand même. »72, c'est encore l'Infante prévenant Iñès : « La chaîne de vos médailles a appuyé sur votre cou, et l'a marqué d'une raie rouge. C'est la place où vous serez décapitée. »73...
Mais plus souvent encore que des intuitions tragiques - volontaires ou non - des personnages, la pièce est émaillée de leurs erreurs, de propos sur l'avenir qui ne se vérifieront pas : le tragique se fait ironie tragique. Par exemple, Ferrante dit à Egas, sous le coup de la colère :
« Un jour vous serez vieux vous aussi. Vous vous relâcherez. Vos secrets sortiront malgré vous. Ils sortiront par votre bouche tantôt trop molle et tantôt trop crispée, par vos yeux trop mouvants, toujours volant à droite et à gauche en vue de ce qu'ils cherchent ou en vue de ce qu'ils cachent. » [A. 2, sc. 2, pp. 72-3]
L'Infante, bien que plus lucide que la plupart des personnages, sinon tous, n'échappe pas à l'erreur sur elle-même quand elle s'exclame lors de la première scène :
« Il y a quelque chose que je ne pourrais pas? » [A. 1, sc. 1, p. 22]
Nous pouvons même percevoir cette ironie tragique dans les paroles de Pedro à son père, démenties par la fin de la pièce :
« Je n'ai pas tant de facilité que vous à être double. » [A. 1, sc. 3, p. 30]
Pourtant Montherlant renie d'une certaine façon la notion de Fatalité en affirmant dans sa postface à La guerre civile que le tragique ne vient que d'eux, puisqu’il « provient de ce qu’un être contient en lui-même », alors que pour Fils de personne, où se retrouve le thème du sacrifice (Carrion « immole » son fils à son idéal), il explique qu'« on a le sentiment qu'une fatalité absolue les relie et les entraîne dans leur destin », que le Destin « court de l'un à l'autre et [...] emmêle les fils de la tragédie »74...
En fait, tout se passe comme si la Fatalité appartenait aux personnages, leur était inhérente... Ceci est remarquable chez les trois principaux protagonistes de la tragédie : l'Infante, Ferrante bien sûr, mais aussi Iñès...
Chez l'Infante, nous avons vu le caractère violent et sanglant des images qu'elle emploie continuellement : les dames d'honneur mettent l'accent sur sa douleur, douleur à la fois intense et incessante :
« La pauvre !Regardez !Comme elle a mal ! »
« Oh ! Comme elle a mal ! »
« Elle est toujours crucifiée sur elle-même [...] » [A. 1, sc. 1, pp. 17-9]
Mais ce qui est intéressant est l'échange qui suit entre elle et Ferrante :
« Vous aimez d'avoir mal, il me semble.
- J'aime un mal qui me vient de moi-même. » [p. 21]
Au nom de soi, la douleur est plus qu'acceptée, elle est appréciée ; peut-on parler ici d'une forme de masochisme, parallèle au quasi-solipsisme que nous avons supposé ? Certes la remarque de Ferrante va dans ce sens, mais nous ne pouvons aller jusqu'à dire que l'étrange choix de l'Infante, de vouloir sauver Iñès, est un choix délibéré de l'échec ; elle ne sait pas encore qu'elle ne pourra pas la convaincre de partir avec elle...
L'Infante est un personnage placé lui aussi sous le signe de l'échec tragique : celui de la parole, du pouvoir de la parole, comme tous les autres ; mais en parlant, elle finit par se torturer elle :
« Laissez-moi croire que je puis trouver encore les mots pour vous convaincre. penser que vous aurez passé à côté de moi ! [...] Ou peut-être en ai-je trop dit ? Quand on veut convaincre, et qu'on a dépassé le point où c'était encore possible, tout ce qu'on dit de surcroît ne fait que vous rendre suspect et endurcir l'être qu'on veut convaincre. Vous devez penser [...]Tout mon intérieur est desséché comme si on m'avait enfoncé dans la gorge, jusqu'à la garde, l'épée de feu de l'ange nocturne ;vous savez, quand les voix de la muraille crièrent de nouveau : « Sennachérib ! » Ah ! La chose insensée, qu'un désir violent ne suffise pas à faire tomber ce qu'on désire. » [A. 2, sc. 5, p. 103]
Cette tirade est elle-même « insensée », puisque comme Ferrante l'Infante dénonce la vanité de sa démarche tout en la poursuivant, peut-être plus pour elle que pour Iñès qui lui échappe obstinément...Mais elle va imputer à cette dernière la douleur que lui cause la situation :
« J'aurais voulu que tout mon séjour au Portugal s'évanouît comme un mauvais rêve, mais cela n'est plus possible, à cause de vous. C'est vous seule qui empoisonnez le doux miel de mon oubli [...] » [p. 104]
Son ultime revirement à la fin de la pièce, sans contredire cette accusation, n'empêche pas que l'Infante retourne d'elle-même essuyer un dernier refus, subir un dernier échec... Et c'est dans cette idée qu'il faut voir la mise en scène de la seule « ombre » du personnage ; son échec est une mort figurée :
« [L'ombre de l'Infante, dans le fond de la salle. ] Iñès !
- Qui m'appelle?
- Quelqu'un qui te veut du bien. Quitte cette salle immédiatement. [...]
- Oh ! Je vous reconnais maintenant !
- Tu ne m'as jamais reconnue. [...] Ah ! Il est affreux de ne pas savoir convaincre.
- Elle répète toujours le même cri, comme l'oiseau malurus, le soir, sur la tristesse des étangs.
- Iñès, une dernière fois, éloigne-toi. - Non ? Tu ne veux pas ? Eh bien ! Toi aussi, à ton tour, tu ne pourras pas convaincre. » [A. 3, sc. 6, pp. 130-1]
L'Infante en échouant annonce l'échec d'Iñès, qui découle - mais ce, indirectement - du sien... La sonorité du nom de l'oiseau suggère l'idée de douleur, c'est un nom de mauvais augure ... L'échec de l'Infante est symbolisé par la chute et la destruction de son bracelet : la communication a échoué :
« Chez nous, une princesse de sang royal ne peut rien accepter, qui ne lui ait été tendu par quelqu'un de sa maison. Ce bracelet qui joint si mal restera comme un symbole de ce qui ne s'est pas joint entre nous.
- Si c'est un symbole, il y a des choses tellement plus pures que le diamant.
- C'est vrai. [Elle prend le bracelet, le jette à terre, et l'écrase sous son talon. Un temps. ] Embrassez-moi. » [p. 105]
Si la douleur de l'échec est très semblable chez l'Infante et chez Ferrante, seul l'échec est commun entre elle et Iñès ; nous l'avons vu, la peur de celle-ci est vague, elle ne s'assimile pas à une douleur, et pourtant son échec la mènera à une mort cette fois bien réelle...
Iñès porte en elle une fatalité comme elle porte son enfant ;l'image par excellence de cette fatalité inhérente est celle de la cascade à laquelle elle se compare spontanément devant l'Infante :
« Voyez cette cascade :elle ne lutte pas, elle suit sa pente. Il faut laisser tomber les eaux.
- La cascade ne tombe pas :elle se précipite. Elle fait aussi marcher les moulins. L'eau est dirigée dans des canaux. La rame la bat, la proue la coupe. Partout je la vois violentée. Oh ! Comme vous êtes molle ! » [A. 2, sc. 5, p. 101]
Iñès est naturellement encline à la passivité ; cette image romantique (elle vient de Chateaubriand, dans les Mémoires d'outre-tombe : « Il faut laisser tomber les flots. ») montre déjà l'issue fatale de la pièce ; restée seule, l'Infante répétera « Il faut laisser tomber les eaux... », rêveusement, en fixant la cascade. Iñès est la « faille » de l'Infante, et la faille d'Iñès est l'amour : à partir du moment où elle l'incarne, on peut dire qu'elle échoue et meurt à cause de l'amour, en même temps que l'amour échoue - et meurt - à travers elle...
Si l'amour constitue la faille d'Iñès, c'est dans la mesure où elle en a une conception particulière et excessive, ou plutôt dans la mesure où elle le vit de façon particulière et excessive... Car Iñès est tout amour, elle vit par et pour lui. Nous le verrons plus précisément, elle est la personnification de ce sentiment, qu'elle exprime notamment par des images de fusion ;mais le tragique vient du fait que si elle aime Pedro entièrement, elle s'aliène fatalement d'elle-même... Souvent en effet chez Iñès, les images de fusion deviennent images de dépendance :
« Pourquoi me lâcher ainsi brusquement ? Il ne fallait pas me prendre contre toi, si c'était pour me lâcher ainsi. Reprends-moi auprès de toi, que je ne meure pas. » [A. 1, sc. 4, p. 41]
Cette phrase d'Iñès au début de la pièce fait écho à son cri lors de ses retrouvailles avec Pedro mis en prison :
« Ensuite, prête à tout subir. Mais que cet instant ne me soit pas retiré. Un instant, un petit instant encore, que je repose sur l'épaule de l'homme, là où l'on ne meurt pas. » [A. 2, sc. 4p. 85]
C'est une évidence : au nom de l'amour Iñès met sa vie en jeu, amour et mort sont liés ; son amour absolu prend parfois la forme de la voracité en restant lié à l'idée de mort :
« Je voudrais donner ma vie pour toi. Tu ris ! Comment peux-tu rire ?
- De te voir si amoureuse. Tu t'es jetée sur moi comme le loup sur l'agneau !
- Et dire que je suis restée une heure étendue sur mon lit, avant de venir, pour être maîtresse de moi quand tu apparaîtrais ! [...] Ton nom prononcé dans ma solitude, prononcé dans mes rêves. Clouée comme par une flèche. Et je regardais le ciel et je criais :« Ah ! Un peu moins de ciel bleu, et le corps de l'homme que j'aime ! » [...] » [A. 2, sc. 4, pp. 86-7]
Il est évident qu'Iñès ne maîtrise pas cet amour : c'est l'inverse ; l'image de la « flèche » est étonnamment proche de celle de l'« épée » qui crucifie l'Infante : la dépendance n'est plus celle de l'orgueil, mais de l'amour... Mais jusqu'à quel point ? Car « pouvoir » mourir pour quelqu'un est tout de même différent de le « vouloir », et malgré l'emploi du conditionnel Iñès est prête à cette mort, puisqu'elle ajoute juste ensuite :
« Quand je t'ai vu, mon cœur a éclaté. Ah ! Laisse-moi boire encore. Que je te tienne dans ma bouche comme font les féroces oiseaux quand ils se possèdent en se roulant dans la poussière. [...] j'accepterais de mourir, moi et ce que je porte en moi, oui j'accepterais de mourir si la mort devait me fixer à jamais dans un moment comme celui-ci. » [p. 87]
Iñès est violente dans son sentiment vorace, dans l'expression de ce sentiment aussi : outre toutes ses exclamations, ses cris, les images qu'elle emploie sont ici à l'opposé de sa douceur première ; mais cet amour est total : aussi à la violence des images d'amour charnel s'allie la douceur de celles de l'amour sentimental... Et cette douceur est là encore assimilée à la mort :
« [...] tout mon rêve aurait été de passer ma vie retirée dans le petit coin de la tendresse, perdue et oubliée au plus profond de ce jardin. » [A. 1, sc. 4, p. 37]
« Moi, je voudrais m'enfoncer au plus profond de l'amour partagé et permis, comme dans une tombe, et que tout cesse, que tout cesse... » [A. 3, sc. 6, pp. 128-9]
Nous reviendrons sur ce point, c'est une verticalité dirigée vers le bas qui attire Iñès, la profondeur n'est pas en elle mais en l'amour, qui devient explicitement mort au monde...La tentation de la retraite diffère de celle de Ferrante, non pas dans la fin mais dans le moyen : il s'agit d'une fuite mais chez elle, c'est la force de l'amour qui fait la faiblesse. L'Infante ira d'ailleurs jusqu'à s'exclamer :
« Comme tu aimes ta mort ! Comme tu l'auras aimée ! » [A. 3, sc. 6, p. 130]
Néanmoins, l'attitude d'Iñès évoque plus le sacrifice que le masochisme car elle va « jusqu'au bout » dans les faits plus que dans les sentiments : il n'y a pas de complaisance chez elle parce qu'il n'y a pas de conscience du danger : il n'y a pas de douleur. Y a-t-il sacrifice ? Ferrante est indiscutablement l'assassin de la jeune femme, et pourtant toute la pièce nous montre Iñès ignorer le danger, alors qu'elle ne peut justement plus l'ignorer, après les mises en garde de Pedro, de l'Infante et du page... La fatalité inhérente à Iñès est là : elle n'ignore pas intentionnellement sa mort, mais fatalement.
L'image de la cascade est donc sans doute la plus représentative d'Iñès et de son sort tragique ; il nous faudra revenir sur cette image pour notre recherche de l'identité "existentialiste" de Ferrante.
Ainsi l'échec de chaque personnage est fatal : de l'Infante qui veut sauver Iñès, de Pedro qui veut sauver son couple, d'Iñès qui veut sauver son enfant, d'Egas qui veut se sauver... Et peut-être aussi, nous y reviendrons, de Ferrante qui veut sauver les apparences ; le sort de chaque personnage est tragique, et c'est parce qu'Iñès et Ferrante meurent que l'échec est fatal pour tous les autres : l'Infante repart mais sans épouser Pedro ni sauver Iñès, Pedro règne mais sans vivre avec Iñès, Egas Coelho et les autres conseillers de Ferrante obtiennent la mort d'Iñès mais paient pour elle devant Pedro, sans doute, comme ce fut le cas dans l’Histoire, de leur vie... La Reine morte est bien une tragédie, et Ferrante est le héros de cette tragédie. Mais son identité théâtrale va nous poser problème, car nous arrivons à une nouvelle dualité : Ferrante est un héros de tragédie... Mais quel héros ? Ferrante est-il le torero sublime, ou le taureau pathétique ?
Nous avons parlé d'une fatalité présente dans La Reine morte. Si Ferrante porte cette fatalité, il semble d'abord que celle-ci soit au-dessus de lui plutôt qu'en lui ; car dans l'univers tragique de la pièce, Ferrante est indéniablement pris dans une situation inextricable... D'abord il semble que la seule existence d'Iñès provoque le refus de Pedro d'épouser l'Infante, et c'est ce refus qui pose problème à Ferrante :
« Et pourquoi suis-je forcé de compter avec lui, pourquoi suis-je forcé de pâtir à cause de lui [...] » [A. 1, sc. 2, p. 24]
Mais il apparaît vite que c'est son union avec elle qui fige la situation problématique :
« Ah !malheur !malheur !Marié ! et à une bâtarde ! ! Outrage insensé et mal irréparable, car jamais le Pape ne cassera ce mariage :au contraire, il exultera [...] » [A. 1, sc. 5, p. 47.]
Les ministres qui lui conseillent d'exécuter Iñès ont bien perçu le sentiment d'aliénation du roi, et en font un argument en faveur de la violence :
« Et n'est-il pas insensé que des hommes acceptent de peiner, de souffrir, d'être ligotés par une situation inextricable, seulement parce qu'un être est vivant, qu'il suffirait de supprimer pour que tout se dénouât [...]. »[A. 2, sc. 1, p. 68.]
Lors du troisième acte, Ferrante comprend que toute démarche envers le Pape serait vouée à l'échec :
« [...] il n'y a rien à faire, rien, rien ![...]. Le nonce me fait dire par don Alvar que le Pape accueillerait comme un outrage que je sévisse contre l'évêque. Le Pape ne donnera pas l'annulation : à présent cela est sûr. Je suis comme un lion tombé dans une trappe. Je puis mordre, bondir, rugir : en vain. »[A. 3, sc. 3-4, p. 117.]
Il semble bien que ce soit le sort qui s'est au fil des scènes ligué contre Ferrante75 ; la couleur noire qu'évoque Iñès, par sa « sensation d'une pluie noire », est également évoquée par le personnage :
« Bientôt la mort va m'enfoncer sur la tête son casque noir. »[A. 3, sc. 1, p. 107.]
Au premier acte, il évoquait sa mort par une image contraire, celle de « l'aigle » affamé de « lumière »... Est-ce alors l'expression d'un sentiment de fatalité ? On pourrait le penser du fait que les didascalies indiquent l'omniprésence d'une pénombre à la fin de la pièce, lors de l'ouverture du dernier acte :
« [Une salle du palais royal. elle est presque dans l'obscurité. Seuls les abords de l'âtre, où un feu brûle, sont éclairés par un foyer.] »[A. 3, sc. 1, p. 107.]
Il semble que cette pénombre soit à considérer comme un élément tragique qui révèle le cours inéluctable du destin ; c'est ce que laisse penser cette phrase de Ferrante, qui vient de lire un billet de son conseiller, à la fin de cette scène :
« Malheur ! Malheur ! Malheur ! Fais entrer don Alvar dans mon cabinet.[...] Ensuite, tu ranimeras le feu. Il s'éteint. »[p.111.]
Pourtant, malgré ces signes, Ferrante est comme les autres personnages : lui aussi porte une fatalité en lui, une fatalité inhérente... Peut-être même plus76 : car si Iñès « fait » le malheur de l'Infante, et l'amour celui d'Iñès, on peut dire que Ferrante « fait » son propre malheur... Nous avons parlé d'une sorte de masochisme chez les deux personnages féminins ; mais ne peut-on en dire autant du roi, qui avoue dans un long monologue peu avant de mourir, alors qu'il vient d'ordonner la mise à mort d'Iñès77 :
« J'ajoute encore un risque à cet horrible manteau de risques que je traîne sur moi et derrière moi, toujours plus lourd, toujours plus chargé, que je charge moi-même à plaisir, et sous lequel un jour...[...].Mais ma volonté m'aspire, et je commets la faute, sachant que c'en est une. »[A. 3, sc. 7, p. 143.]
Ce mot de « plaisir », en s'opposant à celui d'« horrible », rend bien la contradiction du personnage ; si Ferrante a conscience que la mort d'Iñès va entraîner la sienne, ne peut-on pas avancer qu'il y a double sacrifice, que Ferrante se tue en la tuant ? Mais sa mention vague d'« un jour », et l'interruption brusque de sa phrase, ne nous permettent pas de l'affirmer... Non seulement nous ne pouvons pas être sûrs que Ferrante se sacrifie, mais en outre nous pourrions difficilement interpréter cette forme de suicide : serait-il plus une fuite, une façon de ne pas faire face à son acte, donc une faiblesse pathétique ? Ou serait-il plus une forme de grandeur, une façon d'aller au-devant d'une punition de cet acte, donc un acte fort et sublime ? Peut-être doit-on considérer ces deux aspects ensemble : Ferrante serait à la fois le torero qui sacrifie et le taureau qui est sacrifié...78 Car, nous allons le voir, le personnage mêle en lui les aspects sublimes et les pathétiques.
Revenons à l'image à laquelle Ferrante se compare, quand il lui apparaît que la situation n'évoluera plus :
« Je suis comme un lion tombé dans une trappe. Je puis mordre, bondir, rugir : en vain. »[p.117.]
L'image de l'animal piégé évoque plutôt le pathétique que le sublime...Pourtant, l'emploi même de cette image est sublime : l'image léonine est un symbole royal, elle dénote un lyrisme empreint de dignité de la part de celui qui l'emploie...
L'auteur l'a affirmé nettement : « mon art [est] un art pathétique »79.
Nous pouvions pourtant penser, a priori, que le Roi Ferrante était un personnage sublime : d'abord parce qu'il cherche chez les êtres la « qualité » que supposent la hauteur, la grandeur, la profondeur, telles qu'on les voit dans le personnage de l'Infante et telles que son statut de Roi lui confère... Nous avions vu la conscience que Ferrante avait de sa valeur et de sa dignité, combien son ton était royal et orgueilleux...
Le pathétique ne semble pas s'accorder avec ce portrait du personnage ; en réalité, c'est tout ce qui fait le sublime de Ferrante qui va devenir, progressivement ou par moments, pathétique : son « personnage », sa « personnalité », c'est-à-dire le sublime attaché à son statut de Roi ou à sa conception élitiste de l'existence, et son ressenti de la réalité qui l'entoure en général : c'est son expression qui nous le montre. D'ailleurs, son expression même peut se charger d'un ton qui reflète ces changements...
Ainsi, son discours peut passer de brillant à trivial ; comment penser en effet que celui qui dit à son fils, au début du premier acte : « Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. », est le même qui avoue à la fin du dernier acte : « J'étais comme une vieille poule qui pondrait des coquilles vides... »80 ?
Le contraste des styles est très net ; ici, il montre ces aspects opposés du personnage... Pour Lancrey-Javal, axé essentiellement sur le langage et son traitement, le pathétique est ici à son comble puisque Ferrante « en est réduit à la tonalité burlesque pour s'exprimer »81.
A ses yeux, cette « dégradation du langage » est pire que le silence qui va la suivre...
On serait tenté de penser que la progression de Ferrante du sublime au pathétique suit la progression dramatique, le fil des actes. Il est vrai que Ferrante montre plus son « personnage » et sa « personnalité » lors des premières scènes de la pièce ; ainsi, les images sublimes comme celle du « taureau » en précèdent de moins nobles, comme celle du « matou », ou plus pathétiques, comme celle de la « poule »... Mais il ne faut pas s'y tromper : l'image du « lion » ou du « cerf » véhiculent encore au troisième acte une certaine grandeur, et la douleur exprimée toujours plus clairement par le personnage le sera avec un lyrisme qui tient au moins autant du sublime que du pathétique. Simon résume ainsi le « génie » de Montherlant : « Un pathétique naturel, lié à un sentiment aigu de la vie intérieure et trouvant pour s'exprimer une langue d'une concision et d'une sonorité admirables »82, donc sublime, ajouterons-nous.
Par exemple, l'image de l'arbre auquel se compare Ferrante et au début et à la fin de La Reine morte est pratiquement mot pour mot la même :
« Je suis comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre à des centaines de milliers d'êtres. » [p.46.]
« Un roi est comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre... » [p.146.]
L'image est toujours grandiose ; ce qui est pathétique, c'est la dénonciation de sa propre bouche du fait qu'il n'y croit plus : il ne s'agit plus à la fin du « roi » sublime, le prestige n'appartient dans l'image de l'« arbre » qu'à son personnage... mais il reste ce roi qui s'adresse à tous ses sujets ; l'ombre n'est plus protectrice, elle est mortifère... mais le lyrisme est toujours présent, authentique.
Le processus est le même sur d'autres plans : certains éléments du sublime de Ferrante sont pérennes, mais leur expression mêle le sublime et le pathétique en dénonçant dans un ton qui reste royal le changement de son ressenti.
Il en va ainsi de sa « valeur » : elle reste la même du début à la fin, mais c'est la conscience, le ressenti de sa valeur qui change ; lui et l'Infante sont de l'avis de l'auteur « les deux êtres de valeur de la pièce », mais son orgueil « dégénère » - le mot est de Banchini83 - en vanité : Montherlant cite lui-même la phrase vaniteuse de Ferrante, quand il a ordonné l'exécution d'Iñès :
« Et dire qu'on me croit faible ! »[A. 3, sc. 7, p. 145.]
« Je lui ai prêté ce mot de vanité bouffonne au moment le plus tragique du drame. », commente-t-il84.
Plus généralement, c'est la lucidité du personnage qui est en cause : son intelligence pourtant ne l'est pas. Toute la pièce durant Ferrante se montre très intelligent, ses sentences brillantes le prouvent, qu'elles soient bienveillantes ou cyniques ; mais la lucidité sublime sur lui-même et sur les autres peut s'altérer jusqu'à un aveuglement qui le rend pathétique.
Par exemple, Ferrante a instantanément perçu la faille de l'Infante, son « masochisme » : quand elle frôle le blasphème par orgueil, il remarque :
« Vous aimez d'avoir mal, il me semble. »[A. 1, sc. 1, p. 21.]
Mais cela ne l'empêche pas d'agir contre son intérêt, de la même manière ; le « masochisme » se retrouve chez lui, déjà lorsqu'il s'apprête à signer un traité qui lui est défavorable :
« J'ai conscience d'une grande faute ; pourtant je suis porté invinciblement à la faire. Je vois l'abîme, et j'y vais. »[A. 2, sc. 1, p. 59.]
Le double rythme binaire qu'il emploie met en valeur le caractère paradoxal et même absurde de sa conduite : il « voit » et agit en aveugle...Mais Ferrante peut aussi devenir réellement aveugle devant son propre intérêt, et ainsi devenir plus pathétique que sublime. Le fait qu'il se prive comme sans s'en apercevoir d'un tant soit peu de bien-être révèle assez sa condition : ses paroles à Pedro sont éclairantes à cet égard :
« Il n'est donc que votre plaisir au monde ? [...] Tant d'idées au secours d'un vice ! [...] Enfin vous voici tout à fait sincère ! C'est de vous qu'il s'agit. Et de votre bonheur ! Votre bonheur ! Êtes-vous une femme ? »[A. 1, sc. 3, pp. 30-1-2.]
Ces exclamations marquent l'opposition entre Ferrante et son fils, mais également entre lui et le « bonheur » : Ferrante de ce point de vue-là ne se prend jamais en compte, et semble croire que ce mépris du bonheur est sublime, alors qu'il ne peut que le rendre finalement pathétique : cela est plus visible encore dans son entretien avec Iñès, une femme, justement :
« Plus heureuse ! Encore le bonheur, comme l'autre ! C'est une obsession ! Est-ce que je me soucie d'être heureux, moi ? »[A. 1, sc. 5, p. 47.]
Il semble plus que vraisemblable que c'est cette attitude qui va nourrir le nihilisme et surtout l'aigreur du personnage face à ceux qui l'entourent, et qui soulignent douloureusement ce contraste, cette différence supplémentaire...Car son intelligence s'aigrit ; ainsi, l'expérience de Ferrante, paramètre qui ne peut évidemment se modifier, et qui fait sa sagesse, va par moments également « dégénérer » en des accès pathétiques de paranoïa. Alors que, constamment, la sagesse de Ferrante s'exprime par l'éloge de la modération :
« C'est une faiblesse que faire la chose la plus rapide, la plus brutale, celle qui demande le moindre emploi de l'individu. Ainsi il y a des galants qui préfèrent brusquer une femme, au risque d'en recevoir un soufflet, à lui adresser la parole : on les prend pour des forts, et ce sont des timides. »[A. 2, sc. 1, p. 68.]
Le fait que Ferrante repousse ici la facilité est tout à son honneur, et sa comparaison est plutôt clairvoyante...Le pathétique vient justement du fait que son acte va être celui qu'il condamnait sublimement. De même quand il conseille Iñès, qu'il vient d'autoriser à rencontrer Pedro emprisonné :
« Modérez-vous. Il ne faut jamais avoir plaisir si vite. »[A. 2, sc. 3, p. 80.]
Doit-on voir là du cynisme, ou de la sincérité ? Peut-être de la sincérité car, comme nous l'avons dit, Ferrante se méfie d'autrui à l'excès...Mais sa lucidité devant Iñès n'empêche pas que lui sombre dans l'aveuglement devant Pedro, ce qui est encore un paradoxe : nous avions vu le glissement de son discours au sujet de son fils, qui passait de l'expression d'une simple indifférence à celle d'une animosité, quand il apprend son union à Iñès :
« A moins que...à moins qu'il n'ait compté sur ma mort. Je comprends maintenant pourquoi il se débat contre tout mariage. Je meurs, et à l'instant vous régnez ! Ah! j'avais bien raison de penser qu'un père, en s'endormant, doit toujours glisser un poignard sous l'oreiller pour se défendre contre son fils. Treize ans à être l'un pour l'autre des étrangers, puis treize ans à être l'un pour l'autre des ennemis : c'est ce qu'on appelle la paternité. »[A. 1, sc. 5, p. 48.]
Ferrante affirme s'être toujours méfié de son fils, et use de termes très durs pour signifier ce qui les sépare : l'image du « poignard » en fait plus que des « ennemis » de par leur parenté...Mais il semble qu'en fait seule l'idée paranoïaque d'un calcul de Pedro le fasse changer de discours et nier la tendresse éprouvée pour son fils enfant, ce qui accentue le pathétique de son erreur. Pourtant cette méfiance à l'égard de Pedro est sans fondement, et pourtant Ferrante en a forcément conscience : son fils est trop peu intéressé par le pouvoir, et trop peu capable de calculs tortueux ou de ruses sournoises ; mais l'ambivalence de son ressenti altère sa lucidité : Ferrante est en fait à la fois lucide et aveugle. Sa paranoïa visible à l'égard des médecins, plus avant dans la pièce, le pousse d'ailleurs à évoquer, sans conviction et plutôt par aigreur, ce sujet de méfiance :
« Je ne parle de mon mal à personne, et le monde croit que je vais vivre mille ans. D'ailleurs, les médecins...[...]. Toutefois, vous avez peut-être raison, et on peut poser comme un axiome général qu'il vaut encore mieux être assassiné par son médecin que par son fils. »[A. 3, sc. 1, p. 108.]
Il est question ici de la fragilité de Ferrante : n'est-ce pas son âge qui est en cause dans ces élans de paranoïa ? Car si son grand âge est lié à sa « valeur » autant qu'à son expérience, il l'est aussi à sa faiblesse... Là encore, cet élément du sublime qui lui confère une certaine dignité, va le faire basculer dans le pathétique.
Ferrante a soixante-dix ans ; c'est un âge vénérable, « une vieillesse qui solenne et ironise à la fois le propos »85, qui le rapproche d'un autre Roi sublime, Khosrau, que Montherlant étudiait dans le même temps qu'il composait La Reine morte, et dont il s'est partiellement inspiré. Dans ses Textes sous une occupation (40-44), l'auteur commente le poème du persan Firdousi (le Châh Nâmeh ou Livre des Rois) en insistant sur le sublime de Khosrau, qui renonce au pouvoir au moment de mourir, mais en le trouvant pathétique en même temps86 : « Le roi veut partir en beauté. Il échange le peu d'années qui lui restent à vivre - années dangereuses, et années lourdes - contre l'intégrité de sa gloire humaine et de sa gloire éternelle.[...] Si cet homme comblé avait cru qu'il allait cesser d'être absolument, quel pathétique et quelle grandeur n'aurait pas sa démission ! » ; puis, s'étant interrogé sur le mérite d'un renoncement si peu de temps avant de mourir, il conclut à une « atmosphère sublime ».
Cela rejoint notre question, de savoir si la mort de Ferrante est une marque de sublime ou de pathétique : les « années lourdes » de Khosrau rappellent le « manteau de risques » de Ferrante, et le mot de « démission » assimilé au sublime correspond assez, nous semble-t-il, à la fin de notre personnage... Là prend toute son importance l'aveu de Montherlant de son « art pathétique » : l'agonie de Ferrante le rend pathétique, mais son expression confère à « l'atmosphère » son caractère sublime : le personnage inspire finalement autant la pitié, que la terreur, selon l'idéal classique.
Les mentions de son « mal », dont on ne sait s'il s'agit juste du poids des années et des émotions, ou d'une maladie que Ferrante tiendrait secrète, sont très nombreuses : comme le résume l'Infante, « le roi souffre de bientôt mourir. »87 ; dès la troisième scène, il est pris d'un « malaise » que nous indique une didascalie :
« [Pris d'un malaise, il porte la main à son cœur. Un temps.] »[A. 1, sc. 3, p. 28.]
Puis Ferrante va évoquer devant Iñès sa mort comme imminente, à plusieurs reprises :
« Et vous satisferez votre Roi, qui incline vers la tombe, et a besoin que ses affaires soient en ordre. »[A. 1, sc. 5, p. 46.]
« Et bientôt, à l'heure de la mort [...]. Bientôt, mon âme va toucher la pointe extrême de son vol, comme un grand aigle affamé de profondeur et de lumière. »[A. 2, sc. 3, p. 77.]
« Bientôt la mort va m'enfoncer sur la tête son casque noir. Je meurs d'ailleurs depuis longtemps ; il ne s'agit que d'achever la chose. »[A. 3, sc. 1, p. 107.]
Cette dernière image est empruntée à Firdousi : si son agonie le rend pathétique, le sublime de Ferrante tient à cette conscience de la proximité de sa fin, une conscience presqu'obsessionnelle mais finalement dénuée de peur : ainsi Ferrante pense incessamment à sa « tombe », et rêve même de son agonie :
« Chaque fois qu'on me loue, je respire mon tombeau. »[A. 1, sc. 2, p. 24.]
« [...] j'y prends ma plus grande dimension, celle que j'aurai dans la tombe,[...] » [A. 3, sc. 6, p. 127.]
« J'ai mes visitations. La nuit surtout[...]. Alors, souvent, mon cœur s'arrête... Quand il recommence à battre, je suis tout surpris de me retrouver vivant, - et un peu dépité.[...] Cette nuit [...] j'ai rêvé que j'agonisais. Nulle souffrance physique, et lucidité absolue.[...] Chaque nuit, ou presque, s'entrouvrent pour moi de tels abîmes. » [A. 3, sc. 1, pp. 108-9.]
Peut-être plus que tout le reste, la conscience morbide de son sort fait de Ferrante un héros à la fois sublime et pathétique88. En lui-même le personnage semble donc, en fonction des mêmes paramètres - son intelligence et sa valeur, son expérience du pouvoir et de la vie en général, son âge même - tantôt sublime et tantôt pathétique, et parfois sublime et pathétique dans les mêmes moments.
On aurait pu penser avec le même a priori que Ferrante, non plus en lui-même mais en fonction des autres protagonistes de la tragédie, était le héros simplement sublime de la pièce. Il en occupe à double titre la place centrale : dans ses rapports strictement politiques d'abord, puisqu'il est le Roi du Portugal ; il est l'incarnation du Pouvoir, un pouvoir sur tous les autres : tous les autres lui sont inférieurs, ses ministres et ses « Grands », ses pages et finalement le peuple, tous sont ses sujets. Et, dans ses rapports humains, là encore il occupe une position centrale : il est le père du Prince Pedro, le beau-père de l'Infante de Navarre d'un point de vue « théorique » et le beau-père d'Iñès de Castro d'un point de vue « pratique »...
Pourtant, à cette position centrale sublime correspond une solitude paradoxale, une solitude pathétique révélée par l'univers spatial et temporel de la pièce... Cet univers spatio-temporel peut être déterminé à l'aide d'un schéma actanciel tel que Greimas l'a mis au point dans sa Sémantique structurale89, qui permet de dégager la structure de l'œuvre.
Par rapport à l'univers spatial de La Reine morte, ce schéma montre clairement que la solitude de Ferrante est doublement paradoxale : en effet, outre l'inévitable « solitude du pouvoir » évoquée par Iñès :
« Comme […] toutes ces grandes salles désertes évoquent bien la solitude qui doit être celle du pouvoir ! Et comme la lamentation intérieure y doit résonner plus fort […] ! » [A. 2, sc. 4, p. 89]
et par Ferrante lui-même, de façon détournée :
« Seulement, sur qui m’appuyer ? Sur les ennemis de mes ennemis ? Eux aussi sont mes ennemis. Il n’y a que les imbéciles pour savoir servir et se dévouer : les seuls qui me sont dévoués sont des incapables. » [A. 2, sc. 3, p. 76]
ce qui fait écho à l’affirmation du page interrogé par Iñès :
« Tout le monde le trompe ici. » [A. 3, sc. 2, p. 115]
outre cette solitude strictement liée à la fonction royale, Ferrante ne peut compter réellement sur aucun Adjuvant, car tous les personnages peuvent être classés dans ses Opposants, jusqu'au personnage qui n'apparaît pas sur scène, le Pape : en théorie, au moins ses Ministres devraient être de son côté ; mais « en tout [ils ont leurs] raisons, et ne regard[ent] qu'elles, plutôt que [son] service. »90. De même, Pedro refuse le règne et le mariage avec l'Infante, et cette dernière, loin de rendre son « estime » au Roi, veut soustraire Iñès de son pouvoir... Iñès pourrait paradoxalement être la seule Adjuvante du personnage, car elle lui est fidèle :
« Je ne quitterai pas celui qui m'a dit : « Je suis un roi de douleur. »[...] O mon Roi, je ne vous abandonnerai pas parce que vous dites la vérité[...]. »[A. 3, sc. 6, pp. 130-1.]
Mais en même temps, Iñès lui préfère son intérêt et n'obéit pas à sa demande d'aide ; elle n'essaiera pas de convaincre Pedro d'épouser l'Infante :
« Il voudrait... Mais moi je ne veux pas ! [...] Que j'obtienne ta promesse d'épouser l'Infante, si le Pape donne l'annulation. Mais moi je ne veux pas [...] » [A. 2, sc. 4, p. 88.]
Cette situation en elle-même paradoxale se double d'un autre paradoxe : il semble en effet que Ferrante ne puisse se compter au nombre de ses Adjuvants et même plus, qu'il soit à lui-même un Opposant ; il signe le traité avec Ferdinand d'Aragon contre son intérêt, et commet un crime qui lui nuira, puisqu'il s'exclame :
|
Destinateur = force qui pousse le sujet à l’action (souvent l’entité, la personnalité) |
|
D2 Destinataire = bénéficiaire de l’action du sujet (personne, collectivité, autre…) |
|
|
S Sujet de l’action |
|
|
Adjuvant(s) =aide(s) du sujet |
|
Op. Opposant(s) =adversaire(s) du sujet |
|
|
O Objet de la quête ou du désir du sujet |
|
SCHÉMA ACTANCIEL
Ce schéma permet de dégager la structure d’une œuvre. S se définit en fonction de D1, D2 et O. Il y a possibilité d’analyser d’éventuelles superpositions ou absences.
|
En réalité : son orgueil ? sa haine ? rien ? |
|
En théorie : le Portugal En réalité : Pedro lui même ? la tradition ? personne ? |
|
|
Ferrante
|
|
|
En théorie :tous les protagonistes En réalité : pas Pedro pas ses ministres pas l’Infante pas Iñès ? pas lui même ? |
|
En théorie : personne En réalité : Pedro l’Infante ses ministres le Pape Iñès ? lui-même ? |
|
|
Initialement : la succes-sion au trône, donc le mariage de Pedro et de l’Infante
Finalement : ? ? |
|
« Non seulement Pedro n'épousera pas l'Infante, mais je l'arme contre moi, inexpiablement.[...] Acte inutile, acte funeste. »[A. 3, sc. 7, p. 143.]
Il s'agit bien alors d'une solitude totale : Ferrante est absent de ses actes, et même « absent de lui-même »91.
Si cette solitude est pathétique, la souffrance qui en résulte est au-delà, elle est purement tragique : Ferrante avouera la souffrance de cette solitude à Iñès, par des images lyriques :
« Ah ! ne me parlez donc pas de ma gloire. Si vous saviez comme je suis loin de moi-même.[...] Et puis, je ne suis pas un roi de gloire, je suis un roi de douleur. Sur l'étendard de Portugal, j'ai augmenté le nombre de ces signes qui y représentent les plaies du Christ. C'est un roi de douleur qui vous fait ce grand brame de cerf dans la forêt. »[A. 3, sc. 1, pp. 109-10.]
Mais cette souffrance elle aussi s'avère double : à la douleur de la solitude s'ajoute celle de l'incompréhension d'autrui, « le héros de Montherlant est toujours un isolé »92, ce qui est pire qu’être « seul » : déjà Ferrante n'imagine pas la compréhension d'Iñès : « si vous saviez », lui dit-il. Cette plainte fait écho à l'affirmation qui lui précède :
« J'écrivais : « Bien meilleur et bien pire... » Car j'ai été bien meilleur et bien pire que le monde ne le peut savoir. »[p.109.]
Là encore un paradoxe surgit : si Ferrante est « un incompris »93, cela signifie l'échec de la parole, de la communication ; mais il l'est aussi de lui-même... En effet, après avoir ordonné la mise à mort d'Iñès, il s'interroge, par deux fois :
« Pourquoi est-ce que je la tue ? Il y a sans doute une raison, mais je ne la distingue pas.[...] Pourquoi est-ce que je la tue ? Acte inutile, acte funeste. »[A. 3, sc. 7, p. 143.]
Le schéma actanciel rend bien ce paradoxe : quel est à ce moment l'Objet du personnage ? Il semble que son acte soit sans rapport avec son souci de la succession au trône ; ou alors, soit cet Objet a changé au fil de la pièce, soit il n'a jamais été ce souci...Il apparaît que l'Objet de Ferrante ne peut être finalement déterminé, ce qui remet en cause son Destinateur et son Destinataire : car si son acte ne coïncide pas avec l'Objet, quelle motivation a Ferrante ? Et, si l'on peut dire, à qui profite le crime ? Destinateur et Destinataire apparaissent ainsi brouillés et finalement indistincts. Nous nous pencherons plus avant sur ces questions ; ce qui en ressort ici, c'est que du fait de l'indétermination de l'Objet, du Destinateur et du Destinataire, c'est le Sujet lui-même qui devient indéterminé...
Nous ne savons pas ce que veut Ferrante, dans quelle intention, ni ce qui le pousse : l'unique certitude à son sujet est qu'il est « un roi de douleur », un héros, plus que sublime mais aussi plus que pathétique, tragique : l'univers temporel de la pièce va lui aussi dans ce sens, puisque la fin de La Reine morte coïncide avec celle de son héros.
Cette « double fin » elle aussi met en valeur la solitude à la fois sublime et pathétique de Ferrante ; nous l'avons vu, il vit son agonie, et en exprime sublimement la souffrance constante, car c'est bien là aussi de souffrance qu'il s'agit : « Chaque nuit, ou presque », avoue-t-il, « s'entrouvrent pour moi de tels abîmes. »94. Mais encore une fois, le schéma actanciel met en évidence un élément pathétique : l'ultime trahison du page Dino del Moro, à la fin de la pièce. L'aveuglement de Ferrante est alors total : il estime Egas Coelho qui est un de ses Opposants, et lui accorde sa confiance malgré son intuition d'un « secret », et tue Iñès alors que celle-ci était le personnage finalement le plus susceptible de compter parmi ses Adjuvants ; enfin, aveuglé sur lui-même au point de ne pas se comprendre, il place une ultime fois sa confiance en ce jeune page, qui l'a déjà trahi en parlant aux gens de l'Infante...
Ce qui le rend pathétique est surtout l'effet de contraste qui s'opère à la fin de la pièce : Ferrante y apparaît vieux, faible et seul : le jeune page le trahit et l'abandonne, comme tous ses sujets :
« [ En silence, tous s'écartent du cadavre du Roi étendu sur le sol[...] à l'exception de Dino del Moro qui, après un geste d'hésitation, est resté un genou en terre auprès du Roi.[...] Le page se lève avec lenteur, regarde longuement le cadavre, passe avec lenteur vers la civière, hésite, se retourne pour regarder encore le Roi, puis, se décidant, va s'agenouiller avec les autres, lui aussi[...] Le cadavre du Roi reste seul. » [A. 3, sc. 8, p. 149.]
La mort de Ferrante est essentiellement tragique : le dernier mot de la didascalie est celui de la fin : le héros est « seul » dans toute la pièce et jusque dans la mort, et cette solitude est soulignée par la longueur du jeu scénique, lui-même souligné par le silence. Lancrey-Javal nomme un de ses chapitres « Un manipulateur victime d'une manipulation finale », et considère la mort du roi comme « une variante tragique du trompeur trompé de comédie »95.
Le pathétique vient, en effet, plus que de la trahison en elle-même, de l'aveuglement du personnage qui répondait à Iñès avec superbe :
« Vous ne faites jamais confiance à l'homme, vous ?
- Je fais quelquefois confiance à sa crainte. »[A. 3, sc. 6, p. 140.]
Ferrante est abusé, comme Malatesta dans sa « tragédie de l'aveuglement », par un subalterne qu'il a vraisemblablement irrité - la différence étant qu'ici il s'agit d'un enfant : celui-ci s'était plaint du Roi à Iñès :
« Le Roi ne m'aime pas. Pourquoi l'aimerais-je ? [...] Il est sans cesse à se moquer de moi. Oui, toujours ! Pour mes cheveux, pour mon accent. Il ne peut pas me dire un mot sans se moquer de moi. »[A. 3, sc. 2, p. 114.]
L'auteur évoque la fin du héros en mettant l'accent sur les renversements qu'elle opère : « Le destin le frappe où il frappa. Iñès a fait un acte de confiance envers lui, et il l'a trompée ; à son tour, mourant, il fait un acte de confiance en Dino del Moro, et celui-ci le trahit. Le roi « voyant », le roi qui « connaît tout cela », choisit entre tous, pauvre dupe ( dupe comme demain Malatesta ) , pour être sa sauvegarde devant Dieu, le mauvais ange ( « Que l'innocence de cet enfant me serve de sauvegarde » ) , traître à son roi vivant et traître à son roi mort. »96.
Mais sa mention du « destin » est révélatrice : Ferrante est un héros de tragédie, donc un héros tragique ; il n'est ni uniquement pathétique, ni uniquement sublime, mais les deux tour à tour ou simultanément : encore ici son identité théâtrale s'avère double, Ferrante est d'une certaine façon toujours indéterminé...
Finalement, c'est sa complexité, son absence d'unité même qui est tragique, qui le rend tragique en générant solitude donc incompréhension, incompréhension donc solitude, douleur enfin. Ferrante est plus « un roi de douleur » que de « gloire »97.
Il nous faut bien nous contenter de qualifier Ferrante de héros tragique, simplement, en remarquant que dans son cas, l'emploi de ces mots pourrait presque être considéré comme un oxymore...
Le point de vue théâtral, loin de nous avoir permis de trouver une unité au personnage, a au contraire mis plus en valeur ces contradictions de Ferrante qui font le suspense dramatique : le schéma actanciel a montré que l'Objet du désir du Roi et notamment ses motivations ( le Destinateur ) , étant indistincts, remettaient en question le personnage lui-même ( le Sujet )...
Cela est évident, « ce qui rend plus tragique l'existence des tendances contradictoires dans la nature humaine, c'est que les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes »98.
Il nous faut prendre un point de vue existentialiste - sachant que si l'existentialisme refuse l'idée d'une fatalité, il n'en est pas moins « toujours caractérisé par une conception particulièrement dramatique du destin de l'homme »99 - pour considérer les actes de Ferrante, et notamment un, unique : celui de la mise à mort d'Iñès. Car le personnage agit : le pourrait-il sans motivation(s) ? N'y aurait-il sinon qu'un « tragique de l'absurde » sur lequel conclure ? 100
Il va s'agir de vérifier si l'on peut, au regard de cet élément concret qu'est l'acte, fixer Ferrante dans une identité.
Après avoir cherché l'identité de Ferrante en considérant son « personnage » puis sa « personnalité », c'est-à-dire ce qu'il est en apparence et ce qu'il est en « théorie », puis en le considérant comme un personnage au sens strictement théâtral, nous n'avons pu lui trouver une unité fondamentale :il nous faut par conséquent aborder ce qu'il est en « pratique », - non plus de l'extérieur mais de l'intérieur de la pièce -, donc aborder le problème de l'acte : l'acte, à la fois fait d'agir, action en général, et acte particulier, celui que commet Ferrante. Ce dernier nous permet-il de définir le vieux Roi ?101
Il s'agit de prendre une optique existentialiste pour s'interroger sur son identité, car l'existentialisme prône une définition de l'homme par ses actions : celles-ci font son existence parce que l'homme est seul dans un monde sans Dieu, il est, selon la formule de Sartre, « condamné à être libre » et à agir... Nous retrouvons ici une idée de la métaphysique de Nietzsche - à la base de la pensée existentialiste athée - , qui affirmait la mort de Dieu et la subjectivité de l'individu (du moins, la subjectivité impossible, jamais atteinte, nous l'avons vu.).
C'est dans cette optique existentialiste que nous allons tâcher maintenant de voir si ce que Ferrante fait revient à ce qu'il est, et l'identifie. Il nous faut préciser ici la part de notre propre mauvaise foi dans l'étude que nous allons faire des motivations potentielles de l'acte de Ferrante, car elle ne considère pas immédiatement l'absurdité fondamentale liée à cet acte102.
Un constat est évident : Ferrante accorde aux actes en général une très grande importance ; tout au long de la pièce, nous y reviendrons, il semble obsédé par le fait d'agir ou de ne pas agir et parle de « la tragédie des actes »103. En quoi les actes constituent-ils un problème essentiel à ses yeux, nous le verrons plus tard (en nous interrogeant également sur la cause de ce problème). A ce stade de la réflexion, il s'agit d'abord de se focaliser justement sur un acte particulier, la mise à mort d'Iñès de Castro, et de se demander pourquoi Ferrante finit par commettre cet acte-là.
La mise à mort d'Iñès a fait couler beaucoup d'encre chez les critiques, nous le constaterons d'ici quelques lignes.
Pourquoi une telle importance donnée à cet acte ? D'abord parce que c'est le seul, non seulement de Ferrante, mais de toute la pièce, qui est essentiellement statique ; on ne considérera pas la mise en prison de Pedro comme un acte : d'abord parce qu'il s'agit d'un ordre, au sein de la pièce, dont les effets ne sont que de peu d'importance et surtout très temporaires, et parce qu'au-delà, ce qui fait son intérêt est qu'il est »prétexte », tout autant sinon plus, à montrer le lyrisme amoureux d'Iñès et de Pedro qu'à montrer un aspect de la personnalité de Ferrante.
De ce fait, la décision de tuer Iñès prend un relief extraordinaire, elle n'apparaît plus d'un point de vue dramatique que comme le déclencheur du dénouement final, semblant attendu jusque là. En cherchant les signes d'une fatalité dans la pièce, nous avions vu en quoi cette attente participe de la dimension tragique des personnages ; parallèlement, cet acte pose la question de la (ou des) motivation(s) de Ferrante, puisque lui-même s'interroge :
« Pourquoi est-ce que je la tue? Acte inutile, acte funeste. » [A. 3, sc. 7, p. 143]
Cette ignorance du protagoniste aiguise encore notre curiosité à son encontre... Si nous pouvons dégager clairement la (ou les) motivation(s) de son acte, parviendrons-nous à savoir qui est Ferrante ?
Toutes sortes d'hypothèses s'offrent à nous : motivations précises, ou au contraire très floues ? Motivations impliquant Iñès, Ferrante et tout le royaume ? Iñès, Ferrante et les conseillers de celui-ci ? Iñès et Ferrante uniquement ? Ou encore Ferrante seul, indépendamment – si l’on peut dire - de cette dernière ?
Quelle est la motivation de Ferrante, que constitue pour lui la mort d'Iñès ?
La première hypothèse qui vient à l'esprit est celle de la raison d'État ; Iñès ne pose a priori problème au vieux Roi que parce qu'elle empêche le mariage de Pedro avec l'Infante de Navarre, donc constitue une entrave à la politique que Ferrante entendait mener :
« C'est [l'Infante], oui, c'est elle qu'il faut à la tête de ce royaume. Et songez à quelle force pour nous : le Portugal, la Navarre et l'Aragon serrant la Castille comme dans un étau ! Oui, je suis passionné pour ce mariage. » [A. 1, sc. 3, p. 29]
Les paroles qu'il prononce lors de cette même scène à propos d'Iñès prennent immédiatement une résonance funeste :
« ...je ne lui veux pas de mal. Mais il ne faut pas qu'elle me gêne. Un Roi se gêne, mais n'est pas gêné. » [p. 28]
Mais sera-t-il réellement question du Roi, ou de l'homme ?
Car comment penser que la raison d'État constitue une raison suffisante aux yeux de Ferrante, selon lequel, nous l'avons vu, l'exercice du pouvoir n'a plus d'intérêt réel ? Ce même s'il l'accepte encore le temps que cette alliance entre Espagne et Portugal se fasse, puisque justement celle-ci permettrait la succession du trône : l'Infante, étant pour lui « le fils qu'[il] aurai[t] dû avoir »104, régnerait à sa place...
Un crime apparaît dans ces conditions une solution complètement disproportionnée... Et quand bien même le Roi serait réellement « passionné pour ce mariage », comme il l'a affirmé ; car Iñès est une femme - une femme enceinte, et enceinte de son propre fils, ce qu'il apprendra plus tard. Aussi le voit-on repousser par plusieurs exclamations la proposition d'assassinat d'Egas Coelho :
« Doña Iñès est la moins coupable. Il n'y aurait rien contre elle sans don Pedro et sans l'évêque. [...] Qu'elle soit emprisonnée ? Exilée ? [...] Quoi ! La faire mourir ! Quel excès incroyable ! [...] L'amour payé par la mort ! Il y aurait grande injustice. » [A. 2, sc. 1, p. 61]
Le temps qu'il met à comprendre l'intention de son conseiller prouve en outre à quel point une solution aussi radicale était loin de lui.
Enfin, même en considérant que Coelho l'en ait, en l'énonçant, rapproché, cette solution reste peu vraisemblable d'un point de vue politique, et Ferrante en a bien conscience :
« Et je dresse contre moi mon fils, à jamais. Je détruis entre lui et moi toute possibilité de rémission, de réconciliation ou pardon aucun, irrévocablement. » [A. 2, sc. 1, p. 66.]
Aussi va-t-il jusqu'au tout dernier moment rester modéré : il « libère » Pedro et laisse Iñès à Mondego.
« Ce n'est pas par bonté que je ne punis pas plus rudement le Prince, c'est par raison : parce qu'un âne a fait un faux-pas, devrait-on lui couper la jambe ? Ce n'est pas par bonté que, vous, je ne fais rien contre vous, c'est surtout par politique. » [A. 2, sc. 3, p. 79]
Il est de fait quasiment certain que Pedro, si Ferrante était resté en vie après l'exécution d'Iñès, aurait refusé le mariage avec l'Infante et peut-être même le pouvoir tout court. Cette hypothèse de la raison d'État nous semble donc très peu probable105, même si c'est la seule explication que Ferrante avouera devant ses sujets - car il ajoutera juste ensuite « J'ai fini de mentir. » :
« Messieurs, doña Iñès de Castro n'est plus. Elle m'a appris la naissance prochaine d'un bâtard du prince. Je l'ai fait exécuter pour préserver la pureté de la succession au trône, et pour supprimer le trouble et le scandale qu'elle causait dans mon État. C'est là ma dernière et grande justice. [...] j'ai mon royaume, j'ai mon peuple, j'ai mes âmes ; j'ai la charge que Dieu m'a confiée et j'ai le contrat que j'ai fait avec mes peuples [...] » [A. 3, sc. 8, pp. 145-6]
Cette hypothèse d'un sadisme de Ferrante, beaucoup l'ont formulée, de personnages de la pièce - l'Infante, Ferrante lui-même - à l'auteur et par voie de conséquence à de nombreux critiques.
Nous avons vu que le premier mouvement de Ferrante, à la suggestion de tuer Iñès, était celui de la surprise et du refus. Néanmoins, nous ne pouvons que constater qu'il n'éprouve aucune indignation réelle ; ses exclamations répétées ne sont que l'expression d'un vif étonnement.
L'absence de cette réaction est-elle due, devant les précautions de ses conseillers pour aborder le sujet du meurtre, à la volonté de ne pas les effrayer et les laisser dévoiler leurs intentions ?On sait la curiosité de Ferrante envers ce qui pousserait, plus particulièrement, Egas Coelho106.
Pourtant, cette curiosité et son insistance, il ne les exprime qu'ensuite, et s'en tait sur le moment : pourrait-il s'agir de calcul de sa part ? On pourrait plus facilement penser que son absence d'indignation est due à son âge, son âge cumulé avec l'exercice du pouvoir, et l'exercice du pouvoir l'a rendu cynique - toute la première scène de l'acte 2, à part le dialogue final à propos d'Iñès, le montre complaisamment sous ce jour, nous l'avions constaté - et de toute façon moins sensible...
Aussi le voit-on accepter la discussion avec ses conseillers, continuer un échange d'arguments au sujet du meurtre, et ce sans conviction particulière : certes Ferrante demande, « N'est-ce pas cruauté affreuse, que tuer qui n'a pas eu de torts ? »107, mais c'est une question au lieu d'être une affirmation :comme l'Infante le résumera, « il n'a pas repoussé [cette idée] aussi vivement qu'il eût dû. »108.
Pour autant, Ferrante ne semble pas à ce stade de la pièce prêt à exercer quelque cruauté que ce soit sur Iñès... Alors pourquoi le ferait-il ensuite ? Est-il vraiment sadique ? La cruauté lui procure-t-elle vraiment du plaisir, ou le laisse-t-elle simplement indifférent, insensible en quelque sorte ? Il est vrai, par deux fois Ferrante semblera, puisqu’ avouera, tirer un certain contentement de la souffrance d'Iñès : déjà quand il propose à celle-ci d'être confrontée à l'un de ceux qui souhaitent sa mort, ce qui l'horrifie :
« Mais peut-être vous eut-il plu de connaître un homme qui me demande de vous faire assassiner. »
puis, après le cri d'Iñès :
« Voir vos contenances, à l'un et à l'autre, il faut avouer que c’est été divertissant. » [A. 3, sc. 2, p. 110]
et surtout après lui avoir exposé complaisamment ses vues pessimistes sur la condition parentale, ce qui a bouleversé Iñès au point qu'elle s'exclame : « Vous savez l'art des mots faits pour désespérer ! »109, il se dit à part lui :
« Je crois que j'aime en elle le mal que je lui fais. » [A. 3, sc. 6, p. 138]
Mais même si Ferrante tourmente Iñès par ses propos, peut-on parler de sadisme sans exagérer ? Car s'il éprouve un certain plaisir à l'effrayer, la mettre à mort lui en procurerait-il ? Ferrante lui-même exclut cette motivation en raison de son caractère excessif :
« Il y en a qui disent [...] que la cruauté est le seul plaisir qui reste à un vieillard, que cela remplace pour lui l'amour. Selon moi, c'est aller trop loin. » [A. 3, sc. 6, p. 123]
Certes l'excès caractérise souvent Ferrante alors même qu'il prône la modération ; mais après avoir donné l'ordre de l'exécuter, il déclare qu'« un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge »110, et ce terme de « remords » indique assez l'absence de plaisir sadique chez lui ; et quand il ajoute :
« Plus je mesure ce qu'il y a d'injuste et d'atroce dans ce que je fais, plus je m'y enfonce, parce que plus je m'y plais. »
Il ne faut pas s'y tromper :il n'est pas question d'Iñès, mais de lui. Son sadisme serait tourné contre lui, il s'agirait alors au contraire de masochisme... Quoi qu'il en soit pour l'instant, cette hypothèse n'est guère satisfaisante, et ces moments de cruauté chez Ferrante, dont la mise à mort, seraient indépendants de toute notion de plaisir...On a pensé alors pour les expliquer à une sorte de haine de la vie qui se rapprocherait de la cruauté111, et qui résulterait de sa vieillesse ; c'est notamment une affirmation de l'Infante qui laisse supposer cette « motivation » :
« ... c'est à la fin du combat de taureaux que le taureau est le plus méchant. » [A. 2, sc. 5, p. 92]
Cette haine serait due à la fois à son âge avancé, d'où naîtrait une lassitude extrême, et à l'approche - directement consécutive ou non - de sa mort, d'où naîtrait un dépit tout aussi extrême ; et en effet, Ferrante fait à plusieurs reprises preuve de ces deux sentiments : déjà quand il demande à don Christoval, le précepteur de Pedro, de l'arrêter :
« Don Christoval, je vous confie une mission bien pénible pour vous. [...] Vous, au contraire, et nul autre que vous. Cela vous fait souffrir ? Eh bien, maintenant il faut que l'on commence à souffrir un peu autour de moi. » [A. 1, sc. 6, p. 49]
On ne sait si Ferrante a choisi cet homme sans arrière-pensée et s'est irrité ensuite de ses protestations, s'il l'a choisi délibérément pour punir l'affection qu'il continue de nourrir pour son fils « indigne », ou plus « gratuitement », poussé par une haine générale qui a pris momentanément pour cible particulière don Christoval...
Il est certain que la lassitude qu'éprouve Ferrante dépasse celle du statut royal, que nous avons constatée, qu'elle s'avère lassitude de l'existence même :
« Un enfant ! Encore un enfant ! Ce ne sera donc jamais fini ! [...] Encore un printemps à recommencer, et à recommencer moins bien ! » [A. 3, sc. 6, p. 132]
Ces exclamations poussées par Ferrante au moment où Iñès lui apprend qu'elle est enceinte de Pedro font écho au discours qu'il lui tenait déjà à l'acte précédent, quand il ignorait son état :
« Regardez ce printemps. Comme il est pareil à celui de l'an dernier ! Est-ce qu'il n'y a pas de quoi mourir d'ennui ? [...] Pour moi, tout est reprise, refrain, ritournelle. Je passe mes jours à recommencer ce que j'ai déjà fait, et à le recommencer moins bien. » [A. 2, sc. 3, pp. 76-7]
Si ce discours, qui devient lui-même « refrain », nous montre Ferrante sous un jour inquiétant, c'est pour lui-même... Lui seul est concerné, indépendamment de la jeune femme : comment penser en effet que cette lassitude en soi soit dangereuse pour Iñès, alors qu'elle s'apparente à une indifférence qu'il ne cesse de proclamer ?
Soit que cette indifférence se trouve feinte, soit qu'elle se trouve réelle mais épisodique, c'est tout au contraire le dépit, l'aigreur que Ferrante éprouve à plusieurs reprises, mais sans l'admettre, qui s'apparenterait à une haine de la vie :
« Et je suis fatigué de vous, de votre existence. Fatigué de vous vouloir du bien, fatigué de vouloir vous sauver. Ah ! Pourquoi existez-vous ? Enrageant obstacle que celui des êtres ! Un fleuve, une montagne, on comprend, on accepte. Mais une pauvre chose molle de chair et de nerfs, qui se tient droit on ne sait comment...[...] Heureux celui qui a peu donné, et, ce qu'il avait donné, qui l'a repris. Heureux celui de qui les enfants ne portent pas le nom. » [A. 3, sc. 5, p. 118]
La lassitude qu'il met en avant se mue en une « irritation » progressive, qui rappelle l'énervement capricieux de l'Infante devant Iñès, puis devient jet d'aigreur incohérente car sans rapport avec le contexte...On peut penser que ce dépit, s'il n'est pas provoqué par la présence d'Iñès - puisqu'il lui préexiste, en est amplifié par contraste : car Iñès, tout amour et dans l'attente d'un enfant, apparaît comme le symbole de la vie en regard du vieux Roi qui, lui, a renié son amour pour son fils et attend la mort... Il semble que Ferrante ne supporte pas ce contraste et veuille transmettre à Iñès son dépit :
« J'aime décourager. Et je n'aime pas l'avenir. » [A. 3, sc. 6, p. 136]
Puis, après avoir tenté de la convaincre que son enfant sera source de déception et de souffrance :
« Et vous, Iñès, vous semblez avoir singulièrement parié pour la vie. [...] Vous êtes bien fraîche pour quelqu'un que menacent de grands tourments. Vous aussi faites partie de toutes ces choses qui veulent continuer, continuer... Vous aussi, comme moi, vous êtes malade :votre maladie à vous est l'espérance. [...] Je ne vous menace pas, mais je m'impatiente de vous voir repartir, toutes voiles dehors, sur la mer inépuisable et infinie de l'espérance. La foi des autres me déprime. » [pp. 137-8]
Il semble évident que l'extrême aigreur de Ferrante menace Iñès, même si Ferrante nie son agressivité dans l'intention de la berner ; mais cette agressivité irait-elle jusqu'à une haine mortelle ? Nous arrivons à un paradoxe : supposer que Ferrante soit conduit au meurtre parce qu'il a appris la grossesse d'Iñès, alors qu'il repoussait cette « solution » politique du meurtre en faisant justement valoir l'argument de la vie :
« La nature ne se révolte-t-elle pas, à l'idée qu'on ôte la vie à qui la donne ? Et doña Iñès, de surcroît, est une femme bien aimable. » [A. 2, sc. 1, p. 63]
S'il s'agit d'une haine générale de la vie, que penser alors de sa patience, avec les pages notamment ? Car une scène du deuxième acte nous montre ces derniers, non seulement peu impressionnés par le Roi, mais même insolents à son égard... Et Ferrante, que l'on a vu orgueilleux et sévère à l'extrême, ne réagit pourtant pas112...
S'il s'agit d'une haine générale de la vie, pourquoi prendrait-elle pour objet Iñès exclusivement et surtout si tard ? Car Ferrante a fait également preuve de patience envers Iñès, dès le départ et jusqu'au dernier moment... Ainsi par exemple, il use de précautions oratoires pour la pousser à l'aider alors qu'il pourrait s'en abstenir :
« Cela peut vous être dur, mais il le faut. [...]Doña Iñès, je suis prêt à donner aux sentiments humains la part qui leur est due. Mais non davantage. Encore une fois, ne me forcez pas à vous soutenir le point de vue de l'État, qui serait fastidieux pour vous. » [A. 1, sc. 5, p. 46]
« Soyez raisonnable ; vous avez tout à y gagner. [...] Je regrette de devoir poser des conditions. Les nécessités du règne m'ont forcé de me faire à ce langage. » [A. 2, sc. 3, pp. 80-1]
C'est bien de patience qu'il fait preuve ici, puisqu'à la proposition d'Iñès qu'il voie directement Pedro pour lui parler, il réplique que cette patience lui « sortirait par tous les pores »...
Qui plus est, Ferrante avait à propos de la jeune femme des a priori positifs :
« Je connais peu Iñès de Castro. Elle a de la naissance, bien que fille naturelle. On parle d'elle avec sympathie, et je ne lui veux pas de mal. » [A. 1, sc. 3, p. 28]
« Votre renommée m'avait prévenu en votre faveur. Votre air, votre contenance, jusqu'à votre vêtement, tout me confirme que vous êtes de bon lieu. Et ainsi je ne doute pas que vous ne trouviez en vous-même de quoi vous égaler aux circonstances où vous nous avez mis. [...] Il me plaît que vous soyez un peu portugaise par votre mère, alors que votre père était gentilhomme d'une des plus anciennes familles de Galice. » [A. 1, sc. 5, p. 42]
Ne peut-on penser que ce que certains critiques ont pris pour une haine trouvant Iñès comme à point nommé pour se décharger soit en fait une « haine » provoquée précisément par cette dernière, qui montre au fil de leurs entretiens ce qu'elle est ? L'important n'est-il pas sa capacité à « s'égaler aux circonstances » ?
Car enfin, Ferrante aurait-il fait exécuter l'Infante, ou Iñès si elle avait eu la personnalité de l'Infante ? Il nous semble irrésistiblement que non...
Nous avons bien vu que les intérêts du Roi, effacés par l'indifférence, se distinguaient par moments de ceux de l'homme qui s'est construit une théorie de la qualité... Pourrait-on imaginer qu'à l'inverse de l'Infante, Iñès ne corresponde pas à la vision exigeante des êtres qu'a Ferrante, et qu'il l'en « punisse » comme il a puni Pedro ?113
Si la motivation de Ferrante naissait de sa connaissance d'Iñès, approfondie au fil de la pièce, cela revient à dire de la jeune femme qu'elle correspondrait à ce que lui condamne dans sa théorie élitiste :la médiocrité. Il nous est donc nécessaire de passer le personnage d'Iñès au crible de cette théorie114.
Nous venons de le voir, au départ Ferrante est disposé à être bienveillant envers elle ; outre ses a priori positifs, il fait preuve de patience mais aussi de gentillesse à son égard :
« J'ai voulu vous faire sourire. Lorsqu'on doute si un inconnu est dangereux ou non, il n'y a qu'à le regarder sourire :son sourire est une indication, quand il n'est pas une certitude. Le vôtre achève de vous révéler. Eh bien ! Doña Iñès, je plaisantais :soyez toujours vraie avec moi ;vous n'aurez pas à vous en repentir. » [A. 1, sc. 5, p. 44]
Cette mention de son sourire annonce tout le personnage, le résume, et Ferrante l'a vu, lui qui y fera une seconde allusion à l'acte suivant :
« ...vous, on dirait que vous êtes née d'un sourire... » [A. 2, sc. 3, p. 78]
Iñès sera toujours « vraie » avec le Roi, et pourtant sa mise à mort sera décidée... Qu'est-ce qui, dans cette vérité, pourrait irriter Ferrante ?
Iñès est dans la pièce symbole de vie - une vie qui sera sacrifiée - parce qu'elle incarne l'amour, la douceur de l'amour, l'innocence de l'amour. Ce qui la caractérise, c'est la pureté ; les images le montrent :
« La cour est un lieu de ténèbres. Vous y auriez été une petite lumière. » [A. 1, sc. 5, p. 43]
« La déchirure [de la mante] s'ouvrait sur votre cou. Je vous ai suivie à cette petite blancheur qui bougeait dans la pénombre. » [A. 2, sc. 5, p. 98]
Les propos de Ferrante et ceux de l’Infante vont dans le même sens : ils témoignent de la pureté d'Iñès, en la faisant correspondre au critère du lumineux (la « blancheur » vaut ici par contraste avec l'obscur)... mais aussi au critère du petit. De même, quand Ferrante dit d'elle :
« Inutile [d'emmener un confesseur]. Son âme est lisse comme son visage. [...] Quand elle regardait les étoiles, ses yeux étaient comme des lacs tranquilles... » [A. 3, sc. 7, pp. 144-5]
Les images véhiculent en même temps l'idée de sa pureté, et celle de son horizontalité :ce thème du « lisse » se retrouve dans Fils de personne, pour signifier la platitude et la médiocrité de Gillou ; et celui de l'eau symbolise l'irrémédiable différence entre Ferrante et l'Infante d'un côté, comparés à l'eau profonde, celle de la mer, tandis qu'Iñès comparée à celle des lacs est, avec Pedro, du côté de l'eau stagnante et peu profonde...Elle-même compare d'ailleurs son enfant à « une barque sur une eau calme »115.
Cette horizontalité, que nous avons déjà vue dans les images de l'oiseau, se retrouve même chez Iñès dans la pureté de ses intentions ; son honnêteté et son courage, visibles notamment dans la scène où elle renonce à faire parler le jeune page qui pourrait pourtant la sauver, ont fait dire à l'Infante :
« Vous êtes molle, et en même temps trop courageuse. » [A. 2, sc. 5, p. 102]
Cette affirmation est à rapprocher de ce que dit Ferrante à la fin de la pièce :
« Toutes les femmes, je l'ai remarqué, tournent avec obstination autour de ce qui doit les brûler. » [A. 3, sc. 6, p. 186]
Car c'est bien d'une obstination qu'il s'agit : Iñès est constante dans ses positions comme dans ses sentiments, linéaire pour ainsi dire... Ainsi est-elle « dure dans la mollesse », à l'opposé de l'Infante - « molle dans la dureté » puisqu'elle changera d'avis en tentant de sauver une ultime fois Iñès de la mort... Et ce revirement est vertical, on l'a vu.
La seule verticalité dans une image d’eau chez Iñès est dirigée vers le bas : la cascade symbolise la fatalité, la pente sur laquelle Iñès se laisse glisser... Et cette forme de facilité peut être assimilée à la bassesse dans la théorie de Ferrante :
« Voyez cette cascade : elle ne lutte pas, elle suit sa pente. Il faut laisser tomber les eaux. » [A. 2, sc. 5, p. 101]
Le principe de bassesse rejoint celui de platitude ; chez Iñès, la conception du divin même est matérielle, « terre à terre », horizontale :
« Dieu me protégera, si j'en suis digne. Mais pourquoi regarder le ciel ? Regarder le ciel me ramène toujours vers la terre, car, les choses divines que je connais, c'est sur la terre que je les ai vécues. » [A. 2, sc. 5, p. 104]
Cet exemple montre les « limites » d'Iñès : la naïveté de ses idées, comme celle d'une protection divine liée à une notion du mérite sans rapport avec celle à laquelle Ferrante est susceptible de la confronter, rejoint la naïveté de l'expression (l'article défini qui actualise la seconde occurrence du mot « terre » met un accent involontaire sur ce « matérialisme »)...
Peut-on penser que c'est cette unité d'Iñès, son caractère entier qui irrite Ferrante dans sa dualité, Ferrante qui apprécie une part de « boue » chez les autres ?116. Ce qu'il dit à Egas Coelho résonnerait alors comme une menace pour Iñès :
« Je ne pourrais pas être d'accord longtemps avec quelqu'un qui serait tout à fait limpide. » [A. 2, sc. 2, p. 72]
Pourtant, si nous prenons le point de vue du Roi, Iñès aussi a une faille, un trait commun à Ferrante : l'égoïsme... A de multiples reprises en effet, cet égoïsme transparaît :tout ce qu'Iñès voit, ce qu'elle place avant tout, c'est son propre bonheur et son propre plaisir :
« Pourquoi vous marier ?
- Mais...pour être plus heureuse.
- Plus heureuse ! [...] Encore, si vous me répondiez : pour sortir du péché. » [A. 1, sc. 5, pp. 47-8]
« Ne parle pas ! Ne parle pas ! Mon Dieu, assistez-moi dans ce bonheur suprême ! [...]
- Iñès, si tu...
- Ne parle donc pas ! Cet instant qui n'existera peut-être jamais plus. [...] » [A. 2, sc. 4, p. 85]
Que ce soit face à Ferrante ou à Pedro, Iñès ne se pose aucune question autre que celle de son intérêt : elle n'est en fait pas prête à aider Ferrante, nous en avions fait la remarque :
« [Le Roi] voudrait... Mais moi je ne veux pas !
- Quoi ?
- Que j'obtienne ta promesse d'épouser l'Infante, si le Pape donne l'annulation. Mais moi je ne veux pas, je veux que tu restes à moi seule. Est ce que tu m'aimes ? » [pp. 88-9]
Il y a même à la fin de la pièce une parole de dureté extrêmement surprenante dans la bouche d'Iñès, concernant son enfant :
« Mais qui vous a dit que [votre enfant] était un petit garçon ? L'astrologue ?
- Je le veux trop ainsi. [...] J'accepte de devoir mépriser l'univers entier, mais non mon fils. Je crois que je serais capable de le tuer, s'il ne répondait pas à ce que j'attends de lui. » [A. 3, sc. 6, pp. 134-5]
Mais cette phrase ne trouve plus aucun écho par la suite : Iñès est essentiellement douce. Elle dira à la fin de son entretien avec Ferrante :
« Oui, vous ne me tueriez pas avant que j'aie embrassé [Pedro] encore une fois. » [A. 3, sc. 6, p. 141]
Ce qui est frappant dans tous ces exemples, c'est combien Iñès ne voit pas loin, combien ne compte que son intérêt à court terme... Et cette petitesse de vue va jusqu'à l'aveuglement. Mais la différence avec Ferrante est double : non seulement l'égoïsme d'Iñès va directement à l'encontre de celui de Ferrante, mais il est en outre lié à l'amour qu'elle nourrit pour Pedro et pour son enfant... Et l'amour, nous le savons, n'est pas considéré par Ferrante comme une valeur.
L'unité d'Iñès, plus que dans la pureté, réside fondamentalement dans cet amour dont elle est l'incarnation, la personnification par excellence :
« Puis on me dit : « Doña Iñès est pleine de douceur pour tous. », et j'aimais ces mots. » [A. 2, sc. 5, p. 97]
« Je n'ai pas été faite pour lutter, mais pour aimer. Toute petite, quand la forme de mes seins n'était pas encore visible, j'étais déjà pleine d'amour pour mes poupées ;et il y en avait toujours une que j'appelais l'Amant, et l'autre la Bien-Aimée. Et déjà, si l'on m'avait ouvert la poitrine, il en aurait coulé de l'amour, comme cette sorte de lait qui coule de certaines plantes [...] » [p. 100]
L'enfant qu'elle attend devient lui-même symbole d'amour : c'est l'amour qu'elle porte, c'est l'amour dont elle est « pleine » :
« Iñès, femme chérie, mon amour au nom de femme, Iñès au clair visage, plus clair que les mots qui le bercent, vous qui êtes le lien qui m'unit à tous les êtres ; oui, tous les êtres attachés à vous, et à vous seule, comme les fruits sont attachés à l'arbre117...[...]
- [...]il me semble que je suis soutenue par notre enfant. [...] Lui, cette fabrication de chaque instant [...] cela fait de lui mon bien [...] ses bras sont autour de mon cou comme est l'eau, l'été, quand on y plonge, et qu'elle se referme sur vos épaules, toute pleine de soleil. Et il fait autour de mon cou un doux chantonnement qui roucoule... » [A. 1, sc. 4, pp. 39-40]
Cet amour est complètement fusionnel :Iñès n'apparaît plus que comme une enveloppe protectrice, un « réceptacle » d'amour :
« Il est au chaud de mon cœur, et je voudrais me faire plus chaude encore pour l'abriter mieux. [...] nous sommes complices. Il frappe timidement ;alors je me sens fondre de tendresse, parce que tout à coup je l'avais cru mort [...] » [A. 2, sc. 4, p. 88]
« Moi qui aime tant d'être aimée, j'aurai fait un être dont il dépendra entièrement de moi que je me fasse aimer ! [...] Il est une révision, ou plutôt une seconde création de moi ;je le fais ensemble et je me refais. Je le porte et il me porte. Je me fonds en lui. Je coule en lui mon bien. » [A. 3, sc. 6, p. 132]
Notons que cet amour fusionnel con-fond également Pedro ; il est elle :
« Le jour où je l'ai connu[...]on a enlevé mon cœur et on a mis à sa place un visage humain. » [A. 1, sc. 5, p. 44]
« Est-ce ton cœur qui bat si fort, ou le mien ?
- Le nôtre. » [A. 2, sc. 4, p. 86]
« C'est [Pedro] qui est mon âme. » [A. 2, sc. 5, p. 102]
Mais il est aussi son enfant :
« [...] ce que je donne [à notre enfant], non seulement je ne vous le prends pas, mais en le lui donnant je vous le donne. Je te tiens, je te serre sur moi, et c'est lui. » [A. 1, sc. 4, p. 40]
« Mais don Pedro ? Oh ! Seigneur, pour lui, grâce ! [...]Dieu ! Il me semble que le fer tranche de moi mon enfant. » [A. 1, sc. 6, p. 49]
Le lyrisme d'Iñès n'empêche pas que nous constations le danger que cet amour comporte... Car nous l'avons vu, il est aussi synonyme de dépendance et « cause » de destruction118. Mais le sacrifice qu'il appelle n'est pas l'unique raison de la mort d'Iñès, à laquelle nous ne pouvons faire porter la responsabilité de sa propre exécution. Iñès est victime de son amour, mais dans la mesure où celui-ci correspondrait à une condamnation de Ferrante...
Déjà, l'amour qu'éprouve Iñès n'est pas fonction du « mérite », notion si importante aux yeux de Ferrante parce qu'elle fait la valeur des individus, et lui permet de les estimer :
« Je n'ai pas été faite pour lutter, mais pour aimer. [...] Aimer, je ne sais rien faire d'autre. » [A. 2, sc. 5, pp. 100-1]
Cette notion lui est même radicalement étrangère, ce qu'elle laissera spontanément entendre à Ferrante qui lui confiait son sentiment sur sa relation douloureuse avec son fils :
« Oh ! Si on se met à calculer ce que les êtres méritent ! » [A. 2, sc. 3, p. 82]
Pourtant, l'amour correspond à une profondeur à ses propres yeux, puisqu'elle dit de son enfant qu'il « défend cette région profonde de [son] être d'où sort ce qu['elle] donne à la création et aux créatures »119...
Ce qui est peut-être l'aspect le plus rédhibitoire de cet amour, c'est sa finalité, Pedro : Ferrante a condamné la médiocrité de celui-ci. Cela peut peser dans l'opinion de Ferrante sur Iñès :
« Et ce serait péché de vouloir diminuer l'image que vous vous faites du Prince, encore que, selon moi, elle soit un peu embellie. Selon moi, le Prince est...Comment dire ? le Prince est une eau peu profonde. » [A. 1, sc. 5, p. 45]
« Je comprends qu'un second Pedro soit en effet une perspective enivrante.
- Oui, enivrante. » [A. 3, sc. 6, p. 134]
Iñès, dans ce dernier exemple, n'a pas saisi l'ironie de l'antiphrase de Ferrante, toute à l'évocation de celui qu'elle aime... Sa réponse est une maladresse, puisqu'elle ne peut que déplaire à son interlocuteur ; que penser de l'immense naïveté dont elle ne cesse de faire preuve ? L'opposition de l'horizontalité et de la verticalité n'est-elle pas liée, malgré tout, à celle de la profondeur et de la platitude ?120
La superficialité qu'Iñès montre lors de sa rencontre avec l'Infante irait assez dans ce sens :
« On me cita ce trait :que, depuis des années, vous vous laissez coiffer on ne peut plus mal par votre coiffeur, pour ne pas lui faire de peine en le renvoyant. [Iñès porte la main à ses cheveux. ] Mais non, vous n'êtes pas si mal coiffée. Vous êtes coiffée par les mains de la Charité, c'est merveilleux !
- C'est que j'ai parfois besoin de laisser reposer mes cheveux. Alors, pendant une journée, je me coiffe en chignon. Seulement, cela donne un pli...
- Vos cheveux sont très bien, je vous assure ; ne vous en tourmentez plus. » [A. 2, sc. 5, p. 97]
Aussi certains critiques n'ont pas hésité à taxer le personnage de stupidité : ainsi Mohrt s'indigne : « Au cours du dialogue entre les deux femmes, l'Infante fait une remarque à Iñès sur sa coiffure, et celle-ci, immédiatement, saute sur cette remarque, la seule qui soit à sa portée dans toutes les choses sublimes que vient de lui dire l'Infante. Et soudain, au milieu de cette scène grandiose, on voit les deux femmes parler « chiffons ».[...] Iñès représente la « morale de midinette » [mais] cela ne l'empêche pas d'être touchante de pureté, sublime de dévouement. »121.
Une chose est sûre, c'est sa maladresse, qui se répète avec l'Infante comme avec Ferrante ; par exemple, quand elle froisse l’Infante qui voulait lui laisser son bracelet :
« Gardez-le, Iñès. [...]
- Si c'est un symbole, il y a des choses tellement plus pures que le diamant. » [A. 2, sc. 5, p. 106]
Mais devant Ferrante, sa maladresse est forcément un risque :
« Si vous étiez si méchant, vous ne le diriez pas.
- [Avec ironie] Je vois que vous avez une profonde connaissance de l'âme humaine. » [A. 3, sc. 6, p. 123]
La naïveté est le juste milieu entre l'innocence et la bêtise, elle est à la fois simplicité et excès de confiance... Nous pourrions relever son imprudence et son obstination dans l'aveuglement à de nombreuses reprises, malgré tous les avertissements :
« Donc, Egas Coelho et Alvar Gonçalvès ont demandé votre mort. Le Roi aurait pu couper court, d'un non énergique. Mais ils ont discuté interminablement. « Comme des avocats », dit le page. A la fin le Roi a dit : « J'y réfléchirai ». [...]
- « J'y réfléchirai »... Ce n'est pas un arrêt de mort... Le Roi, dans toute cette affaire, m'a traitée avec tant d'ouverture...
- Mon père dit du Roi Ferrante qu'il joue avec sa perfidie comme un bébé joue avec son pied.
- « J'y réfléchirai »... Il a peut-être voulu se donner du champ... » [A. 2, sc. 5, p. 94]
La scène dans laquelle Ferrante raconte son rêve est également révélatrice de la terrible imprudence d'Iñès, qui pousse le Roi à la confidence122 :
« Cette nuit - à cause peut-être d'une extrême souffrance que j'ai eue hier, - j'ai rêvé que j'agonisais. [...] J'écrivais sur ma peau, et elle était si pourrie que la plume par endroits la crevait.
- Et qu'écriviez-vous ? » [A. 3, sc. 1, p. 108]
Pourtant Ferrante lui-même d'une certaine manière la met en garde, en dénonçant et l'aveuglement de son interlocutrice et l'opinion qu'il en a :
« Le rêve... Vous ne croyez pas si bien dire. Vous êtes en pleine rêverie. [...] Je n'aime pas la naïveté. Je hais le vice et le crime. Mais, en regard de la naïveté, je crois que je préfère encore le vice et le crime. » [A. 3, sc. 6, p. 133]
Mais jusqu'au bout, Iñès ne sera pas réaliste ; elle affirmera très peu de temps après à Ferrante :
« [...] il me semblait parfois que, si les hommes savaient combien j'aime mon enfant, peut-être cela suffirait-il pour que la haine se tarît à jamais dans leur cœur. [...] Sa pureté défend la mienne. Sa candeur préserve la mienne contre ceux qui voudraient la détruire. Vous savez contre qui, Seigneur. » [p. 137]
Et cette absence totale de lucidité irrite Ferrante comme elle a à l'acte précédent irrité l'Infante :
« Vous aussi, comme moi, vous êtes malade :votre maladie à vous est l'espérance. Vous mériteriez que Dieu vous envoie une terrible épreuve, qui ruine enfin votre folle candeur, de sorte qu'une fois au moins vous voyiez ce qui est. »
C'est dans cette phrase que réside le problème : si Ferrante a définitivement, sous le coup de l'agacement, jugé Iñès médiocre, et s'il aimerait qu'elle reçoive une « leçon », il ne semble pas vouloir la lui donner lui-même ; son ton et ses mots sont assurément menaçants, mais son emploi du conditionnel et sa mention de Dieu comme seule puissance apte à la « punir » nous laissent au bout du compte dans l'incertitude.
De nombreux critiques ont évoqué une réaction d'orgueil, d'orgueil blessé pour expliquer l'acte de Ferrante ; il fallait, devant l'invraisemblance de la raison d'état, recourir à des hypothèses concernant l'homme plus que le Roi...
Nous l'avons constaté, l'orgueil est un trait dominant de Ferrante, malgré quelques moments d'humilité, ce trait constituant son plus important point commun avec l'Infante. Il semble bien qu'effectivement le discours insinuant des conseillers, lors de la première scène du second acte, touche ce point sensible :
« O Infante humiliée, je suis plus pareil à vous que vous ne vous en doutez ! [...] Ma fille dans l'amertume affreuse. » [p. 65]
La filiation que Ferrante exprime à cette occasion montre qu'il s'agit moins de l'honneur que de l'honneur attaqué... et blessé. Quelles sont ces attaques qui blessent Ferrante, et auxquelles il se pourrait qu'il réagisse par son acte ?
L'exécution d'Iñès a d'abord été présentée par les ministres de Ferrante comme un acte de « justice » : un « châtiment mérité », une « offense publique », puis comme une nécessité inspirée par la prudence : « ou le pardon avec ses folles conséquences, ou la mort. ». Puis Alvar Gonçalvès amène le premier argument qui fera du meurtre un témoignage, une preuve de force :
« ... on penserait que Votre Majesté a eu peur de verser le sang. Ce qui conviendrait mal à l'idée qu'il faut se faire d'un Roi. » [p. 62]
En suggérant que la clémence est indigne du Roi parce qu'il représente la puissance par excellence, il l'accuse de faiblesse. Et cette accusation, de suggérée va devenir affirmée, par la bouche d'Egas Coelho :
« On dira que, ce coup, vous avez bien osé tuer un ministre de Dieu ; mais non une femme... » [p. 63]
« La postérité appellerait cet acte une clémence, s'il se plaçait dans une suite d'actes énergiques. Dans le cas présent, elle l'appellera une faiblesse. »
« Votre Majesté, à cette heure, non seulement est faible réellement, sur certains points, mais, sur d'autres, elle est obligée de feindre la faiblesse [...] » [p. 64]
Et Don Alvar ajoute que :
« feindre la faiblesse risque de mener à la faiblesse même. »
Le Roi semblerait donc avoir eu « peur », il n'aurait pas « osé », cela apparaîtrait comme une « faiblesse »123...
Il nous faut nous demander pourquoi ces attaques devraient être déterminantes dans sa décision de tuer Iñès : elles ne le pourraient, d'abord, qu'à la condition que le Roi soit véritablement influençable... Encore une fois, tout est lié : Ferrante serait faible et influençable, faible donc influençable et faible parce qu'influençable.
Or dans la scène qui nous intéresse, nous pouvons voir que son discours se modifie peu à peu au fil de l'échange... Ainsi, notamment, Ferrante a déclaré à Iñès :
« Madame, ce n'est pas vous la coupable [...] » [A. 1, sc. 6, p. 48]
puis, devant ses conseillers :
« Doña Iñès est la moins coupable. » [p. 60]
« Le Prince et Iñès sont également coupables. » [p. 61]
Alors même qu'il parle toujours pour la défendre, Iñès apparaît plus coupable d'une affirmation à l'autre ; de même, alors qu'il a affirmé à son fils :
« Je pourrais exiler doña Iñès [...] Je ne le ferai pas. » [A. 1, sc. 3, p. 28]
il semble changer d'avis progressivement :
« Qu'elle soit emprisonnée ? Exilée ? » [p. 60]
« Je suis prêt à mettre doña Iñès dans un monastère. [...] Je puis l'exiler. » [p. 62]
Les solutions qu'il prêtait, déjà avec surprise, à ses conseillers et sans lui-même les avoir envisagées, il semble sur le point de les appliquer un instant plus tard... Il « peut » l'exiler, mais le veut-il ?
Le Roi semble donc susceptible d'être manipulé par ses conseillers, qui n'ignorent pas son orgueil ni la manière de blesser celui-ci. Pourtant au terme de cette scène, il faut bien constater que Ferrante n'a pas vraiment l'air convaincu, et il les laisse dans l'incertitude quant au choix qui sera le sien. En outre s'il a subi des attaques, il n'en est pas dupe : dès la scène suivante, il fera rester Coelho devant lui pour tenter de percer les raisons de son acharnement à vouloir la mort d'Iñès ; est-ce juste parce qu'il y échoue et que cela le contrarie, qu'il lui affirmera alors, pour le contrarier à son tour :
« Je ne tuerai pas Iñès de Castro. Vous avez entendu ? Je ne tuerai pas Doña Iñès. » [A. 2, sc. 2, p. 73]
Ou est-ce en même temps une affirmation sincère, ce que laisserait penser le fait qu'il dénonce immédiatement la tentative de manipulation dont il est l'objet à Iñès ? :
« Savez-vous ce qu'ils souhaitent ? Une politique d'intimidation contre don Pedro et contre vous. [...] S'ils en avaient l'audace - que bien entendu ils n'ont pas -, ils me demanderaient votre tête. Ils sont acharnés après moi comme les chiens après le taureau. Je résiste ; alors ils m'accusent d'être pusillanime. Comme par hasard, le dominicain qui parlait hier soir à ma chapelle a fait un sermon sur la fermeté ! » [A. 2, sc. 3, p. 78]
Ferrante informe Iñès de l'intention de ses ministres, mais omet de dire qu'ils l'ont déjà expressément formulée ; il nous semble qu'il ne fait pas cette omission dans le but d'épargner à la jeune femme une plus grande frayeur (Ferrante parlant de sa mort sur le seul plan de l'intention, que cette mort soit directement formulée ou non ne change rien), mais seulement dans celui de se démarquer plus d'eux en les taxant de lâcheté, donc de faiblesse... Mais n'est-ce pas à ses propres yeux plutôt qu'à ceux d'Iñès qu'il veut se démarquer d'une forme de faiblesse, et avoir par contraste l'air sûr de lui et fort dans ses positions ? Quoi qu'il en soit, comment penser que des insinuations quant à sa faiblesse vont constituer la motivation décisive de son acte, à partir du moment où il les a perçues et dénoncées ? Car la situation se répète au troisième acte :
« Mais peut-être toute cette histoire va-t-elle se dissiper comme une fumée. Car savez-vous ce que je crois ? Qu'elle est inventée de toutes pièces, ou du moins sensiblement gonflée. [...] Il s'agit de m'humilier, après l'humiliation du nonce. [...] On escompte que, blessé, je voudrai blesser ;que, souris ici, pour me revancher je me ferai matou là. Et matou contre qui ? Contre Pedro et vous. Mais leur puéril calcul est déjoué. Je vois trop clair dans leurs machines. » [A. 3, sc. 6, p. 124]
Et pourtant, il est indéniable que sa faiblesse lui pose plus qu'un problème, qu'il en est obsédé, même devant la « faible » Iñès :
« Je vous ai parlé de votre petit-fils au moment où vous souffriez, où vous étiez faible, non pour profiter de cet affaiblissement, mais parce qu'alors vous disiez la vérité. J'ai voulu vous la dire moi aussi, et vous rendre confiance pour confiance. [...]
- [...] Mais laissons cela. De tout ce que vous m'avez dit, je retiens que vous croyez m'avoir surpris dans un instant de faiblesse. Quelle joie sans doute de pouvoir vous dire, comme font les femmes : « Tout Roi qu'il est, il est un pauvre homme comme les autres ! ». Quel triomphe pour vous ! Mais je ne suis pas faible, doña Iñès. C'est une grande erreur où vous êtes, vous et quelques autres. » [A. 3, sc. 6, p. 141]
L'exécution d'Iñès serait alors à la fois réaction d'orgueil, blessé par des insinuations sur sa faiblesse, c'est-à-dire « preuve » de puissance, réaffirmée au détriment d'Iñès ;et réaction de crainte visiblement paranoïaque, peut-être moins du regard d'Iñès que de sa parole (si elle répétait ce que lui a dit le roi), donc du regard d'autres qu'elle... c'est-à-dire preuve de faiblesse, ce qui est complètement paradoxal. Il sera nécessaire de revenir sur cette faiblesse de Ferrante, qui nous semble essentielle au point de dépasser de très loin la notion d'orgueil, car le meurtre est tout sauf une preuve de puissance...124 Et Ferrante le premier en a conscience : le meurtre d'Iñès est un acte violent, et la violence est plus qu'une marque de faiblesse, elle en est la marque, ce qu'a montré Jankélévitch de façon pénétrante dans Le pur et l'impur : « La violence : une force faible. C'est la force qui s'oppose à la faiblesse : la violence, elle, s'oppose si peu à la faiblesse que la faiblesse n'a souvent pas d'autre symptôme que la violence ; faible et brutale, et brutale parce que faible précisément. ».
Bordonove exprime cette « motivation » avec efficacité : « Sa faiblesse prend le masque de la rigueur pour s'abuser elle-même. »125.
Cette idée de faiblesse chez Ferrante apparaît bien au fil de l'étude comme essentielle ;il sera donc nécessaire de s’y attarder. Car jusqu'ici, les motivations potentielles prêtées à Ferrante s'avèrent peu satisfaisantes :si elles semblent toutes cohérentes en soi, aucune ne l'est dans la mesure où aucune ne semble pouvoir constituer une motivation suffisante...
Le seul problème pour déterminer l'identité de Ferrante par son acte réside dans l'ignorance, dans l'incompréhension du personnage lui-même : ses « pourquoi ? » le disent, le crient :
« Il y a bien une raison, mais [Ferrante] ne la distingue pas » [A. 3, sc. 7, p. 143]
Ce mot de « raison » est important ; nous avons étudié toutes les motivations qui pouvaient régir Ferrante, et ces motivations sont toutes présentes à son esprit... or le personnage les rejette, en continuant à s'interroger sur ce qui le pousse à l'acte : il s'agit donc d'autre chose, dont il n'a pas conscience, qui à l'inverse de ses motivations constituerait une raison suffisante.
Il faut peut-être en fait ne pas parler de motivation(s) mais de « raison », ce terme évoquant une cause qui serait dissociée, indépendante de sa volonté consciente c’est-à-dire de sa conscience même.
C'est dans ce sens que nous comprenons l'image que donne l'Infante de Ferrante,
« jou[ant] avec sa perfidie comme un bébé joue avec son pied. » [A. 2, sc. 5, p. 94]
la perfidie serait considérée comme un élément dissocié, et surtout l'acte ne serait pas dicté par la raison, pas raisonné, justement... C'est paradoxalement l'importance aux yeux de Ferrante des actes, de l'acte en général, qui va nous le montrer.
Il nous faut toutefois signaler ici que les critiques ont tenté d'expliquer l'acte de Ferrante de façon plus extrême : Ferrante agirait pour rien, sans motivation aucune, ou alors pour « tout »... L'exécution d'Iñès constituerait pour Ferrante un « apport » nul, un acte gratuit, ou un « apport » multiple, né de toutes les motivations que nous avons précédemment vues… confondues.
C'est Mohrt - et lui seul, nous semble-t-il - qui a parlé de « crime gratuit » de Ferrante : « l'acte illogique et fou, aux yeux des autres, est une manière d'affirmer notre liberté.[...] c'est l'acte gratuit, détaché de ses raisons et coupé de ses conséquences. »126.
Comment affirmer une chose pareille alors que pour le roi, s'il "ne la distingue pas", malgré tout "il y a bien une raison", et alors que, loin de "couper" l'acte de ses conséquences, il fait le lien entre les deux :
« Non seulement Pedro n'épousera pas l'Infante, mais je l'arme contre moi, inexpiablement. » [A. 3, sc. 7, p. 143.]
Mohrt, par ailleurs, ira jusqu'à parler d'une « période anarchiste de Montherlant [qui] serait récente »127, puis d'une forme de gratuité moindre puisqu'impulsée par la curiosité pure et simple : « le mot [de Guiscart, dans La rose de sable] contient en germe le crime de Ferrante : « En outre, je fais souvent des choses, pour voir. Elles ne me font aucune envie, que celle de savoir ce qui découlera d'elles. » »128.
Il nous semble que seule l'image employée par l'Infante, de Ferrante jouant « avec sa perfidie comme un bébé joue avec son pied. », permettrait de supposer cela. Mais comment penser que cette image développe l'idée d'une curiosité de Ferrante, lui qui « connaî[t] tout cela » et n'est qu'indifférence au monde ?
Certes vu la difficulté de savoir ce qui pousse le personnage, l'acte gratuit est séduisant, mais un peu facile et de toute façon guère tenable. S'il devait y avoir un acte gratuit dans la pièce, nous le verrions plutôt chez Egas Coelho réclamant la tête d'Iñès sans raison apparente et provoquant l'incompréhension et l'irritation de Ferrante... peut-être justement parce que lui a toujours une pensée, et lui en imagine une.
Comme le dit Pedro à Iñès à propos des agissements de son père, « Il y a toujours des raisons »129 et trop de possibilités : cela nous amène à l'hypothèse d'un apport multiple.
Là encore cette hypothèse semble facile, mais elle est nettement plus vraisemblable... Presque tous les critiques ont cumulé toutes les raisons que nous avons vues.
Par exemple, Banchini explique que Ferrante agit « en réalité, pour des raisons plus obscures et complexes [que la raison d’État], où entrent la faiblesse, la vanité, le désespoir, le sadisme, la haine de la vie »130, puis qu'« on lui annonce deux offenses - celle du Pape et celle d'une bande d'Africains - [...]. On l'atteint dans sa vanité. [Puis après avoir parlé à Iñès] il se venge, irrité de s'être laissé voir à nu. Il la punit de sa folle confiance. Il la sacrifie pour montrer à sa cour et à soi-même qu'il est encore capable de puissance.[...] il semble ordonner le meurtre comme par caprice.[...] Un enchevêtrement de raisons obscures, incompréhensibles à lui-même, avec le concours de circonstances fortuites, l'amène à accomplir un acte illogique et presqu'involontaire »131... Cet amalgame a l'inconvénient de ne pas être très clair, de « noyer le poisson », comme Montherlant lui-même le fait :
« Ferrante est masculin à l'extrême[...] Incohérent. Indécis. De mauvaise foi. Vaniteux. Surtout faible.[...] Pour leur montrer qu'il n'est pas faible, il ordonne le meurtre.[...] Faible, il est invinciblement porté à commettre certains actes[...]. Ferrante tue encore par sadisme.[...] Il ne se livre que pour se reprendre ( mouvement que nous avons vu chez Costals ) et en vouloir à qui il s'est livré.[...] Enfin Ferrante tue par haine de la vie, lui qui va mourir.[De là on apprécie combien se trompent ceux qui voient dans le meurtre un acte gratuit. Combien se trompent également ceux qui pensent que Ferrante tue pour « continuer » la raison d’État.]. »132.
On en vient à se dire qu'il y a trop de motivations pour qu'elles soient toutes en cause... Certes Ferrante est par excellence le personnage du cumul, mais en outre le nombre de ces motivations n'empêche pas son ignorance sur lui-même, ce qui n'est jamais le cas de Costals auquel le compare l'auteur.
Nous convenons que de toutes les hypothèses celle de l'« apport multiple » est bien la plus vraisemblable ; mais pourtant Montherlant lui-même, sans opérer de véritable revirement, modifie son avis suffisamment pour nous autoriser à ne pas le considérer comme concluant, et continuer notre quête : en effet, dans une postface du Maître de Santiago, il répète quelques unes des motivations pour mieux privilégier finalement le mystère :
« La Reine morte est [...] pleine de tiroirs et de secrets ( le secret [...] de Ferrante : pourquoi tue-t-il Iñès ? ) [...] Ferrante est un faible, il est immensément faible, et c'est une des clefs du personnage.[...] La cruauté de Ferrante vient de sa faiblesse : il est cruel parce qu'il n'a pas de caractère. Toutes les fois qu'on lui dit qu'il est faible, il réagit par un mouvement de rigueur, pour montrer qu'il ne l'est pas.[...] Ainsi Alvaro et Ferrante ont tous les deux leur « point faible », et chez les deux, c'est la vanité. Enfin, tous deux ont horreur de la vie [...], Ferrante parce qu'elle lui échappe.[...] Allait-il faire tuer Iñès ? Il était encore indécis, quand elle a la maladresse [...] de lui révéler l'existence de son enfant. Et c'est alors qu'il prend la décision fatale, par haine de la vie qui va naître.[...] Ferrante [...] est complexe, contradictoire, indécis, en un mot : flou.[Il] est un personnage mystérieux. »133.
L'idée même du cumul de « motivations » revient à l'idée d'une faiblesse... Mais quelle faiblesse ? D'où vient-elle elle-même ? Pour arriver à répondre à cette question, il nous faut voir que la faiblesse du personnage n'est pas liée uniquement à l'acte mais aux actes, à tout le comportement de Ferrante... Car elle nous semble très profonde.
N'est-ce pas à elle que fait allusion l'auteur, quand il dit de Ferrante qu'il « est profond, et a horreur de sa profondeur »134, alors qu'il s'agit d'un principe incessamment prôné par le roi ?
L'importance de l'acte est, en réalité, subordonnée à celle des actes : Ferrante accorde à peine moins d'importance à l'acte en général qu'à cet acte particulier que constitue l'exécution d'Iñès. Et la seule fréquence des allusions à ceux-ci prouve qu'il s'agit d'une importance excessive, obsessionnelle, suspecte ; pourquoi ? ? :
Dès la deuxième scène du premier acte, son expression d'un sentiment de regret révolté témoigne d'une in-quiétude remarquable :
« Mais quoi ! [Pedro] est un de mes actes, et tous nos actes nous maîtrisent, un jour ou l'autre. Ah ! Pourquoi, pourquoi l'ai-je créé ? Et pourquoi suis-je forcé de compter avec lui... » [p. 24]
Puis Ferrante va, tout au long de la pièce, et jusqu'à l'avant-dernière scène du dernier acte, exprimer la même angoisse :
« Ce qui est fait est fait, et ce qui n'est pas fait n'est pas fait, irrémédiablement. » [A. 1, sc. 3, p. 28]
« La tragédie des actes. Un acte n'est rien sur le moment. C'est un objet que vous jetez à la rivière. Mais il suit le cours de la rivière, il est encore là, au loin, bien au loin ; il traverse des pays et des pays ; on le retrouve quand on n'y pensait plus, et où on l'attendait le moins. Est-ce juste, cette existence interminable des actes ? Je pense que non. Mais cela est. » [A. 2, sc. 1, p. 67]
« Des multitudes d'actes, pendant des années, naissent d'un seul acte, d'un seul instant. Pourquoi ? » [A. 3, sc. 7, p. 145]
Jusqu'à la fin de la pièce, aux portes de la mort, Ferrante aura cette angoisse au cœur et à la bouche.
Pourquoi cette importance des actes, ou plus exactement pourquoi cette importance accordée aux actes ? Parce qu'ils « maîtrisent », dit-il : ce que Ferrante exprime, c'est un sentiment d'aliénation douloureux, et c'est la peur de cette aliénation... Il s'agit moins directement de l'importance de ses actes à ses propres yeux que de leur importance aux yeux d'autrui, que de l'importance d'un regard porté sur ces actes... donc sur leur auteur.
Nous nous étions proposé de nous intéresser à ce que ses actes révèlent de Ferrante, dans une optique existentialiste ; ce qui se révèle, c'est que Ferrante considère lui-même ses actes dans cette optique... et tente d'y échapper, d'échapper à leur aliénation c'est-à-dire à leur responsabilité.
Et en effet, les actes « maîtrisent » parce qu'ils « engage[nt] » 135 :
« Je répugne au style comminatoire, parce qu'il engage. » [A. 2, sc. 1, p. 57]
Ainsi, ce qu'ajoute presqu'immédiatement après Ferrante doit être pris en compte - si c'est possible :
« Ce que j'ai dit ne compte jamais. Seul compte ce que j'écris. Encore, bien entendu, est-ce une façon de parler. » [p. 58]
... donc de mentir ? Ce « bien entendu » n'est-il pas suprêmement ironique, ne doit-il pas se prendre de façon inversée, pour inverser toute la proposition ? Cela permettrait à Ferrante de se désengager à la fois de cette phrase et ainsi de toutes ses phrases... Cette possibilité donne le vertige.
Le caractère influençable de Ferrante, quelle que soit son intensité, montre plus encore que cette importance des actes rejoint celle qu'il accorde au regard d'autrui : il est moins dû à un réel manque d'assurance et de confiance en soi qu'à un constant besoin de réassurance au sujet de l'image de lui qu'ont les autres, et une volonté de contrôle de son image passe nécessairement par celui du regard de l'autre sur lui : Ferrante ne doute pas tant – lors de cette scène - de ce qu'il est que de ce qu'il a l'air d'être, de ce qu'il paraît.
En effet, dans toute la scène que nous avons vue dans l'hypothèse d'une "réaction d'orgueil", scène où ses conseillers tentent de le manipuler, ce n'est pas de lui mais de son image qu'il est finalement question, de « l'idée qu'il faut se faire d'un Roi » : et ce qui inquiète Ferrante, c'est ce qu'« on penserait », ce qu'« on dira », et les conseillers semblent l'avoir compris : l'important n'est pas la réalité mais l'apparence :
« ... partie à raison, partie à tort, le royaume passe pour faible, et cette situation est destinée à durer longtemps encore. » [p. 64]
C'est ce qui va lui faire demander :
« Mais quoi ! Est-ce que j'apparais si faible ? », et protester : « Je ne puis croire que la postérité me reproche de n'avoir pas fait mourir une femme qui est innocente quasiment. » [pp. 64-5]
Cette importance accordée au regard est telle qu'elle ne s'applique pas qu'au temps présent mais prend également en compte l'avenir, un avenir dans lequel Ferrante ne sera plus... Mais dans lequel restera son image. A l'acte suivant, Ferrante est encore obsédé par l'idée de la postérité, mais cette fois l'image n'est même plus liée à l'être agissant, elle est stricte apparence :
« [...] rien ne restera qu'un portrait, parmi douze autres, à l'Armeria de Coïmbre, le portrait d'un homme dont les gens qui viendront seront incapables de citer un seul acte, et dont ils penseront sans plus, en regardant ce portrait : « Celui-là a un nez plus long que les autres. » » [A. 3, sc. 1, p. 109]
Cette angoisse semble un paradoxe chez ce personnage de profondeur : pourquoi cet attachement au paraître plus qu'à l'être, qui montre Ferrante superficiel ?136 Il nous semble que c'est paradoxalement là la preuve d'une optique existentialiste chez Ferrante : cette obsession du paraître plus que de l'être s'explique si pour Ferrante « absent de ses actes », l'acte révèle non ce qu'on est mais ce qu'on paraît... Ils ont donc toujours la même importance : ils impliquent malgré tout un engagement137.
La volonté de Ferrante d'échapper à la responsabilité de ses actes, c'est-à-dire finalement au jugement que ses actes permettent sur lui, est très nette : voilà une explication cohérente à ses contradictions incessantes, et à son comportement ambivalent : ils lui sont utiles. Faut-il pour autant parler de sa mauvaise foi ? Il est vrai que Ferrante, dans cette scène, a affirmé l'utilité sinon la nécessité de la mauvaise foi qu'il applique en politique138. On comprendrait mieux également qu'il « regarde aux actes » de son fils pour le juger : lui est présent dans ce qu'il fait...
Mais cette question de la mauvaise foi rejoint sa « faille », la faiblesse qui le caractérise mais qui reste inacceptable dans sa théorie : pour lui, il s'agit non de masquer son vide et sa faiblesse mais de masquer les actes de faiblesse... Car Ferrante sait bien qu'on s'assimile normalement à ses actes. Et sa position, quelle qu'elle soit, n'est évidemment pas tenable : ses tentatives d'échapper à ce qu'il fait sont vaines... Ce qui nourrit le cercle vicieux de sa douleur :
« Je suis prisonnier de ce que j'ai été . » [A. 3, sc. 6, p. 128.]
Il avoue en fait ici un sentiment d'aliénation par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a été par ses actes... Que ceux-ci expriment le paraître ou l'être, c'est pour Ferrante le même engagement aliénant.
Dans l'existentialisme, le sartrisme a plus particulièrement mis l'accent sur le regard de l'autre, le définissant non plus comme celui que je vois, mais celui qui me voit : « le regard d'autrui me constitue en objet [...], il est donc la négation radicale de mon expérience de sujet.[...] C'est ma liberté, c'est-à-dire le plus intime de moi-même, qu'il me soutire. « L'enfer, c'est les autres. » [...] Par autrui je tombe littéralement dans le monde, exposé sans défense.[...] Je suis en danger d'esclavage, livré à des appréciations qui m'échappent. Je deviens irrémédiablement ce que je suis au moment de l'attaque. »139.
On pourrait penser que Ferrante prend un tel point de vue pour considérer le regard d’Iñès sur lui, et surtout sa parole ; nous en avions fait la remarque : si Iñès venait à répéter ce que lui a confessé le Roi lors de sa « crise de sincérité », il aurait alors à subir en plus de son regard le regard d’autres…
Déjà cette possibilité était exprimée par le Prince de la Mer :
« Il forcera au silence sans retour ceux qui auront surpris son secret. » [p. 126)
Mais c’est surtout l’ombre de l’Infante qui évoque le danger que court la jeune femme :
« N’écoute plus le Roi. Il jette en toi ses secrets désespérés comme dans une tombe. Ensuite il rabattra sur toi la pierre de la tombe, pour que tu ne parles jamais. » [p. 130]
Le meurtre serait alors une façon de masquer une faiblesse honteuse.
Nous avons dit précédemment que la faiblesse de Ferrante faisait sa faiblesse ; nous rejoignons ici cette idée : le personnage est finalement aliéné par la crainte obsessionnelle de l'aliénation...
Cette notion d'aliénation appelle un parallèle entre le personnage et l'auteur, pour qui le culte du moi était gage de liberté, et dont l'« homme libre » évoquait l'« homme léger » de Nietzsche... Car ici, la volonté de liberté par l'acte ou l'absence d'actes devient volonté de libération... Et l'acte n'est alors plus choix mais nécessité, de la même façon que l'absence d'acte n'est pas forcément mauvaise foi140.
Cette volonté de libération, sans l'acte, est donc vouée à l'échec et renforce l'aliénation...On songe ici à la plainte du Roi fratricide d'Hamlet, lorsqu'il prie seul : « O pauvre âme engluée, qui, en te débattant pour être libre, t'engages de plus en plus ! ». Mais l'acte lui-même, dans la situation de Ferrante à la fin de la pièce, est un échec. Sa faille devient sa faillite, car la théorie qui dénonçait sa faiblesse est devenue aliénante, donc faiblesse : c'est la raison pour laquelle l'existence ne peut être mise en système, tout système contenant sa fin ; Gabriel Marcel explique ainsi dans L'avoir et l'être le désespoir : l'optimiste et le pessimiste « considèrent le monde, en face de soi, comme un avoir inventoriable et comptable. L'optimiste est celui qui compte toujours sur l'avenir, le désespéré du fini est celui qui ne compte plus sur rien ni sur personne. Mais tous deux comptent. Ils disposent des choses et de soi, et jugent du jeu. »141.
Et Ferrante est « une intelligence [...] qui se dévore elle-même »142.
Pourquoi cette importance des actes, cette obsession du regard, cette peur du jugement ? Il nous semble que la « faiblesse » de la théorie de Ferrante, la faille de sa faiblesse, et sa faiblesse même ne sont pas expliquées ainsi de manière satisfaisante... Certes Ferrante s'avère faible, mais nous pensons qu'il est en réalité question d'une faiblesse bien plus profonde, d'une faiblesse d'ordre pathologique : il s'agit de prendre le mot d'aliénation dans son sens premier, ce qui expliquerait à la fois que Ferrante aille jusqu'au meurtre absurde et qu'il ignore pourquoi...
L'optique existentialiste échoue finalement à cerner l'identité du personnage puisque c'est précisément ce qu'il veut (pour nous, cette volonté est moins une envie qu'un besoin143) ; il n'y a effectivement pas coïncidence entre ce que Ferrante fait, et ce qu'il est. Dans cette optique, la mort d'Iñès aurait dû constituer un révélateur, une preuve même de ce qu'il est à travers le choix de l'acte et l'acte lui-même, avec ses conséquences... Mais Ferrante est « absent de ses actes », aucune preuve n'est possible. Nous n'irons pas jusqu'à avancer que l'identité du personnage est celle du « salaud » de Sartre, pour qui le désengagement est lâche parce que volontaire : « Être », dit-il, « c'est se choisir. » : sinon, on mélange existence et essence, on renonce à être une personne pour se confondre avec son personnage. Selon L'Être et le Néant, l'homme libre et responsable se définit à chaque instant par ses actes alors que celui qui ne l'est pas fait nécessairement preuve de « mauvaise foi » pour ne pas avoir à les assumer :
« Le pour-soi [l'homme conscient de son existence et de sa liberté] est de mauvaise foi parce qu'il ne coïncide pas avec soi, parce qu'il tente désespérément de concilier les deux sens du mot « être », existence et essence », il est lâche et « cette fuite permanente en avant devient, à force d'arrachements, une escalade de négations à vide. »144.
Certes cette affirmation semble s'accorder au comportement de Ferrante, mais il nous semble qu'il y lieu ici de poser le problème de l'inconscient, ce que Sartre refuse justement au nom de la transcendance de l'ego et condamne comme mauvaise foi et « oubli volontaire »145...
Si son acte en soi ne suffit pas pour cerner l'identité du personnage, il faut regarder sa complexité dans une autre optique qui permettra peut-être de trouver à Ferrante une unité.
Nous avons cherché à savoir si Ferrante est ce qu'il fait ; mais en renversant notre précédente optique, s'il ne sait pas ce qu'il fait - dans le sens où il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait - , il ne sait pas qui il est... Nous pouvons ainsi voir les scènes du dernier acte entre Ferrante et Iñès ( scènes 1, 4 et surtout 6 ) comme la manifestation d'une crise d'identité du vieux Roi... Car Ferrante se cherche en cherchant sans cesse à se définir, mais en fuyant par des pirouettes tout ce qui justement le définirait, et enfin se dévoile à Iñès plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant.146
Dans notre quête de son identité, comme lui dans la sienne, nous tournons en rond et finalement ne tendons vers rien de probant, vers rien... Cela donne un autre sens au terme de « crise d'identité » :il y a bien crise, et crise existentielle : moment lyrique de souffrance, culminant, mais du fait d'une absence d'identité, d'une identité « zéro »... C'est là l'hypothèse d'un phénomène d'ordre pathologique, qui serait apparenté à la schizophrénie. En effet, à partir du moment où cette pathologie provoque un déchirement entre le désir de se livrer et celui de se cacher, et développe des processus de désintégration du moi, il nous faut nous poser la question : Ferrante est-il schizophrène ? Ou du moins, sa personnalité ne reflète-t-elle pas une forte tendance schizoïde ?
On peut considérer que la faiblesse de Ferrante est d'ordre pathologique grâce à plusieurs indices, donnés par l'auteur dans ses commentaires mais déjà dans La Reine morte : car une chose est frappante tout au long de la pièce : c'est la récurrence de mots tels que « maladie » et « folie ».
Si Ferrante utilise le mot de « folie » dans son acception courante, appauvrie - par exemple pour qualifier l'affront de son fils à l'Infante :
« De grâce, Infante, restez quelques jours encore. Je vais parler au Prince. Sa folie peut passer. » [A. 1, sc. 1, p. 21.]
« Don Pedro a eu un non brutal, et il a eu la folie de le dire même à l'Infante. » [A. 1, sc. 5, p. 46.]147
il n'en va pas de même pour celui de « maladie » :
« Vous aussi, comme moi, vous êtes malade : votre maladie à vous est l'espérance. » [A. 3, sc. 6, p. 137.]
Cette affirmation à Iñès reste floue : parle-t-il de maladie chez lui pour évoquer son désespoir ?
Cette mention rappelle celles de Montherlant dans ses notes : « L'Infante devenait malade d'orgueil[...] »148, ou encore « L'Infante [...] Malade d'orgueil. Malade d'impuissance : celle qui ne peut pas convaincre. Malade d'étrangeté. »149.
Et de fait, Ferrante, l'Infante et même Iñès semblent tous se considérer à un moment ou à un autre comme malades de quelque chose : Ferrante avouera à Iñès :
« [Mes pages] me heurtent quelquefois par leur trop de franchise, mais quand ils seront hommes, c'est-à-dire hypocrites, je regretterai l'époque de leur franchise. Leur rôle ici n'est pas ce que l'on pense : il est de me guérir de mes Grands. » [ A. 2, sc. 3, p. 75.]
L'Infante déclare dès la scène d'exposition, sans que l'on puisse être tout à fait sûr qu'elle ne fait allusion qu'à l'affront qu'elle a subi :
« Si Dieu veut, si Dieu veut, je serai guérie par mes choses grandes. Par elles je serai lavée. » [A. 1, sc. 1, p. 23.]
Et elle se compare à son pays de façon plus révélatrice encore, mais sans répéter le terme qui nous intéresse, ce qui montre involontairement son aveuglement sur elle-même :
« Le Portugal est une femme étendue au flanc de l'Espagne ; mais ce pays qui reste quand même à l'écart, qui brûle seul, et qui est fou, empêche le Portugal de dormir. Si j'avais épousé don Pedro, c'est moi qui aurais été l'homme :je l'aurais empêché de dormir. » [A. 2, sc. 5, p. 101.]
Iñès elle-même évoque son amour en des termes révélateurs :
« Je revis [le Prince] plusieurs fois, dans la campagne du Mondego. [...]Enfin je lui dis : « Laissez-moi seulement mettre ma bouche sur votre visage, et je serai guérie éternellement. » » [A. 1, sc. 5, pp. 44-5.]
Mais chez Iñès, le « diagnostic » est simple : il s'agit de « folie amoureuse » : quand elle revoit Pedro après sa mise en prison, elle s'exclame :
« Mon Dieu, assistez-moi dans ce bonheur suprême !Il me semble que désormais je ne pourrai plus avoir de bonheur qui ne soit voisin de la folie... » [ A. 2, sc. 5, p. 85.]
Et demandant à Pedro si elle lui a manqué, celui-ci s'écrie :
« O femme folle ! » [p. 89.]
De même l'ivresse, le délire de paroles vient chez elle de l'intensité du sentiment maternel qu'elle éprouve :
« [...]Lui, cette fabrication de chaque instant, matérielle et immatérielle, qui vous fait vivre dans la sensation d'un miracle permanent, cela fait de lui mon bien, Pedro !Pedro !oui, comme je crois que vous-même ne sauriez...Mais je suis folle, n'est-ce pas ?Au contraire, ce que je lui donne, non seulement je ne vous le prends pas, mais en le lui donnant je vous le donne. » [A. 1, sc. 4, p. 40.]
Il n'en va pas de même pour Ferrante et l'Infante, encore une fois réunis par la profondeur de leur mal. Montherlant lui-même n'hésite pas à qualifier ces personnages par des termes de vocabulaire psychiatrique : ainsi l'Infante est à ses yeux « névropathe, comme le Roi. Elle a son langage à elle, sa « chanson heurtée, elliptique » (Barrès), un débit de gave navarrais, des images hagardes »et finalement donne l'impression d'une « pointe de démence »150.
L'Infante en effet, au moment où elle échoue à convaincre et souffre dans son orgueil, passe de la nervosité à l'énervement : au milieu de sa tirade, elle doit marquer une pause tant sa difficulté passe sur le plan physique :
« [...] O porte ! porte ! Quel mot pour t'ouvrir ? Je m'arrête, car ma bouche est desséchée. [ Temps. ] N'est-ce pas ? vous regardez l'écume aux coins de ma bouche. Cela vient de ma bouche desséchée, et de l'ardeur de cette route, qui était pâle comme un lion. Tout mon intérieur est desséché comme si on m'avait enfoncé dans la gorge, jusqu'à la garde, l'épée de feu de l'ange nocturne ; vous savez, quand les voix de la muraille crièrent de nouveau : « Sennachérib ! » Ah ! [...] » [A. 2, sc. 5, p. 103.]
Le dessèchement symbolise l'échec, et « contamine » tout son être : du lieu de la parole il passe à celui de la vie même : la « gorge », l'« intérieur » ; et aux signes physiologiques de nervosité correspondent ceux de l'énervement, dans ses propos « hagards » : la « route » qui est « pâle comme un lion », l'« épée », qui est celle « de l'ange nocturne »....
En ce qui concerne Ferrante, nous avions vu l'expression de son « énervement » au début de la pièce, chez lui imagé de façon tout aussi violente :
« Qu'il attende un peu, que ma colère se soit refroidie. J'ai pâli, n'est-ce pas ? Mon cœur qui, au plus fort des batailles, n'a jamais perdu son rythme royal, se désordonne et palpite comme un coq qu'on égorge. Et mon âme m'est tombée dans les pieds. » [ A. 1, sc. 2, p. 23.]
Nous retrouvons ici les mêmes mentions de la chaleur et de la pâleur, la même absence de régularité rythmique à l'intérieur ou à l'extérieur de soi, enfin le lien entre cet intérieur et cet extérieur avec l'« étrange » rapprochement qu'opère Ferrante entre son « âme » et ses « pieds » : chez lui aussi, la douleur mentale se concrétise dans une évocation physiologique.
Mais n'est-ce pas la seule difficulté d'exprimer un mal purement mental qui les amène l'un comme l'autre à ces expressions de somatisation ? Ne s'agit-il pas de la faiblesse « inhérente » à Ferrante ? Ne serait-ce pas pour cette raison que comme le thème essentiel de la maladie, celui de la vieillesse développe des images troubles, morbides, à la limite du fantastique ?
Rien ne nous est dit sur l'aspect physique du Roi, sauf cette phrase de l'Infante :
« Vous avez vu son visage vert ? On dirait quelqu'un qui a oublié de se faire enterrer. Et avec cela les yeux lourds des lions. » [A. 2, sc. 5, p. 92.]
A ce fantastique d'ordre visuel répond peu après celui qu'exprime Ferrante, qui y ajoute un aspect olfactif :
« Les parfums qui montent de la mer ont une saveur moins âcre que celle qu'exhale le cœur d'un homme de soixante-dix ans. Je ne sais pourquoi les hommes de cet âge feignent qu'ils vont vivre éternellement. Pour moi, je ne m'abuse pas. Bientôt la mort va m'enfoncer sur la tête son casque noir. » [A. 3, sc. 1, p. 107.]
Ferrante agonise : le thème de la vieillesse est englouti, fondu dans celui de la maladie qui prédomine :« Le Roi souffre de bientôt mourir », dira l'Infante.
Les remarques que nous avons faites sur la « maladie » des personnages, et leur « folie », nous indiquent indubitablement que nous nous trouvons dans un univers non seulement tragique mais malsain. Maladie et vieillesse sont des critères, dans la théorie de Ferrante, qui s'apparentent au critère plus général de la faiblesse. Il apparaît donc de plus en plus nettement au fil de la pièce que cette notion est centrale, plus que la notion inverse de la force. Pourquoi ? Parce que la force est un critère idéal ou plus exactement idéalisé par Ferrante, alors que la faiblesse existe réellement chez lui ; à son grand désarroi, elle fait partie de son être, physiquement et mentalement...
Nous avancions l'idée que Ferrante use d'images d'ordre physique pour n'exprimer qu'un mal mental, et qu'au même titre que l'agonie ce mal lui était inhérent. Le rôle de l'adverbe semble aller dans ce sens quand Ferrante tente de s'expliquer son comportement :
« J'ai conscience d'une grande faute ; pourtant je suis porté invinciblement à la faire. » [A. 2, sc. 1, p. 59.]
Et c'est le même qu'emploie Montherlant dans ce commentaire : « Ferrante est masculin à l'extrême. Masculin royalement. Vivant surtout par l'esprit. Incohérent. Indécis. De mauvaise foi. Vaniteux. Surtout faible. [...]Faible, il est invinciblement porté à commettre certains actes, qu'il sait nuisibles pour lui-même, mais contre la tentation desquels il est sans défense. [...] il se laisse prendre à ces machines, presque volontairement, dirait-on. Tous les psychiatres reconnaîtront ce type d'homme. Ferrante, ayant donné un ordre, refuse d'en donner d'autres, et dit lourdement : « J'ai assez décidé pour aujourd'hui. ». Parole caractéristique : aboulie et neurasthénie. »151.
Déjà l'Infante avait compris son comportement, plaçant le qualificatif « faible » en tête du portrait qu'elle fait à Iñès du Roi :
« Il est comme sont les hommes : faible, divers, et sachant mal ce qu'il veut. » [A. 2, sc. 5, p. 92.]
« Il est naturellement incertain[...] » [p. 96.]
Que la faiblesse apparaît comme un élément constitutif de Ferrante, comme inhérente à sa nature même, et bien plus que comme chez « les hommes » du propre aveu de Montherlant, c'est l'idée autour de laquelle gravitent la quasi-totalité des critiques : déjà, par l'image du « bébé » donnée par l'Infante, qui pour Lancrey-Javal « n'innocente pas la perfidie, mais lui donne une allure organique, « naturelle », puérile. »152.
Pour Laprade, il arrive « quelque chose qui est hors de proportion avec la conséquence qu'elle entraîne [...] mais qui rencontre chez lui une faiblesse secrète et suscite la réaction [...] »153.
Banchini semble tourner autour de l'idée, sans la nommer : « Les héros de Montherlant semblent prédisposés à la souffrance [...], la portant en eux-mêmes comme un vice foncier de leur nature. »154. « Chaque fois que Ferrante manifeste un des aspects opposés de sa personnalité, il est sincère : ses contradictions ne sont pas volontaires.[...] Victimes de leur propre fluidité, les hommes peuvent accomplir des actes aussi imprévisibles aux autres qu'à eux-mêmes, d'autant plus que la ligne logique de leur action est si souvent brisée par les soubresauts de la passion [...] »155
Nous avons vu que Ferrante nourrit au sujet de sa faiblesse une angoisse obsessionnelle, elle-même nouvelle source de faiblesse puisque seul point sensible de Ferrante sur lequel il est possible de le manipuler en l'influençant ; notons que sa confusion entre l'aliénation liée aux actes et l'aliénation liée au regard d'autrui se retrouve en comparant ses mots « la tragédie des actes » à ceux de la reine Jeanne, dite Jeanne-la-folle, dans Le Cardinal d'Espagne : « la maladie des actes »...
Quelle est cette faiblesse, « maladie », « folie », jamais expressément nommée ?156 Comment ne pas penser qu'elle soit d'ordre pathologique, alors que dans ses notes Montherlant lui-même a recours au vocabulaire de la psychiatrie ? Il nous semble que la schizophrénie est ici une hypothèse bien séduisante, car ses symptômes présentent de troublants parallèles avec le cas de Ferrante... La prudence reste de mise : il s'agit pour nous d'en étudier le fonctionnement général, et en particulier de considérer la crise de Ferrante dans le dernier acte à la lumière de cette hypothèse, sans rien affirmer de définitif pour autant.
Qu'est-ce que la schizophrénie ? Il nous faut avant tout en donner une définition générale : « On désigne généralement sous le nom de schizophrénie [...] un groupe de maladies caractérisées par des symptômes plus ou moins spécifiques (associant à des degrés divers la dissociation de la pensée, des affects et du comportement, un délire plus ou moins flou, à mécanisme le plus souvent hallucinatoire, et un repli autistique ) et dont l'évolution généralement chronique aboutissait, en l'absence de traitement, à une désorganisation plus ou moins profonde de la personnalité. »157.
Si la dissociation intellectuelle ne semble pas concerner Ferrante, on ne peut en dire autant des dissociations psychique, affective et comportementale :
« La dissociation psychique : le défaut d'unité et de cohésion affecte l'ensemble idéo-affectif de la personnalité, perturbant en profondeur le comportement et les relations du patient avec le monde extérieur. [Il] se traduit par l'ambivalence ( ressenti ou expression, dans un même instant, de sentiments opposés et contradictoires), le détachement (marqué par la tendance au repli sur soi et une indifférence affective apparente), l'hermétisme et la bizarrerie ( perceptible au travers du caractère insolite et déconcertant des pensées et des actes).
La dissociation comportementale : elle se manifeste à travers l'apragmatisme (diminution considérable de l'activité volontaire).
La dissociation affective : elle se traduit de diverses façons : une affectivité paradoxale avec expression contradictoire et imprévisible d'affects déconcertants : comportements en apparence immotivés, qui traduisent en fait des émergences pulsionnelles [...] mais aussi comportements violents brusques et imprévisibles ; une dysthymormie ou athymormie, froideur plus ou moins constante dans les manifestations affectives avec apparente exclusion systématique de toute émotion dans les relations avec autrui, qui ne fait bien souvent que masquer une extrême vulnérabilité ; une altération majeure des capacités de communication du patient avec le monde extérieur, perte du contact vital avec la réalité se traduisant par un négativisme, refus de contact, des attitudes d'opposition, une très mauvaise projection dans l'ambiance ( asyntonie).... »158.
D'ores et déjà nous trouvons là les contradictions de Ferrante, ses discours ambivalents, son apparente indifférence au monde et aux êtres qui l'entourent, son attrait de l'étrange, et jusqu'à son balancement pour prendre la décision d'éliminer Iñès... Il était évidemment nécessaire de consulter plusieurs ouvrages, mais nous nous sommes essentiellement axé sur l'essai de R. D. Laing, Le moi divisé159, plus détaillé et offrant de nombreuses similitudes avec le comportement de Ferrante.
Selon Laing, la schizophrénie naît d'un sentiment d'insécurité très précoce, qu'il appelle « insécurité ontologique » du fait qu'elle ne permet pas de se construire en tant qu'être à part entière : c'est « la vie, sans se sentir vivant » : « L'individu peut ne pas posséder un sens profond de sa consistance personnelle, se sentir non substantiel et incapable de croire que la matière dont il est fait est authentique [...]. Si l'individu ne peut tenir pour acquises la réalité, la vitalité, l'autonomie et l'identité de son être et des autres, il devient obsédé par la nécessité de trouver des moyens d'essayer d'être réel, de se maintenir en vie [...], de préserver son identité, de s'empêcher de perdre son moi. »160.
D'où un sentiment d'angoisse extrêmement douloureux qui en résulte, - et l'on a vu que la peur et la souffrance caractérisaient Ferrante aussi bien voire plus que tous les personnages - et surtout une construction mentale de défense qui divise l'individu... Cette contradiction d'un point de vue étymologique rend assez cette idée que cet individu n'est pas constitué, c'est-à-dire n'est pas...
Cette absence d'autonomie empêche le développement d'une personnalité une et provoque une dualité entre le « moi incarné » et le « moi non incarné », puisque ce qui se développe est une personnalité faussée : c'est ce que Laing appelle le « système du faux-moi » :« Ces individus semblent ne pas avoir le sens de leur unité fondamentale, unité capable de résister aux plus graves conflits intérieurs, mais semblent plutôt en être arrivés à se sentir divisés en un esprit et un corps. D'ordinaire, c'est à « l'esprit » qu'ils s'identifient le plus étroitement. »161.
Dans la pathologie résiderait l'explication ultime de la théorie dualiste développée par le vieux Roi, et des failles de cette théorie : les images du multiple seraient les représentations du faux-moi que Ferrante aurait été amené à se construire pour préserver son vrai-moi :
« [...] j'ai rêvé que j'agonisais. Nulle souffrance physique, et lucidité absolue. » [A. 3, sc. 1, p. 108.]
« [...]je n'ai pas à me retirer avant de mourir dans les forêts ou sur la montagne, car je suis pour moi-même la forêt et la montagne. Mes âmes enchevêtrées sont les broussailles de la forêt, et j'ai dû, puisque j'étais Roi, me faire de ma propre pensée un haut lieu et une montagne. » [A. 3, sc. 1, p. 110.]
Cette réaction serait finalement moins motivée par l'orgueil que par la peur, et le besoin de se défendre... Car « Le schizoïde (et plus encore le schizophrène) ne se laisse pas aller à la douceur d'un égotisme complaisant et c'est bien à tort qu'on a pu considérer son penchant à l'introspection comme une forme de narcissisme. »162.
Nous avons constaté combien sa théorie isolait Ferrante, seul à penser selon elle et esseulé au nom d'elle ; l'idée du solipsisme est très proche de celle de l'incompréhension dont il se plaint mais dont il tire le sentiment de sa différence, nous l'avions vu -« j'ai été bien meilleur et bien pire que le monde ne le peut savoir »163 - mais il s'agirait d'un « solipsisme involontaire », car ce comportement, s'il est pathologique, n'est absolument pas contrôlé... Or « Ce que l'individu appelle son « vrai » moi, son moi « propre », « intérieur », « réel », il le sent distinct de tout ce que les autres peuvent observer. [...] Le comportement observable d'un tel individu peut comprendre à la fois une part de comédie délibérée et des actions incontrôlées de toutes sortes. On assiste évidemment aux manifestations non point seulement d'un faux-moi mais d'un certain nombre d'éléments partiellement conscients de ce qui pourrait constituer une personnalité si un seul d'entre eux l'emportait. »164.
Nous trouvons une contradiction semblable chez Ferrante : la souffrance de ne pas être compris cumulée avec la volonté de ne pas l'être.
« Se comprendre (s'engloutir) soi-même est en fin de compte une défense contre le risque d'être englouti dans la compréhension d'autrui. Se dévorer par son propre amour prévient la possibilité d'être dévoré par l'amour. [...] Si l'individu ne se sent pas autonome, cela signifie qu'il ne peut sentir de façon normale sa séparation ni sa relation avec autrui. [...] Il y a alternative entre un complet isolement et un complet abandon d'identité, plutôt qu'entre séparation et relation. L'individu oscille perpétuellement entre ces deux extrémités également insupportables. »165.
Nous en venons à penser que, si Ferrante est « tout », peut être tout, il n'est en réalité « rien », personne ; s'il échappe toujours à une identité, n'est-ce pas parce qu'il n'en a pas ?166 « L'individu se sent « vide » - mais ce vide, c'est lui. Bien qu'à certains égards il aspire à voir ce vide comblé, il le redoute en même temps car il en est venu à sentir qu'il ne peut être que ce vide affreux. »167.
Effectivement, Ferrante dit à Iñès combien il se sent vide. Et ses images du vide, du néant seraient consécutivement les représentations du vrai-moi de Ferrante, trop caché donc isolé pour être ressenti comme suffisant : Ferrante au départ parle d'ailleurs moins d'un vide que d'une dissolution, d'un effritement, qui mènent à ce vide :
« Les amours sont comme ces armées immenses [...]. Aujourd'hui [...] elles se sont dissipées. » [ A. 2, sc. 3, p. 81.]
« Et, d'instant en instant, des marbrures rouges apparaissaient sur ma peau [...] si pourrie que la plume par endroits la crevait. » [A. 3, sc. 1, p. 108.]168
« Je vois que de tout ce que j'ai fait et défait, [...] rien ne restera, car tout sera bouleversé[...] » [p. 109.]
Les sentiments, la « peau », les actes, enfin tout ce qui fait Ferrante glisse dans le néant :
« Allons, tout ce que j'ai fait est détruit. J'ai puisé avec un crible. Et c'est vrai, pourquoi ce que j'ai fait subsisterait-il, puisque moi, depuis longtemps, je ne subsiste plus ? [...] Ce que j'ai écrit, je demande : « De qui est-ce ? » [...] Mes mains sont ouvertes, tout m'a fui. » [A. 3, sc. 5, p. 118.]
Cette dissolution se retrouve dans la phrase de Pedro « vouloir définir le Roi, c'est vouloir sculpter une statue avec l'eau de la mer. »169.
Les actes seraient alors comme le point de jonction entre l'être intérieur et l'être extérieur ; en fait, Ferrante confond l'être et l'avoir...Sa confusion est saisissante dans cet exemple :
« Et je vois que de tout ce que j'ai fait [...] rien ne restera qu'un portrait [...] » [p.109.]
Les termes employés ailleurs par Ferrante le montrent assez : même l'autre devient un avoir, appui ou obstacle :
« Vous verrez se défaire ce qui a été votre enfant. » [A. 3, sc. 6, p. 135 ]
L'enfant est perçu comme une construction physique susceptible d'effondrement, un être chosifié... D'où évidemment son « affection incompréhensible »... ; ou encore, il perçoit Iñès comme
« une pauvre chose molle de chair et de nerfs, qui se tient droit on ne sait comment... » [A. 3, sc. 4, p. 118.]
« vous faites partie de toutes ces choses qui veulent continuer... » [p. 137]
« Dans l'attitude d'indifférence, la personne ou la chose est traitée avec mépris ou désinvolture, comme si elle ne comptait pas, comme si elle n'existait pas. [...] L'indifférence dénie tout signification aux personnes et aux choses. [...] Bien entendu, sentir qu'un autre nous traite ou nous regarde non pas comme une personne mais comme une chose n'est pas nécessairement effrayant, si l'on est assuré de sa propre existence. »170.
Ferrante est tout, donc rien : ainsi s'éclaire l'équivalence du tout et du rien, qui nous ramène, en lien avec la théorie de Ferrante inspirée partiellement de son auteur, à l'équivalence du Todo (le Tout, l’Union) et du Nada (le Rien, le Néant) chère à Montherlant . Mais cette équivalence théorique est fausse, de la même façon que la complexité/dualité du personnage ne peut équivaloir à une unité/identité ; la théorie, le « système »du personnage n'est donc fatalement pas tenable, il est irrémédiablement voué à l'échec...La preuve en est de ces images de déliquescence, de désintégration, de dissolution qui amènent au vide du néant.
Car il ne reste que ce vide :
« Je me suis écoulé comme le vent du désert, qui[...]enfin se dilue et s'épuise : il n'en reste rien. » [A. 3, sc. 4, p. 119.]
On comprendrait mieux, à partir de ce « paradoxal » cumul des images du multiple et du vide comme expressions du faux et du vrai moi, que la « feinte » chère à Montherlant construit en surface, mais non par jeu, par protection ; et cette protection devient de plus en plus inutile :
« Mais je croirais volontiers qu'une des meilleures garanties de longue vie est d'être insensible et implacable ; voilà une cuirasse contre la mort. » [A. 3, sc. 6, p. 123.]
« [...]comme cette armure vide de la légende qui, dressée contre le mur, assommait[...]. Moi aussi je me suis retiré, moi et toute mon âme, de mon apparence de Roi[...] » [p. 125.]
« j'étais comme une vieille poule qui pondrait des coquilles vides... » [p. 127.]
Dans l'image de la « cuirasse », on voit assez combien la dureté de Ferrante, prônée et appliquée, est un palliatif... c'est-à-dire le contraire d'un vrai principe ; surtout, surtout cette dureté finit par ne plus rien abriter : l'« armure » comme les « coquilles » se sont vidées de leur substance. Ferrante n'est en fait qu'une « armure vide » dans de « grandes salles désertes »...
On peut penser que cette sensation de vide vient du caractère incessant du « jeu », ou plutôt du mensonge :
« Dans une telle organisation schizoïde [...] les actes de l'individu ne lui apparaissent pas comme des expressions de son moi [.... ] . Le sujet n'a plus le sentiment que son moi participe aux actions du faux-moi et celles ci lui semblent de plus en plus fausses et futiles. D'autre part, enfermé avec lui-même, il se considère comme le « vrai »moi et tient pour fausse la personnalité « jouée ». Il se plaint d'un manque de spontanéité, mais il peut cultiver ce manque et aggraver ainsi son sentiment de culpabilité. Il dit qu'il n'est pas « réel », qu'il est en dehors de la réalité et non point vraiment vivant. Existentiellement, il a entièrement raison. »171.
Et en effet, la fausseté de son environnement s'ajoute à la sienne, le monde devient monde de fausseté ; et cette fausseté devient pesante...Ainsi lors de la scène où Ferrante est conseillé par ses ministres, tout échange est faussé par la nature même de leur rapport d'autorité ; par exemple :
« Je sais que son Altesse souffre avec impatience tout ce qui n'est pas elle.
- N'aimez-vous pas l'Infante, don Alvar ?
- Je l'aime extrêmement, et ce que je viens d'en dire est de ces petits traits que seule décoche la sympathie.
- J'aime que vous l'aimiez. Elle m'en est plus chère. » [A. 2, sc. 1, p. 57.]
N'y a-t-il pas là mensonge de don Alvar, mû par la crainte de déplaire à Ferrante ? Il est impossible de le savoir avec certitude, mais l'on peut penser que Ferrante a cette éventualité à l'esprit et ment à son tour, en lui signifiant en réalité que l'Infante lui plaît d'autant plus qu'il ne l'aime pas, en une menace voilée par l'ironie...Ferrante affirme en effet ailleurs que « le mensonge pour [s]es Grands est une seconde nature »172, et que le rôle de ses pages « est de le guérir de [s]es Grands. »173.
Nous avions vu la même possibilité vertigineuse de mensonge « spiroïdal » dans cette affirmation de Ferrante, dans la même scène :
« Ce que j'ai dit ne compte jamais. Seul compte ce que j'écris. Encore, bien entendu, est-ce une façon de parler. » [p. 58.]
Si la parole tient lieu d'acte dans la pièce, aux yeux de Ferrante il n'en va pas ainsi :« seule »l'écriture est un piège puisqu'elle « reste », c'est un acte définitif qui ne peut se nier par le mensonge... sauf quand on parle.
Cette fausseté continue expliquerait ensemble le sentiment de vacuité et le détachement, le désinvestissement d'actes qui sont l'expression d'un autre que soi, qui n'expriment pas soi mais le faux-moi : l'« apparence de roi », si contraignante et fausse :
« Je regrette de devoir poser des conditions. Les nécessités du règne m'ont forcé de me faire ce langage. » [A. 2, sc. 3, p. 81.]
« Le règne est comme la charité : quand on a commencé, il faut continuer. Mais cela est lourd, quelquefois. » [A. 2, sc. 3, p. 76.]
« Je voudrais ne plus m'occuper que de moi-même [...], cesser de mentir aux autres et de me mentir, et mériter enfin le respect que l'on me donne, après l'avoir si longtemps usurpé. » [A. 3, sc. 6, p. 130.]
Ferrante a donc « dû, puisqu'[il était] roi, [se] faire de [sa] propre pensée un haut lieu et une montagne. »174 ; mais cette défense peut-elle durer alors que le sentiment de vacuité ne cesse d'augmenter ?
« L'individu peut se sentir menacé par l'envahissement du système de son faux moi ou par une partie de ce système. [...] À ces avantages imaginaires [d'un faux-moi protecteur] s'opposent les inconvénients qui sont l'impossibilité de réaliser son projet et le passage d'un faux espoir à un désespoir constant ; d'autre part, il en résulte un sentiment obsédant de futilité, car le moi caché et enfermé, en niant sa participation aux activités quasi autonomes du « système », vit seulement « mentalement ». Qui plus est, ce moi enfermé, étant isolé, est incapable d'être enrichi par une expérience extérieure, de telle sorte que le monde intérieur s'appauvrit de plus en plus, jusqu'à ce que l'individu finisse parfois par se sentir entièrement « vide ». Le sentiment d'être capable de faire n'importe quoi et de tout posséder coexiste alors avec un sentiment d'impuissance et de vacuité. L'individu qui à un moment donné a pu se sentir en dehors de la vie qui l'entoure et qu'il tendait à mépriser lorsqu'il la comparait à sa richesse intérieure, aspire désormais à rentrer dans la vie et à faire rentrer la vie en lui, tant ce vide intérieur est effrayant. »175.
Il nous semble, mais cela reste notre hypothèse, que c'est précisément ce qu'exprime Ferrante dans des plaintes telles que :
« Ah ! Ne me parlez donc pas de ma gloire. Si vous saviez comme je suis loin de moi-même. [...] Et puis, je ne suis pas un Roi de gloire, je suis un Roi de douleur. » [A. 3, sc. 109.]
Ferrante est « absent de [s]es actes », et Montherlant renchérit « Sa tragédie est celle de l'homme absent de lui-même. »176.
Le problème serait donc que ce « système » crée une situation intenable : au bout d'un moment, non seulement le faux-moi est de plus en plus lourd à porter et le vrai se sent de plus en plus vide, mais en outre on se perd parfois entre les deux :
« Moi aussi, dans un sens, je suis crucifié sur moi-même, sur des devoirs qui n'ont plus pour moi de réalité. Je ne suis plus dans mon armure de fer. Mais où suis-je ? » [A. 3, sc. 6, p. 128.]
Ferrante va « craquer » sous sa propre pression : c'est ce que nous avons appelé la « crise d'identité » : à la fois le point culminant de la douleur de ne pas se trouver ; et la dé-couverte du vrai-moi parallèle à l'échec, la disparition du faux. Notons que c'est très précisément ce dont il menaçait Egas Coelho quand celui-ci lui cachait ses motivations concernant la mort d'Iñès :
« [...]croyez-vous que je ne vous voie pas serrer les poings, de votre tension pour que vos yeux ne se dérobent pas ? [...] Un jour vous serez vieux vous aussi. Vous vous relâcherez. Vos secrets sortiront malgré vous. Ils sortiront par votre bouche tantôt trop molle et tantôt trop crispée, par vos yeux trop mouvants, toujours volant à droite et à gauche en vue de ce qu'ils cherchent ou en vue de ce qu'ils cachent. » [A. 2, sc. 2, pp. 70-3.]
Tous les rythmes binaires de cette affirmation soulignent le caractère in-tenable de la dualité : nous retrouvons là la notion de tension liée à sa théorie ; il s'agit de soutenir, de maintenir, de tenir enfin, à tout prix, et doublement : tenir d'une « réelle » force, ou d'une force « apparente » :
« [...]il y a toujours quelques heures où un homme fort est si faible, moralement et physiquement - tout étonné de tenir debout, - qu'en le poussant un peu on le ferait tomber. Par chance, il est rare que l'ennemi flaire ces heures. Ah !s'il savait ! » [A. 3, sc. , p. 120.]
« L'arc de mon intelligence s'est détendu. Ce que j'ai écrit, je demande : "De qui est-ce ?". Ce que j'avais compris, j'ai cessé de le comprendre. Et ce que j'avais appris, je l'ai oublié. » [A. 3, sc. 4, p. 118.]
Le sentiment de relâchement rejoint celui de perte. Ferrante s'est créé la nécessité de paraître et de feindre, et s'emploie exclusivement à ce mensonge. Nous avons cité l'image du « vent » qu'emploie Ferrante pour se définir, qui « se dilue et s'épuise. » : le verbe « s'épuise » est ici crucial : si Ferrante joue sans cesse un ou plusieurs rôles pour fuir tout contrôle extérieur à lui, il est du même coup vidé de ses forces... Ne dit-il pas à l'Infante, au tout début de la pièce :
« Soutenir longuement la conduite la plus opposée à son caractère : quelle fatigue ! » [A. 1, sc. 1, p. 22.]
Cette angoisse de ne pas tenir, appelée par Laing, selon les cas, « empiétement », « implosion », ou « engloutissement », est une conséquence directe et fatale du système schizoïde lui-même...« Le détachement de la réalité aboutit à l'appauvrissement du moi dont l'omnipotence est basée sur une impuissance, dont la liberté se manifeste dans le vide et dont l'activité est extérieure à la vie. [...] L'ironie tragique de la chose est que, finalement, l'angoisse n'est même pas évitée. Au contraire... »177.
... Au contraire, c'est le système lui-même qui contient en germe son propre échec ; « l'individu reste soumis à la crainte de sa propre dissolution dans le non-être, dans ce que William Blake appelait « une non-entité chaotique ». [....] Si la totalité de l'être individuel ne peut être défendue, l'individu recule ses lignes de défense jusqu'à ce qu'il se retranche dans une citadelle centrale. Il est prêt à sacrifier tout ce qu'il est, sauf son « moi ». Mais le paradoxe tragique est que, plus le moi est défendu de cette manière, plus il est détruit. L'apparente destruction, l'apparente dissolution finales du moi dans les états schizophréniques ne sont pas le résultat d'une attaque extérieure par un ennemi réel ou supposé mais des dégradations causées par les manœuvres défensives intérieures elles-mêmes. »178.
On songe à l'image de la noyade contenue dans la phrase de Montherlant, tirée de Service inutile et reprise en épigraphe de Brocéliande : « Je n'ai que l'idée que je me fais de moi pour me soutenir sur les mers du Néant. » : il ne s'agit plus de vivre, mais de survivre dans une dépendance à l'image, à « l'idée »...
Notons que c'est peut-être là sa plus flagrante opposition à Iñès : lui règne, elle aime ; finalement, lui joue alors qu'elle vit : ne dit-elle pas des « choses divines » qu'elle « connaît », « c'est sur la terre qu['elle] les [a] vécues. « 179 ? Tout pour elle est vivant et concret ; pour Ferrante, rien ne l'est : il est dans « l'idée », pas dans la réalité.
L’hypothèse d’une identité pathologique de Ferrante est ici très séduisante, car elle semble exactement lui correspondre et expliquer sa « crise » : « La conscience de son moi est [....] une assurance de son existence, même s'il lui faut vivre une mort-dans-la-vie. [...] La liberté, alors, consiste à être inaccessible.[ Puis] le balancier bascule dans la direction opposée, et le processus aboutit à l'aspiration à être délivré de cette insupportable conscience de soi, de telle sorte que la perspective de devenir à son tour une chose pénétrée apparaît parfois comme un soulagement bienvenu. »180.
Si notre hypothèse était certaine, l'attitude de Ferrante trouverait donc toute sa cohérence dans sa volonté de se vider devant Iñès. Cette « situation de crise » serait normale : « induite par un stress émotionnel ou un événement traumatisant ou imprévisible, elle s'accompagne d'un bouleversement des repères initiaux du sujet et elle est fréquemment ressentie comme une perte d'identité, exprimée avec une tonalité urgente. »181.
La dualité si complexe de Ferrante deviendrait ainsi dans notre hypothèse une dualité pathologique, un véritable « dédoublement de la personnalité »... Ce terme de dédoublement est à retenir, et à différencier de celui de dualité : en effet, la crise d'identité de Ferrante a pour conséquence de faire émerger une nouvelle dualité du personnage, celle de son image : aussi le terme de dédoublement est-il particulièrement approprié.
Les images auxquelles le Roi est comparé seraient donc totalement expliquées par l'hypothèse pathologique : Ferrante est tout, donc il n'est rien ; et il n'est rien...donc il est tout. Voilà pourquoi nous le soupçonnions de mauvaise foi sans trouver si cela était vraiment et toujours conscient : son souci des apparences et du regard porté sur ces apparences serait sa construction d'un faux-moi et sa volonté de le protéger, puisque « Le système du faux-moi existe en tant que complément d'un moi « intérieur » occupé à assurer son identité et sa liberté en se voulant transcendant, non incarné, c'est-à-dire impossible à saisir, à fixer, à prendre au piège, à posséder. Son but est d'être pur sujet, sans aucune existence objective. »182.
Ce but est inatteignable, il faut toujours « composer » devant autrui puisqu'autrui existe , et « fatigu[e] de [son] existence » ; il est impossible d'échapper à ce regard aliénant... Il faut tenir, mais il faut aussi porter : porter le poids du regard comme celui du mensonge, « agi » ou subi :
« Supporter ! Toujours supporter ! Oh ! cela use. Être sans cesse dans les mains des hommes ! Avoir régné trente ans, et encore ligoté. » [ A. 3, sc. 3, p. 116.]
Outre le refus d'agir ou l'absence de soi dans les actes, voilà une « utilité » à l'expression de son ambivalence par l'alternance : il a fait tout et son contraire, et c'est précisément grâce à cela qu'il est de fait « bien meilleur et bien pire » à la fois : "Le patient est comme tout le monde, mais il l'est plus intensément que tout le monde."183. Cela rejoint les affirmations de Montherlant dans En relisant... : son « clair-obscur » « existe chez tous les êtres, mais poussé à un point extrême » ; « il est ce que nous sommes tous, mais en tons très poussés. »184.
En fait, « le problème de l'ambivalence [...] peut être interprété comme [...] un symptôme de désorientation.[...] Le schizophrène aperçoit simultanément tous les aspects d'un problème. S'il veut et, dans le même temps, ne veut pas faire quelque chose, le monde entier va se trouver divisé en arguments pour ou contre l'accomplissement de cette chose. »185.
Cela expliquerait l'« hésitation qui se prolonge » du personnage, que l'auteur a taxé d'« aboulie », sa difficulté de prendre une décision :
« Oh ! je suis fatigué de cette situation. Je voudrais qu'elle prît une autre forme. J'ai l'habitude que les grandes affaires se règlent aisément et vite, et les petites avec mille tracas et d'un cours interminable. Celle-ci est grande et tracassante. » [A. 3, sc. 4, p. 118.]
« Pour le coup, cela, je l'examinerai plus tard. [Lourdement.] J'ai assez décidé pour aujourd'hui. » [A. 3, sc. 5, p. 123.]
Notons ici que cela expliquerait aussi l'échec de la parole : la « tirade d'agonie » du personnage elle aussi rend compte de l'incohérence et de la désagrégation, elle « se fait disloquée »186....
Jusqu'alors l'ambivalence s'exprimant par l'alternance, agir d'une façon puis d'une autre était possible puisque cela permettait d'abolir le facteur de la durée, de porter ensemble la responsabilité d'actes opposés, mais - a priori bien sûr - d'échapper à celle d'un seul acte. C'est ce que Laing nomme « la discontinuité du moi temporel » : « lorsqu'il y a incertitude de son identité dans le temps, il y a aussi tendance à s'identifier dans l'espace [...]. Cependant, la plus grande confiance peut être mise dans la conscience de soi-dans-le-temps. Il en est particulièrement ainsi lorsque le temps est senti comme une succession d'instants. »187.
Ainsi cette vision du temps n'est valable aux yeux de Ferrante que pour lui, puisque nous savons l'importance à ses yeux des actes d'autrui... Mais même en « s'arrangeant avec les réalités »188, la crise est inévitable : « tous ses personnages [...] arrivés à un tournant capital de leur vie, n'aspirent qu'à être délivrés du monde qu'ils méprisent et en même temps de la fausse image que ce monde les oblige à prendre [...] on peut agir simplement parce qu'on est pris dans un engrenage qui ne nous permet pas de reculer. »189.
« Le comportement dit schizophrénique représente une stratégie particulière qu'une personne invente pour supporter une situation insupportable. Un individu en vient à sentir qu'il se trouve dans une position intenable. Il ne peut faire un geste - ou rester immobile- sans être harcelé de pressions et d'exigences contradictoires, [...] écartelé à la fois à l'intérieur de lui-même et extérieurement. »190.
Surtout, cette crise ne peut que mal finir dans l'hypothèse de la schizophrénie : « Si son moi volatilisé conçoit le désir d'échapper à son emprisonnement, de cesser de feindre, d'être sincère, de se montrer tel qu'il est, on peut assister à l'apparition d'une psychose aiguë. Un tel individu, bien qu'apparemment sain d'esprit, est devenu progressivement malade intérieurement. [....] Des personnes disent qu'elles ont perdu leur moi. De tels propos sont généralement tenus pour délirants, mais ils expriment une vérité existentielle et il faut les entendre comme littéralement vrais dans le système de référence de celui qui les tient. »191.
Dans ces conditions, cette situation que Laing appelle « le double blocage », l'attitude de Ferrante qui lui devient in-tenable, in-supportable justement, va aboutir à une crise : crise d'angoisse, crise d'identité, qui correspond à une crise de paroles et de la parole ; la faille de la théorie fait la faillite de l'homme : cette crise elle-même le « vide », et « [sa] volonté [l']aspire »... Le mot de Lancrey-Javal est juste : « il piétine, puis s'emballe »192.
Car si Ferrante dit sa réalité devant Iñès, il détruit son image, en même temps qu'il met à jour son vide : son discours extérieur mime son être intérieur, la crise devient « vidange », fuite, peut-être fuite du vide du silence également...
Lancrey-Javal considère la parole, même si elle échoue, comme un « refuge »... Il se contredît d'ailleurs plus tard en disant qu'« il n'est de refuge que dans le silence »193.
Mais l'attitude de se déverser devant Iñès symbolise l'inverse, la jeune femme est simple réceptacle de la confidence-confession : « il se sert d'elle, jusqu'à la fin, comme d'un miroir vivant où il se contemple une dernière fois. Devant elle, avec une sorte d'impudeur et de soulagement [...], il se libère enfin de toutes les vérités qu'il a tues jusqu'alors. »194.
C'est parce que cette libération que voit Mohrt échoue que la parole à Iñès est le contraire d'un refuge... Pourtant, Lancrey-Javal l'avait bien vu : il s'agit finalement plus d'une mort que d'une catharsis : « les personnages se vident de leurs mots, comme on se viderait de son sang. »195.
La crise d'identité de Ferrante correspondrait donc à un double échec : échec de sa théorie en tant que système de défense, puisqu'il éprouve le besoin de s'épancher en avouant son existence, mais aussi échec par rapport à sa théorie même puisqu'en subissant cette crise, il en avoue également les failles...
Même sans l'hypothèse d'une identité pathologique, nous pouvons affirmer l'inéluctabilité de cet échec : Barthes l'a exprimé en des termes précisément applicables au contexte de notre étude de Ferrante : « Pour la métaphysique classique, il n'y avait aucun inconvénient à « diviser » la personne (Racine : « J'ai deux hommes en moi. ») ; bien au contraire, pourvue de deux termes opposés, la personne marchait comme un bon paradigme (haut/bas, chair/esprit, ciel/terre) ; les parties en lutte se réconciliaient dans la fondation d'un sens : le sens de l'Homme. C'est pourquoi, lorsque nous parlons aujourd'hui d'un sujet divisé, ce n'est nullement pour reconnaître ses contradictions simples, ses doubles postulations, etc.; c'est une diffraction qui est visée, un éparpillement dans le jeté duquel il ne reste plus ni noyau principal ni structure de sens : je ne suis pas contradictoire, je suis dispersé. Comment expliquez-vous, comment tolérez-vous ces contradictions ? [...] éthiquement, vous vous divisez ; vous n'aimez pas la foi, mais vous avez quelque nostalgie des rites, etc. Vous êtes une marqueterie de réactions : y a-t-il en vous quelque chose de premier ? N'importe quel classement que vous lisez provoque en vous l'envie de vous mettre dans le tableau : où est votre place ? Vous croyez d'abord la trouver ; mais peu à peu, comme une statue qui se désagrège ou un relief qui s'érode [...] vous n'êtes plus classable, non par excès de personnalité, mais au contraire parce que vous parcourez toutes les franges du spectre : vous réunissez en vous des traits prétendument distinctifs qui dès lors ne distinguent plus rien ; vous découvrez que vous êtes à la fois ( ou tour à tour ) obsessionnel, hystérique, paranoïaque et de plus pervers... »196.
La division telle que la voit Barthes montre que toute unité ne peut être que fausse, et combien cette personne, chez qui rien n'est « premier », n'est finalement rien elle-même : n'est-ce pas ce dont va s'apercevoir Ferrante en se révélant ? Car pour reprendre l'hypothèse d'une personnalité schizoïde, « Le moi intérieur n'est pas plus vrai que le moi extérieur. »197.
Du fait de cette crise, la « réalité » de Ferrante devient apparente, il n'y a plus de contradiction ; l'intérieur devient extérieur, « sort », il n'y a plus cette distinction...Il n'y a donc plus ce que nous pourrions appeler « l'idée qu'il fait de lui ». Que reste-t-il donc ? On serait donc tenté de répondre qu'il ne reste rien...mais en mettant au grand jour sa théorie et les failles qu'elle comporte, il fait finalement apparaître à la fois son être « théorique », idéal, et son être « réel »... qui ne correspond pas.
Car Ferrante parle lui-même de sa confession à Iñès comme d'une « sorte de crise de sincérité » : il lui explique que les agissements politiques sont arbitraires et ne doivent rien à un comportement moral ou même réfléchi, et s'implique personnellement :
« Le Grand Amiral l'a dit : nous avons besoin de coupables en ce moment. [..] Mais de temps en temps il faut dire non et sévir, à peu près au hasard : simple remise en main. Oui, on doit sacrifier encore des vies humaines, même quand on a cessé de prendre au sérieux leur culpabilité [...] Moi aussi je me suis retiré, moi et toute mon âme, de mon apparence de roi ; mais cette apparence reçoit encore les honneurs [..] ou bien tue encore, et tue presque au hasard... » [A. 3, sc. 6, p. 125.]
Il semble y avoir là aussi une forme de masochisme dans l'ampleur et dans le caractère répétitif de ces confidences : l'insistance et le détail de ses propos peut s'apparenter à une complaisance dans cette vérité ; Ferrante se soulage... En effet après ses révélations politiques provoquées par l'irruption de ses ministres dans la salle, il alterne plus encore des « révélations » d'ordre général et d'ordre personnel, ce qui donne l'impression qu'il ne s'agit que de lui : sa vision du monde et sa vision de lui se mêlent et le montrent tel qu'il est :
« Bien sûr [ on peut tuer pour quelque chose qu'on ne croit pas], cela est constant. Et même mourir pour quelque chose que l'on ne croit pas. On meurt pour des causes auxquelles on ne croit pas, comme on meurt pour des passions qu'on n'a pas, et pour des êtres qu'on n'aime pas. » [p.126.]
« Quand je vous ai dit : « Il y a mon peuple... », je ne mentais pas, mais je disais des paroles d'habitude, auxquelles je ne croyais plus tout à fait dans l'instant où je les disais. »
« Je dois aussi chercher à faire croire que je sens encore quelque chose, alors que je ne sens plus rien. Le monde ne fait plus que m'effleurer. Et c'est justice, car je m'aperçois que, toute ma vie, je n'ai fait qu'effleurer le monde. »
« il y a les mots que l'on dit et les actes que l'on fait, sans y croire. Il y a les erreurs que l'on commet, sachant qu'elles sont des erreurs. Et il y a jusqu'à l'obsession de ce qu'on ne désire pas. » [p.127.]
Le roi généralise à l'extrême la fausseté de tous les comportements humains pour mieux dénoncer les illusions dont il s'est nourri, et les mensonges qu'il a faits en conséquence ; il lui livre ce dont il prend conscience sur le moment : que ce retournement des choses contre lui vient de sa théorie, que son échec présent naît de l'échec de « toute [sa] vie ». Sa dernière tirade, avec la quadruple répétition de la tournure « il y a », semble un résumé du comportement qu'il a fini par adopter, et présente une gradation dans la fausseté qui aboutit à une affirmation terrifiante : elle l'est parce que son sens est obscur, mais en même temps apparaît comme une possible négation de l'objet qu'il poursuit dans la pièce : le mariage politique de Pedro. Il semble ensuite signifier qu'il ne le veut que pour « occuper » le Prince :
« J'ai atteint l'âge de l'indifférence. Pedro, non. Que faire de sa vie, si on ne s'occupe pas de ces sortes de choses ? » [p.128.]
« Faire le roi » serait pour lui un divertissement, au sens pascalien du terme, une occupation susceptible de combler ce vide qui le fait, donc une chose devenue vitale pour lui, et par conséquent un souci réel... par défaut.
Exprimant tout cela, Ferrante a cruellement conscience que le portrait qu'il dresse de lui-même ne correspond plus en rien à ce qu'il prône dans sa théorie de la force, force de par la verticalité des volontés et force de par la dureté des comportements : un décalage est maintenant nettement visible entre ce qu'il voudrait « encore » être et qu'il a vraisemblablement été, et ce qu'il est vraiment à ce moment : il s'est dévoilé avec complaisance, avec même exaltation :
« Iñès, cette nuit est pleine de prodiges. Je sens que je m'y dépasse, que j'y prends ma plus grande dimension, celle que j'aurai dans la tombe, et qu'elle est faite pour que j'y dise des choses effrayantes de pureté. » [pp. 127-8.]
Mais ce moment quasi-magique, où le roi parle comme d'outre-tombe, comme « un terrible Roi Lear », ne peut que retomber : comment penser que cette vérité va l'apaiser, alors qu'il s'est vidé mais est toujours « là », alors qu'il a dit son échec et que cet échec est intolérable ?
« Je me suis lamenté tout à l'heure devant vous comme une bête ; j'ai crié comme le vent. Croyez-vous que cela puisse s'accorder avec la foi dans la fonction royale ? » [p.128.]
« Le moi « intérieur » essaie de vivre par certains moyens compensatoires apparemment avantageux ; il tient à certaines formes d'idéal. [...] Tandis que tous les échanges avec autrui peuvent être feints, équivoques, hypocrites, l'individu tente d'avoir avec lui-même une relation scrupuleusement sincère, honnête, franche. Tout peut être caché aux autres mais rien à soi-même. Se faisant, le moi tente de devenir « une relation qui se réfère à elle-même » (Kierkegaard) à l'exclusion de tout le reste. Nous avons ici la source d'une seconde scission à l'intérieur du moi. L'être de l'individu s'étant partagé en un "vrai" et un « faux » moi, tous deux perdent leur réalité mais tous deux aussi se divisent à leur tour en sous-systèmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ainsi, dans la relation que le moi a avec lui-même, on voit se développer une seconde dualité, par laquelle le moi intérieur éclate pour avoir avec lui-même une relation sado-masochiste. Lorsque cela se produit, le moi intérieur, d'abord conçu comme un moyen de se raccrocher à un sentiment précaire d'identité, commence à perdre l'identité même qu'il avait. »198.
Et en effet, Ferrante ne va pas trouver d'autre comportement après avoir dénoncé sa faiblesse que de la nier à nouveau, de revenir à sa « fausse image » en tentant désespérément d'abuser Iñès et de s'abuser lui-même :
« Votre Majesté parle encore de l’État !
- Et pourquoi non ? Ah ! je vois, il vous semble que j'ai dit que je ne croyais pas à l’État. Je l'ai dit, en effet. Mais j'ai dit aussi que je voulais agir comme si j'y croyais. Tantôt vous oubliez, tantôt vous vous rappelez trop, doña Iñès. Je vous conseille de ne pas vous rappeler trop ce que j'ai dit, dans cette sorte de crise de sincérité, quand ces coquins s'enfuyaient pour ne pas m'entendre.[...] C'est le sort des hommes qui se contraignent à l'excès, qu'un jour vient où leur nature éclate ; ils se débondent, et déversent en une fois ce qu'ils ont retenu pendant des années. De là qu'à tout prendre il est inutile d'être secret. » [pp. 138-9.]
La réaction de Ferrante est dès lors plus effrayante que jamais : dans un premier mouvement il semble avoir occulté tout ce qu'il vient d'avouer dans sa crise, puis reporte sur Iñès la confusion, puis admet la réalité avant de l’« annuler » par l'application de l'alternance... Enfin, il accuse Iñès sur un autre sujet comme pour détourner la conversation mais finit par une analyse totalement lucide de sa crise et de ses implications, avec peut-être même une pointe d'ironie finale.
Dans l'hypothèse de la schizophrénie, ce revirement n'est pas une incohérence, au contraire il est parfaitement logique : nous avons vu dans notre optique existentialiste que l'importance obsessionnelle donnée par le personnage aux actes est liée à la peur du regard d'autrui, qui devient un jugement donc un pouvoir sur lui :
« Il est parfois moins admirable d'user de son pouvoir, que de se retenir d'en user. [...] Mais cela est pris pour faiblesse, et il faut supporter d'être dédaigné à tort, ce qui est la chose du monde la plus pénible à supporter. » [A. 2, sc. 3, p. 79.]
N'est-ce pas précisément ce qu'il ne va pas supporter ? On peut le penser par certains signes précurseurs d'un délire paranoïaque à propos des regards, dont nous avions noté l’importance dans une optique existentialiste : avec son fils par moments, nous le savons, puis généralisé :
« Mais regardez-moi donc ! Vos yeux fuient sans cesse pour me cacher tout ce qu'il y a en vous qui ne m'aime pas. » [A. 1, sc. 3, p. 26.]
« Et les hommes, eux aussi, me semblent se ressembler par trop entre eux. Tous ces visages, ensemble, ne composent plus pour moi qu'un seul visage, aux yeux d'ombre, et qui me regarde avec curiosité. » [p.77.]
D’autant que cette angoisse ne réfute pas notre hypothèse, au contraire : « Lorsque le moi abandonne partiellement le corps et ses actes pour se retirer dans une activité purement mentale, il se sent comme une entité peut-être localisée quelque part dans le corps. [...] Ce retirement est, en partie, une tentative de préserver son être, dès lors qu'une relation quelconque avec les autres apparaît comme une menace pour l'identité du moi. Le moi ne se sent en sécurité que caché et isolé, fût-ce en présence des autres. Mais cette tentative est vaine. Personne ne se sent plus vulnérable, plus en danger d'être découvert par le regard d'autrui que le schizoïde. »199.
A notre sens, c'est l'Infante qui a le mieux formulé l'état d'esprit du roi :
« Il est naturellement incertain et son art est de faire passer son incertitude pour politique. Il noie le poisson par hésitation et inconsistance, mais il arrive à déguiser cette noyade en calcul profond. Il affirme les deux choses contraires, à la fois spontanément, parce qu'il est irrésolu, et systématiquement, afin de brouiller ses traces. Il mélange avec danger des éléments inconciliables ; nul ne sait ce qu'il pense, mais c'est parce qu'il n'a pas de pensée précise, hormis, quelquefois, sur son intérêt immédiat. » [A. 2, sc. 5, p. 96.]
Elle semble avoir perçu le double mouvement de sa fausseté, son dédoublement et sa dualité ; aussi a-t-elle conscience d'un « danger » potentiel qui pourrait se tourner contre Iñès... Cette conscience est la même chez les ministres de Ferrante, qui comprennent l'imminence de ce danger lors de la crise du roi ; Ferrante tente d'échapper au contrôle du regard d'autrui en le contrôlant, c'est-à-dire en contrôlant son image, mais il s'est livré... Ils savent qu'il va le regretter, et qu'il tentera d'échapper à une sensation de danger à tout prix : aussi les voit-on prendre la fuite :
« Le roi délire. Cette magicienne l'ensorcelle. Son réveil sera terrible.
- Il forcera au silence sans retour ceux qui auront surpris son secret.
- Il fera tuer la magicienne. Mais moi aussi bien, s'il me trouve ici. [Il s'enfuit.]
- C'est l'ivresse de Noé ! [Il s'enfuit.[...] des ombres apparaissent, écoutent un moment, puis disparaissent avec des gestes horrifiés.] » [A. 3, sc. 6, pp. 126-8.]
D'un point de vue dramatique, ces remarques successives annoncent avec une précision de plus en plus grande l'attitude à venir de Ferrante, en même temps qu'elles mettent sur le même plan le « délire » et le « secret », soit paradoxalement la fausseté et la réalité : cela révèle que le moyen pour Ferrante de revenir à son idéal va être impossible... Impossible, car il ne sera plus crédible dans les apparences. « Le spectacle que nous sommes à nous-mêmes a de quoi nous remplir d'effroi. [...] un abîme se creuse entre le nouveau moi qui s'est formé en eux [les héros de Montherlant] et les actes qu'ils continuent d'accomplir. »200.
Nous avons dit qu'en effet cette crise mettait au grand jour sa théorie et ses failles, faisait apparaître son idéal et sa réalité... Mais, aux yeux de qui ? La réponse semble évidente, puisque les personnages en présence sont seulement, du fait de la fuite de certains « témoins » de la scène, le Roi et Iñès à qui il s'adresse : Iñès deviendrait ainsi la seule personne, outre lui-même, détentrice de son « secret »... donc la seule susceptible de le divulguer, et de propager l'image du « vrai » Ferrante, nous l’avions évoqué... En effet, en se livrant Ferrante ne s'est pas délivré, au contraire, puisqu'en se ravisant il s'est condamné à une nouvelle contrainte extérieure. L'hypothèse qu'il tue Iñès, non par simple « faiblesse » mais parce qu'il est malade, est ici vraisemblable : puisqu'il y a eu crise, il y a danger pour lui, « menace de sidération psychique » : « l'appareil psychique perd son pouvoir organisateur, la psyché devient prisonnière de quelques représentations envahissantes. Le psychisme est incapable d'un travail de liaison, l'ambivalence est intolérable, en conséquence les modes de défense tels le clivage, le passage à l'acte, le désinvestissement ou le contrôle omnipotent sont utilisés. »201.
Mais même dans notre hypothèse il nous semble que Ferrante n'agit pas pour se préserver d'Iñès, qu'il ne craint ni son regard ni sa parole parce qu'il a conscience de ce qu'elle est : il ne l'estime pas assez pour que son jugement lui importe et sait que son honnêteté la portera à garder le silence. Penser qu'il agit contre Iñès serait oublier l'absurdité fondamentale de l'acte, et c'est en cela qu'elle est sacrifiée ; déjà l'absurdité était latente dans son comportement, qu'il la dénonce ou non, qu'il en ait conscience ou non :
« [...] ces deux sortes de conseillers sont également inutiles. Et cependant, celui qui aime de prendre conseil a beau s'apercevoir qu'on le conseille toujours en vain, il prendra conseil jusqu'au bout.[...]
- Après ces paroles, aurons-nous encore l'indiscrétion de conseiller Votre Majesté ?
- Je vous l'ordonne. » [A. 2, sc. 1, p. 59.]
Son comportement serait moins une tentative de reprendre le contrôle des événements que de l'absurdité pure et simple, sans aucun sens :
« O Royaume de Dieu ! [Appelant.] Pages ! [Désignant les tables.] Enlevez ces tables. Elles m’écœurent. [Ferrante sort vers son cabinet. Seuls, les pages se mettent en devoir d'enlever les tables.] » [A. 2, sc. 2, p. 73.]
De la même façon que son écœurement est sans rapport avec le mobilier qu'il n'a de toute façon pas sous les yeux puisqu'il s'éloigne, son acte pourrait être sans rapport avec Iñès... Nous pouvons penser que cet écœurement, au moment où il vient de donner l'évêque de Bragance à Egas Coelho, naît de ce qu'il voit en lui-même de « bas » ; ainsi, son acte de tuer Iñès pourrait en fait être l'expression absurde d'un nouvel écœurement de lui-même, après sa crise... Car, d'une certaine manière, une autre personne l'a écouté : lui-même. D'ailleurs, c'est lui au départ qui s'est complaisamment exalté de lui-même, nous l'avons vu . Et en effet, le caractère irrépressible de ses "confidences" apparente plus sa crise d'identité à un monologue qu'à un réel dialogue ; ne pourrait-on pas penser, dans cette circonstance, que ce que Ferrante a détruit est moins « l'idée qu'il faisait de lui-même » que « l'idée qu'il se faisait de lui-même » ?
Lancrey-Javal note lors de la crise « la disparition des adresses à l'interlocuteur dans les tirades, et les marques de l'échange [...], le personnage s'enferme, avant de mourir, dans une parole qu'il n'adresse plus véritablement à personne, pour, illusoirement, se sentir une dernière fois exister [...]. Il n'est plus que ses mots »...puis ajoutera : « ces deux personnages [Ferrante et Iñès] se parlent d'abord à eux-mêmes dans un cheminement intérieur, dans des confessions où les identités tâtonnantes se cherchent et ne se figent finalement que dans la disparition. »202.
Puisque dans sa quête de soi Ferrante se parle, c'est peut-être à lui qu'il dit la faillite de ce qu'il est, à lui qu'il montre son échec, et cet échec lui est insupportable... Il est peut-être à lui-même son pire ennemi203 ; il condamne peut-être en son fils ce qu’il sait en lui-même. Car nous noterons à cet égard que Ferrante semble avoir projeté à plusieurs reprises sur Pedro des reproches qui s'avèrent le concerner lui : son vide, sa volonté de subordonner la réalité de « ce qui est » à sa théorie, à ses désirs, et le refus arbitraire de cette réalité si elle devient gênante :
« Mes paroles avaient l'air de passer à travers vous comme à travers un fantôme pour s'évanouir dans je ne sais quel monde : depuis longtemps déjà la partie était perdue. Vous êtes vide de tout, et d'abord de vous-même. » [A. 1, sc. 3, p. 27.]
« Tant d'idées au secours d'un vice !
- D'un vice !
- Vous avez une maîtresse, et ne voulez rien voir d'autre. Là-dessus il faut que l'univers se dispose de manière à vous donner raison. » [p.31.]
Un rapprochement peut être fait entre le jugement que Ferrante a de l'attitude de Pedro et sa propre attitude :
« Un jour que je lui touchais un mot [d'Iñès], il m'avait dit : « Jamais plus vous ne devez me parler sur ce sujet. »
- Il est là tout entier. Allez, allez, en prison ! En prison pour médiocrité. » [A. 1, sc. 6, p. 50.]
Et deux scènes après :
« Quoi qu'il en soit ma décision est prise. Qu'on ne m'en parle plus. » [A. 2, sc. 1, p. 59.]
Si Ferrante a conscience de ce décalage entre ce qu'il veut être et ce qu'il est, à la fin de la pièce, peut-être veut-il aller jusqu'au bout de l’écœurement en commettant le meurtre, pour mourir ensuite... Si sa théorie devrait être lui mais ne l'est pas (ou plus), il peut se condamner lui-même au nom de celle-ci, d'autant qu'il a failli à ses principes en se donnant... Ce serait une forme de masochisme, comprenant que la mort d'Iñès aura pour conséquence la sienne :
« J'ajoute encore un risque à cet horrible manteau de risques [...] que je charge moi-même à plaisir, et sous lequel un jour...[...]. Plus je mesure ce qu'il y a d'injuste et d'atroce dans ce que je fais, plus je m'y enfonce, parce que plus je m'y plais. » [A. 3, sc. 7, p. 143.]
Mais il semble qu'un instant plus tard, Ferrante pense se libérer par cet acte, au contraire :
« Quand elle regardait les étoiles, ses yeux étaient comme deux lacs tranquilles...Et dire qu'on me croit faible ! [Avec saisissement.] Oh ! - Maintenant il est trop tard. Je lui ai donné la vie éternelle, et moi, je vais pouvoir respirer. » [p.145.]
On peut alors supposer que son aveuglement sur soi, son orgueil excessif, a pour conséquence un aveuglement dans ses actes : l'absurdité de s'obéir même quand on ne se comprend pas - parce qu'« un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge » - et qu'on sait qu'on a tort - « je commets la faute, sachant que c'en est une. ».
« Il est très difficile de démêler ce désir d'être du désir du non-être, tant ce que fait le schizoïde est, par nature, inextricablement ambigu. Donc les deux hypothèses [ se préserver ou se détruire] s'excluent-elles mutuellement ? »204.
Seule reste certaine ici l'absurdité du personnage, qu'il se croie à la fin en position de force ou en position de faiblesse ; il agit... Notons que la schizophrénie, ici, serait moins la cause directe de cet acte, qui se trouve être absurde, que la cause de l'absurdité se trouvant caractériser cet acte. En effet, le meurtre, alors que Ferrante éprouve une peur obsessionnelle du jugement d'autrui, constitue la plus grande incohérence de toute la pièce : « Il y a dans un acte quelque chose de décisif et de définitif que ce genre d'individu considère avec méfiance. L'action met un terme au « possible ». Elle fige la liberté. »205.
Disons qu'au point de non-retour atteint par Ferrante, celui-ci ne voit plus d'issue et gâche, détruit tout et y compris lui-même... Du fait de sa confusion entre l'avoir et l'être, nous pouvons penser que la fin de la pièce rejoint le mot cher à Montherlant, « aedificabo et destruam » (il s'agit d'une parole de l'Ecclésiaste qu'il avait relevée et prise à son compte dans Aux fontaines du désir.).
La tension de Ferrante pour se maintenir à la hauteur de son image idéale, à la « haute idée qu['il s]e fai[t] de [lui]-même », pour se « soutenir sur les mers du Néant », s'est un moment relâchée et sa tentative de se ressaisir ne peut qu'échouer quoi qu'il fasse : Ferrante est tombé du piédestal de sa théorie, il a chuté de lui-même... Et cette chute doit peut-être être complète pour que Ferrante trouve une unité, une identité...
Nous retrouvons là l'idée de verticalité, qui annonce le caractère mystique de la pièce ; déjà l'hypothèse d'une identité pathologique du personnage conserve cette idée : « Son plus vif désir est ressenti comme sa pire faiblesse et, cédant à cette faiblesse, [...] il craint de voir son vide menacé par cette participation [...], de perdre son identité, qu'il associe au maintien de la transcendance du moi bien que ce soit une transcendance accomplie dans le vide »206.
Doit-on penser avec Bellemin-Noël que « les écrivains sont des hommes qui, en écrivant, parlent à leur insu de choses qu'à la lettre « ils ne savent pas ». » ?207
Notre hypothèse d'une « identité pathologique » pourrait éclairer beaucoup de choses, et jusqu'à la froideur de la théorie du personnage : Ferrante serait une personnalité mais pas une personne... à part entière ; son identité sociale serait l'apparence d'un faux-moi construit, son identité psychologique le système de défense cause de sa dualité, son identité théâtrale la conséquence de la pathologie au niveau du ressenti, et son identité existentialiste sa conséquence au niveau du comportement... Mais nous ne pouvons rien affirmer qui réduirait le personnage à un cas « clinique » ; il est préférable de rester prudent à la formulation d'hypothèses telles que celle que nous avons posée, car comme Sacks le rappelle justement dans son dernier ouvrage, « on court le risque, dès lors qu'on réduit la complexité humaine à des manifestations de troubles neurologiques ou psychiatriques, de négliger tous les autres facteurs qui concourent à déterminer une vie - et notamment l'irréductible singularité de l'individu. »208.
Quoi qu'il en soit, et de toute façon, un recul est nécessaire en vue de conclure - si une conclusion est possible. Est-ce que vouloir cerner Ferrante, c'est vouloir le juger ? Alors que nous devons encore une fois revenir à l'acte, au seul acte de Ferrante, et qu'il s'agit d'un acte criminel... Nous nous demandions si Ferrante était sublime ou pathétique ; faut-il nous demander maintenant si Ferrante est un bourreau ou une victime ?
Là encore une identité pathologique indubitable suffirait pour déresponsabiliser Ferrante, lui qui parle du péché comme d'une « maladie de l'âme immortelle »209... Sans parler de pathologie précise mais de faiblesse, Ferrante est-il responsable de ses actes ou non ? Et s'il ne l'était pas, serait-il coupable ?
Comment conclure ou juger, sans dépasser la notion même d'unité ? Comment dépasser cette notion, sans accorder au personnage une identité « absolue », mystique ?
La question ultime qui se pose à propos de Ferrante est forcément celle des conséquences de son acte pour l'identité que nous lui cherchons depuis le début : depuis le début, la « personne » nous échappe, masquée par un « personnage » et dominée par une « personnalité », comme si ses actes concernaient l'un ou l'autre mais pas elle...
Cette question ultime est l'occasion d'une ultime dualité de Ferrante, d'un « changement de statut dans la pièce » du personnage puisque « le juge [...] est amené à comparaître in fine en jugement. »210.
Notre hypothèse d'une identité pathologique de Ferrante, si elle n'était pas qu'une hypothèse mais une certitude, nous permettrait de trouver une forme d'unité au personnage : il serait un dans la faiblesse, il n'y aurait pas d'identité « réelle » à lui trouver... Mais ne peut-on pas dépasser encore une fois la notion d'unité en ce qui concerne Ferrante ? Cela ferait de sa faiblesse ultime une ultime force... car il serait dépourvu d'identité non par défaut mais par excès : cette identité « irréelle » serait non « zéro » ou pathologique, mais « absolue », mystique enfin211.
Ferrante, qu'il s'agisse d'une application délibérée de sa théorie dualiste ou d'une organisation schizoïde de sa pensée, est parvenu au fil de la pièce à être réellement, effectivement double; si sa dualité est évidemment superficielle dans le syncrétisme, puisque le cumul chez Ferrante repose sur une conception erronée de la durée, elle ne l'est pas dans l'alternance : Ferrante, considéré au terme de la pièce, s'est avéré effectivement « bien meilleur », mais également « bien pire »... Nous évoquions le problème posé par les verbes identifier et juger ; Ferrante a donné l'ordre d'exécuter Iñès de Castro... Doit-on dire de sa dualité qu'elle est duplicité ? Ferrante est-il plus un assassin ou plus une victime ?
Nous pourrions très bien considérer que Ferrante est un personnage effectivement « meilleur » : il s'agirait de prendre en compte l'acte, « moins » ce que nous appellerions les circonstances « atténuantes »...
Rappelons-le : le personnage a fait preuve de moments de bonté. En lui, existe de la patience, de la clémence, une réelle tendresse même. Nous avons vu combien les pages, à la seconde scène de l'acte 2, se montraient insolents devant lui sans qu'il ne réagisse ; de même, il s'est montré bienveillant et très patient avec Iñès jusqu'à la fin du dernier acte. Enfin et surtout, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles, s'il semblait ne pas aimer son fils Pedro, il n'en était rien...
Nous pouvons également affirmer que Ferrante a au moins ce « bon point » d'éprouver du remords par rapport à l'acte ; pourtant, il avait l'air de ne pas le prendre à son compte doublement, d'abord en déclarant à ses sujets qu'il s'agissait de « [sa] dernière et grande justice » 212, puis en rejetant la faute, au moins partiellement, sur Egas Coelho : « [...] voici celui qui, avant tout autre, a inspiré [l'exécution]. »213.
Ferrante semble pendant la pièce ne jamais ressentir de sentiment de culpabilité : il « donne » l'évêque de Guarda en pâture à ses ministres alors que sa colère se porte sur son fils, et décide brutalement de la mort de Lourenço Payva dont il sait que la « négligence très grave »214 ne l'est sans doute que par l'exagération de ses conseillers. Il affirme en outre ne pas éprouver de remords à cette occasion :
« Mais si Lourenço Payva n'était qu'à demi coupable, quel remords vous vous prépareriez !
- Les remords meurent, comme le reste. Et il y en a dont le souvenir embaume. » [A. 3, sc. 6, p. 124.]
S'il ne ressent pas de culpabilité dans la durée, c'est comme s'il n'en ressentait pas du tout... Or Ferrante se contredit dès la scène suivante, lors de laquelle il monologue au sujet de l'acte qu'il vient de commettre :
« Un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge. » [p. 143.]
En coupant court à son « hésitation », il sait que son choix entraînera ce sentiment... Et la conscience mauvaise de ce choix remonte à plusieurs reprises dans son monologue :
« [...] Il serait encore temps de donner un contrordre. Mais le pourrais-je ? Quel bâillon invisible m'empêche de pousser le cri qui la sauverait ? [...] - Il serait temps encore. - Encore maintenant. [...]. [Avec saisissement.] Oh! Maintenant il est trop tard.[...]. » [p.145.]
Nous l'avons dit, ce « bâillon » pourrait être la figuration de l'aliénation pathologique de Ferrante, ou d'une fatalité qui « ne vient que de [lui] »... La maladie ferait de lui un irresponsable, sans maîtrise de ses pensées ou de ses actes malgré une « lucidité absolue » ; nous pourrions parler, comme dans Hamlet, de « meurtre involontaire »... Mais cela reste en l'occurrence une hypothèse ; nous pouvons alors invoquer la faiblesse du personnage, due à la pression qu'il n'a cessé de subir, à la fois pression générale de son statut royal, et pression particulière que ses ministres provoquent en voulant l'influencer...
Son statut de roi brouille les notions de Bien et de Mal, tout autant que sa théorie personnelle : ainsi, Ferrante est conduit à affirmer à Egas que « tout vice que le Roi approuve est une vertu. »215... Et il n'est pas sûr qu'il n'en soit pas au bout du compte réellement convaincu.
Si Ferrante subit, est-il victime ? Est-il autant qu'Iñès victime des autres et de lui-même, se sacrifie-t-il en la sacrifiant ? Iñès, en outre, a sa part de responsabilité... Nous avons vu que d'une certaine façon, elle se sacrifiait elle-même... Mais même en le considérant comme une victime, on ne peut oublier son acte qui fait de lui un assassin.
Ferrante est aussi, si l'on considère l'acte qu'il commet, effectivement « pire » : son choix est celui du pire. En outre Ferrante, s'il a eu de réels moments bons, en a eu de mauvais tout aussi réels...
La « valeur » ambiguë des images auxquelles il est comparé au fil de la pièce prend maintenant toute son importance ; or là aussi les notions de Bien et de Mal se trouvent brouillées, et encore une fois doublement : dans sa théorie seule, et entre sa théorie et la connotation « normale » qui peut être attribuée aux images de la pièce.
Ainsi Ferrante, en se comparant aux lucioles « alternativement obscures et lumineuses, lumineuses et obscures », semblait classer le lumineux dans ses critères de qualité et l'obscur dans ceux de médiocrité ; parlant de sa qualité disparue à Pedro, il la compare au « dernier rayon du soleil qui se couche »216... Nous pouvions penser « logiquement » que l'image des lucioles incarnait le caractère « bien meilleur et bien pire » que Ferrante se reconnaissait.
Le problème est qu'Egas Coelho a été assimilé, nous en avions seulement fait la remarque, à la « boue » puis à la « flamme »217, c'est-à-dire chaque fois accusé d'être mauvais et chaque fois loué de par la verticalité contenue dans ces deux images, au mépris des connotations auxquelles nous pouvions nous attendre...
Qu'il n'y ait pas de « valeur » au sens moral dans la théorie de Ferrante ou qu'elle soit brouillée, la seule connotation à laquelle se référer est la connotation usuelle, « normale » comme nous sommes forcé de le dire... Ainsi chacune des images de Ferrante se trouve connotée négativement, que celles-ci soient associées au critère du lumineux ou à celui de l'obscur : Ferrante est mauvais parce qu'il est obscur comme l'ombre mortifère :
« Un roi est comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre... » [A. 3, sc. 8, p. 146.]
mais il est également mauvais parce qu'il est lumineux comme la flamme brûlante :
« [Sa colère] sera terrible. Elle nous enveloppera comme une flamme. » [A. 1, sc. 4, p. 36.]
« Le souffle des rois est brûlant. Il vous consumera. » [A. 2, sc. 5, p. 100.]
« la nuit est mère de toutes choses, et même d'effrayantes clartés. » [A. 3, sc. 1, p. 108.]
« Voilà une heure que vous tournaillez autour de moi, comme un papillon autour de la flamme. Toutes les femmes, je l'ai remarqué, tournent avec obstination autour de ce qui doit les brûler. » [A. 3, sc. 6, p. 141.]
La part mauvaise du personnage est-elle prédominante ? Son côté « pire », ce sont tous les traits que nous avons étudiés comme motivations potentielles du meurtre : outre la dureté et le cynisme, la part de sadisme dont il a fait preuve avec Iñès et peut-être don Christoval, le précepteur de Pedro; sa haine de la vie faite d'aigreur et de dépit et jusqu'à ses préférences « théoriques » peuvent lui être reprochées, en retournant contre lui son excès dans l'exigence... A-t-il le droit de dire à son fils :
« Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. » [A. 1, sc. 3, p. 27.]
C'est la raison pour laquelle nous avions préféré le terme de « théorie » à celui de Blanc, de « morale de la qualité ». Y a-t-il une « identité morale » du personnage ?
Il nous faut aborder la question de sa foi : car si Ferrante est croyant, il est pécheur, et le crime devient faute... Nous pouvons de toute façon déjà considérer l'acte « plus » ses circonstances « aggravantes » : il y a meurtre ; mais ce meurtre est celui d'un femme, d'une femme innocente et pure, surtout d'une femme enceinte ; et cette femme innocente est enceinte de son propre fils : « un enfant de [son] sang se forme en [elle]. »218...
Et Ferrante, dans un premier temps au moins, a eu conscience de l'horreur d'un meurtre visant à la fois un être plein d'amour pour Pedro, innocent et créant potentiellement la vie :
« L'amour payé par la mort ! Il y aurait grande injustice. [...] N'est-ce pas cruauté affreuse, que tuer qui n'a pas eu de torts ? [...] La nature ne se révolte-t-elle pas, à l'idée qu'on ôte la vie à qui la donne ? » [A. 2, sc. 1, pp. 61-3.]
Dans cette dernière citation, Ferrante invoque non l'autorité de Dieu, mais « celle » de la « nature »; quand il parle de « faute », l'unique occurrence de la pièce est employée pour signifier l'erreur que le roi s'apprête à faire, de signer un traité avec le roi d'Aragon :
« J'ai conscience d'une grande faute; pourtant je suis porté invinciblement à la faire. » [A. 2, sc. 5, p. 59.]
Et quand il rêve son agonie, il fait allusion à Dieu et au péché219, mais parle ensuite seulement d'une « présence » mystérieuse :
« J'ai mes visitations.[...] L'heure que Dieu a choisie, c'est péché que vouloir la changer.[...]Il y avait sûrement une présence, car je lui faisais remarquer que d'instant en instant je m'affaiblissais. » [A. 3, sc. 1, p. 108.]
Ce cumul est curieux; pourtant à l'instar des autres personnages Ferrante fait de nombreuses références à Dieu ; par exemple :
« Quand tout concourt à ce point à faire qu'une chose soit bonne, il ne faut pas s'y tromper : Dieu est derrière. » [A. 1, sc. 3, p. 29.]
« [...] je vous jure par le sang du Christ [...] » [p.33.]
« [...] j'ai ce peuple que Dieu m'a confié [...] » [A. 1, sc. 5, p. 46.]
« Mon Dieu, ne lui pardonnez pas, car il sait ce qu'il fait. »220
mais il nous semble qu'il est sincère malgré le cynisme qui suit la remarque d'Egas :
« [...] Hélas ! nous sommes bien loin ici du Royaume de Dieu.
- lequel, en effet, n'a rien à voir avec notre propos.
- C'est un simple soupir qui m'échappait en passant. » [A. 2, sc. 1, pp. 66-7.]
« Est-ce qu'il n'y a pas de quoi en mourir d'ennui ? Et c'est Dieu qui a créé cela ! Il est bien humble. » [A. 2, sc. 3, p. 76.]
Il semble donc que Ferrante, même s'il évoque Dieu pour justifier ses propres intentions ou pour blasphémer, ne le fait pas sans que cela soit signifiant ; plus encore que le nombre de ses évocations, c'est sa tendance à s'assimiler à Lui qui montre l'importance qu'il Lui accorde, en même temps qu'elle montre une nouvelle fois l'orgueil du personnage :
« L'une après l'autre, les choses m'abandonnent; elles s'éteignent, comme ces cierges qu'on éteint un à un, à intervalles réguliers, le jeudi saint, à l'office de la nuit, pour signifier les abandons successifs des amis du Christ. » [A.2, sc. 3, p.77.]
« Et puis, je ne suis pas un roi de gloire, je suis un roi de douleur. Sur l'étendard de Portugal, j'ai augmenté le nombre de ces signes qui y représentent les plaies du Christ. » [A. 3, sc. 1, p. 109.]
« Moi aussi, dans un autre sens, je suis crucifié sur moi-même [...] » [A. 3, sc. 6, p. 128.]
En fait, Ferrante est chrétien, mais sans que cela l'empêche de se conduire avant tout en fonction de ce qu'il est ; il est un « criminel qui se tient pour bon chrétien »221, donc pécheur, si l'on peut dire, avant d'être chrétien...222 Il va d'ailleurs se définir comme tel dans un résumé de son « personnage », par une apposition qui dans sa bouche, ne contredit pas l'épithète homérique faisant écho aux paroles de don Christoval, au début de la pièce :
« [...] moi, le roi de Portugal, vainqueur des Africains, conquêteur des Indes, effroi des rebelles, Ferrante le Magnanime, pauvre pécheur. » [A. 3, sc. 1, p. 109.]
La dualité de Ferrante se retrouve encore une fois dans le rapprochement des notions de magnanimité et de péché ; sa théorie n'a de lien avec la foi non dans la morale mais dans l'aspiration à une transcendance . Ainsi Ferrante s'exclame, au moment précis où il vient de livrer l'évêque de Guarda à la mort :
« Vous voulez un mort ? Vous avez l'évêque. Saoulez-vous-en. [A part.] Ô Royaume de Dieu, vers lequel je tire, je tire, comme le navire qui tire sur ses ancres ! Ô Royaume de Dieu ! » [A. 2, sc. 2, p. 73.]
A l'opposé d'Iñès qui trouve « sur la terre » les « choses divines » qu'elle connaît, pour Ferrante l'essentiel est la verticalité ; qu'il s'agisse de Dieu ou du Rien, seul le mouvement ou plutôt la tension verticale compte...
Notre problème vient finalement de ce que Ferrante n'est ni exclusivement « bien meilleur », ni exclusivement « bien pire »223 ; il n'a pas d'unité d'un point de vue moral puisqu'il est à la fois effectivement bon et mauvais, à la fois chargé d'humanité et dépourvu d'humanité...224
Or il n'est plus question ici de « théorie », mais d'un fait : il n'y a par conséquent pas d'annulation possible des contraires, mais seulement cumul... et le cumul des contraires n'est pas l'union des contraires.
Alors comment juger l'acte de Ferrante, ou plutôt Ferrante à travers son acte ? Dans son cas comme dans tout cas, il y a a priori deux jugements possibles : le pardon, ou la condamnation. Citons dès à présent l'auteur : si, dans ses Notes de 1948 sur Fils de personne, il affirme « Il ne peut venir à l'esprit de personne de sensé que Carrion ait tout à fait raison - pas plus que Ferrante [...]. Avec lui je ne prône pas une attitude, je peins un homme donné, dans un cas donné, c'est-à-dire un homme dont la conduite recèle du bien et du mal [...] »225, il dira aussi dans ses Notes de théâtre : « Le roi Ferrante est un chrétien d'un type qui fut courant au Moyen-Âge. Il agit tantôt bien, tantôt mal, et il ne semble pas que le christianisme l'arrête jamais dans ses mauvais penchants. Mais il se réfère sans cesse à ce christianisme. Dieu est vivant pour lui.[...]. Et la question que je me pose est celle-ci : aux yeux de la religion catholique, qui vaut le mieux, un incroyant, voire un blasphémateur vertueux, ou un sacripant qui, une fois débondées ses passions, réagit dans le sens chrétien (conscience du péché, remords, appel à Dieu, mouvements de charité, etc.) ? Lequel des deux sera sauvé, le juste incroyant ou le pécheur croyant ? » .Cette question, le dramaturge ne va-t-il pas y répondre ? Lui pour qui Ferrante correspond partiellement à ces deux portraits, lui pour qui Ferrante est « à mi-chemin entre le grossier, qui prend au sérieux les actes, et le spirituel pur, qui se refuse à toute action. »226 ?
Dans La Reine morte comme dans toute tragédie, la mort clôt la dernière scène. Elle fixe dans la pièce le sort de trois personnages : Iñès, dont le corps est ramené dans le palais sur une civière ; Ferrante, qui s'écroule devant son trône ; enfin Egas Coelho, entraîné hors de la scène sur ordre du roi... La mort devrait agir comme un révélateur du personnage de Ferrante, comme c'est le cas pour Iñès et pour Egas Coelho : en effet la première est re-connue, puisque Pedro pose sur elle la couronne, et le second est dé-masqué, puisque des serviteurs l'arrêtent... Ces deux personnages sont jugés, l’un par le sacre et l’autre par l'arrestation. Mais la mort de Ferrante est-elle révélatrice de ce qu'il est, permet-elle un jugement ?
Nous pouvons dire que la fin de la pièce va développer une nouvelle dualité : il y double jugement potentiel, acquittement ou condamnation d'une part, et absolution ou damnation de l'autre... car le point de vue est lui aussi potentiellement double : il y a celui de l'humain, et celui du divin.
Notons que c'est la pièce elle-même qui nous impose la prise en compte de ce double regard, cette double présence : par la dernière scène où il est fait mention de Dieu plus que dans La Reine morte entière, mais aussi par une vision du monde moral divisée en un plan humain et un plan divin par les personnages, indépendamment de leur comportement dans ce monde : ainsi Ferrante affirme à son fils, par un rythme binaire souligné par la répétition de la structure de phrase :
« Je vous ai toujours vu [...] croire que je faisais par avidité ce que je faisais pour le bien du royaume ; croire que je faisais par ambition personnelle ce que je faisais pour la gloire de Dieu. » [A. 1, sc. 3, p. 27.]
L'Infante opère la même distinction au sujet de la gloire, mais fait coïncider les deux plans dans son intention de soustraire Iñès à la mort :
« Il y a deux gloires : la gloire divine, qui est que Dieu soit content de vous, et la gloire humaine, qui est d'être content de soi. En vous sauvant, je conquiers ces deux gloires. » [A. 2 sc. 5, p. 96.]
Nous avions remarqué combien importait à Ferrante le jugement humain : celui de ses contemporains, comme ses ministres ou Iñès :
« Mais quoi ! est-ce que j’apparais si faible ? » [A.2, sc. 1, p.65.]
« De tout ce que vous m'avez dit, je retiens que vous croyez m'avoir surpris dans un moment de faiblesse. » [A.3, sc. 6, p.141.]
Mais aussi celui des hommes à venir :
« Je ne puis croire que la postérité me reproche de n'avoir pas fait mourir une femme qui est innocente quasiment. » [A.2, sc. 1, p.64.]
« [...] rien ne restera qu'un portrait [...], le portrait d'un homme dont les gens qui viendront seront incapables de citer un seul acte, et dont ils penseront sans plus, en regardant ce portrait : « Celui-là a un nez plus long que les autres. ». » [A. 3, sc. 1, p. 109.]
« Messieurs, je ne sais comment l'avenir jugera l'exécution de doña Iñès. Peut-être un bien, peut-être un mal. » [A. 3, sc. 8, p. 148.]
Ce qui est frappant dans ce dernier exemple, c'est son souci du jugement humain alors même qu'il va mourir ; qui plus est, mourir de cette mort « qui vous met enfin hors d'atteinte »227 - hors d'atteinte de ce jugement, cela est clair228 - comme il le soupire juste avant la dernière scène... Le plus paradoxal en la circonstance est que Ferrante est inquiet du jugement humain, mais pas du jugement divin...
En effet, dès le départ il a conscience de ce dernier, et semble vouloir s'y préparer :
« Au jour du Jugement, il n'y aura pas de sentence contre ceux qui se seront tus. » [A. 1, sc. 2, p. 24.]
Cette affirmation péremptoire à don Christoval laisse perplexe : est-ce à dire que la parole est condamnable aux yeux de Ferrante, ou seulement dans la mesure où elle véhicule la fausseté, où elle est mensonge ? Peut-être, car par la suite il rapproche les deux idées :
« Je voudrais ne plus m'occuper que de moi-même, à si peu de jours de me montrer devant Dieu ; cesser de mentir aux autres et de me mentir [...] » [A.3, sc. 6, p.130.]
Et dans la scène finale, Ferrante dira après avoir invoqué la raison d'État pour justifier le meurtre : « J'ai fini de mentir. »229, alors qu'il a fini de vivre...
Mais s'il a menti, et s'il a tué, comment se fait-il qu'il ne craigne pas ce jugement divin ?
Nous pouvons penser que Ferrante aspire tant à se connaître enfin, embrouillé lui-même par ses pensées ambivalentes et ses comportements contradictoires, qu'il fait passer cette connaissance avant tout autre sujet d'interrogation ; peut-être considère-t-il que les deux sont liés, et qu'en apprenant l'identité qui lui échappe il apprendra en même temps le sort qui lui est réservé... Car longtemps avant la scène finale, Ferrante attend cette connaissance sans peur apparente, au contraire : le possessif laisse à penser que Ferrante a des liens particuliers avec le divin :
« Bientôt mon âme va toucher la pointe extrême de son vol [...]. En un instant, j'apparaîtrai devant mon Dieu. Je saurai enfin toutes choses... » [A.2, sc. 3, pp. 77-8.]
Sa prière finale fait écho à cette affirmation :
« Ô mon Dieu ! Dans ce répit qui me reste, avant que le sabre repasse et m'écrase, faites qu'il tranche ce nœud épouvantable de contradictions qui sont en moi, de sorte que, un instant au moins avant de cesser d'être, je sache enfin ce que je suis. » [A.3, sc. 8, p. 148.]
La double occurrence de l'adverbe « enfin » marque l'impatience de Ferrante, dès avant le moment de mourir... Nous avons noté le possessif « mon Dieu » ; peut-être Ferrante n'a-t-il pas peur du jugement divin, moins parce qu'il a une autre priorité à l'esprit, que parce qu'il pense avoir toujours bénéficié d'une protection divine :
« Tous ces mondes où n'a pas passé la Rédemption... Vous voyez l'échelle ? [...] l'échelle de l'enfer aux cieux. Moi, toute ma vie, j'ai fait incessamment ce trajet ; tout le temps à monter et à descendre, de l'enfer aux cieux. Car, avec tous mes péchés, j'ai vécu cependant enveloppé de la main divine. Encore une chose étrange. » [A.3, sc. 6, p. 142.]
Cette image de la « main » rappelle celle qu'emploie Pedro pour signifier l'emprise de la destinée sur son couple ; mais ici, elle prend un sens positif, alors que Ferrante, en dénonçant l'étrangeté de ce qui lui semble une « élection », semble avoir conscience de ne pas la mériter... Et nous ne pouvons déterminer s'il espère que sa mort ne différera pas de sa vie sur ce point, parce que ce qui compterait est son mouvement de descente mais aussi d'élévation « incessant », ou parce que ce qui serait pris en compte ne compterait justement pas ce mouvement, et passerait outre...
Ferrante a-t-il raison, ou se trompe-t-il devant Dieu par aveuglement ? Il nous semble que face à la dualité potentielle du jugement à porter sur lui, il faille suivre son attente : le pardon à la fin de la pièce n'est possible que sur le plan divin, il ne peut venir que de Dieu ; car le jugement humain donné à la fin de la dernière scène nous est montré comme une condamnation...
En effet, outre la trahison ultime du page Dino del Moro, les didascalies nous expliquent clairement et avec insistance qu'un choix est fait par les hommes :
« [Au milieu de ce tumulte, on apporte sur une civière Iñès morte [...]. En silence, tous s'écartent du cadavre du roi étendu sur le sol, se massent du côté opposé de la scène autour de la litière, à l'exception de Dino del Moro [...]. Pedro prend la couronne et la pose sur le ventre d'Iñès [...], force par son regard l'assistance à s'agenouiller. [...] il sanglote. L'assistance commence à murmurer une prière. A l'extrême droite, le corps du roi Ferrante est resté étendu, sans personne auprès de lui, que le page andalou agenouillé à son côté. Le page se lève [...puis] va s'agenouiller avec les autres, lui aussi, auprès de la civière. Le cadavre du roi reste seul.] »
L'analyse proxémique de ces mouvements et positionnements sur la scène va dans le sens de l'hypothèse d'une condamnation230; par les hommes, Ferrante serait considéré plus comme bourreau que comme victime : son identité serait d'être inhumain, il serait « moins » qu'un homme, il serait finalement à considérer comme un monstre... Dans cette hypothèse, l'acte prévaut sur le caractère double de son auteur, le crime reste impardonnable quelle que soit l'identité de Ferrante, en soi ou dans le contexte... Ce jugement est le point de vue humain, « judiciaire », ancré dans la pièce par le symbole humain de l'« assistance », la foule de sujets, plus encore que par le sacre de Pedro et Iñès.
Seul le point de vue du Souverain Juge, pouvant dépasser le judiciaire, accorderait la Rédemption au personnage, parce qu'il peut distinguer le Bien du Mal, contrairement aux hommes; c'est ce que dénonce Ferrante même s'il est le premier pour qui ces notions, nous l'avons constaté plusieurs fois, sont brouillées :
« [...] j'ai été bien meilleur et bien pire que le monde ne le peut savoir. » [A. 3, sc. 1, p. 109.]
C'est dans la pièce même, par la bouche de l'Infante, que nous trouvons l'idée qu'un pardon divin est toujours possible :
« Est-ce que ce n'est pas beau, que, quoi qu'il arrive, et même si on a péché, on puisse toujours se dire : « Dieu me reste. » ? » [A. 2, sc. 5, p. 104.]
C'est peut-être pourquoi « son dernier mot est une prière de demande d'absolution qui correspond à la demande du dernier sacrement »231 :
« Mon Dieu, ayez pitié de moi ! » [p. 148.]
Ainsi, si Ferrante était absous et pardonné sur le plan divin, il serait plus victime que coupable, son caractère double prévaudrait sur l'acte... Qu'est-ce à dire ? Ferrante serait-il alors considéré comme « plus » qu'un homme ?... Pas un saint, mais un « élu » ? Pas un héros, mais toujours, dans un autre sens, un monstre ?
La complexité de Ferrante est certes une « complexité monstrueuse », selon le mot de Laprade, entre bonté et méchanceté, conscience d'une faute et remords, peur du jugement et attente de la mort... Le jugement définitif s'avère impossible parce que son identité l'est : Ferrante ne peut pas se définir plus qu'on ne peut « sculpter une statue avec l'eau de la mer »232.
Ce jugement définitif et effectif, pour ainsi dire « hors-pièce », serait oublier que Ferrante est un personnage de théâtre, du fait sans doute de sa considérable proximité avec son auteur, Montherlant... Notre but n'est ni de faire un « procès du héros », ni un « procès de l'homme »233... Pour nous, la nécessité de « juger » Ferrante a le sens neutre de l'identifier ; et cette identification demande une unité qu'il semble impossible de trouver... sans un dépassement, un point de vue différent.
Ce dépassement ne peut venir que d'un autre regard et d'un regard autre : nous nous trouvons à la fois dans la nécessité d'une vision transcendante qui ne peut être que celle du dramaturge, seul juge voire Dieu de sa pièce, et d'une « vue transcendée » qui en est la conséquence, qui mêle le plan théâtral à un plan mystique que nous pourrions appeler une mystique théâtrale...
Ce dépassement s'avère nécessaire car lui seul permet d'attribuer une identité au personnage, et de faire de sa faiblesse une force... Ferrante est un personnage qui s'appréhende nécessairement « au-delà » - nous reviendrons sur l'importance de ce mot - , au-delà de la notion d'unité, donc qui est « au-delà », et ainsi au-delà de la notion de jugement.
On peut se demander, finalement, si la fin de la pièce est vraiment son dé-nouement ; théoriquement au théâtre, ce dénouement, souvent par le biais de la mort, fixe le sort des personnages... Ici, outre l'incertitude quant à ce qui va advenir de personnages tels que Pedro ou l'Infante, la mort ne semble pas jouer son rôle pour Ferrante... Pourtant, une image de la pièce tendait à nous faire penser que la mort dé-noue les êtres : celle donnée par Iñès pour exprimer son angoisse devant une menace mortelle, justement :
« Souvent, au coucher du soleil, je suis envahie par une angoisse. [...]. Ou bien (comme c'est bête !) c'est le soir, quand je me déshabille, à l'instant où je dénoue mes cheveux. » [A. 1, sc. 4, p. 39.]
Sa peur de la mort correspond au moment où ses cheveux sont dénoués, dé-faits... Or l'image qu'emploie Ferrante dans une ultime définition de ce qu'il est, est justement celle du nœud, nœud gordien :
« Ô mon Dieu ! Dans ce répit qui me reste, avant que le sabre repasse et m'écrase, faites qu'il tranche ce nœud épouvantable de contradictions qui sont en moi, de sorte que, un instant au moins avant de cesser d'être, je sache enfin ce que je suis. » [A. 3, sc. 8, p. 148.]
Est-ce qu'à la fin, la justice divine tranche ? Pour Lancrey-Javal, sa « tirade d'agonie » révèle « l'obsession d'une dernière justice humaine, l'obsession de la justice divine », mais « cette dernière tirade débouche sur un silence [...] ; silence funèbre d'une parole qui se tait sans réponse possible. »234.
Le problème est dans cette indétermination, qui nous paraît voulue par l'auteur : à la fin de La Reine morte, n'apparaît pas le jugement défini et définitif du dramaturge - Dieu, Montherlant ne donne aucun jugement explicite. Pour Banchini, « dans les dernières pièces l'alternance perd de plus en plus son aspect serein et apparaît comme un lutte dramatique entre des contraires non plus conciliables : l'humain et le divin, par exemple. »235. Il ne nous semble pas qu'il faille attendre les dernières pièces pour voir l'alternance en échec ; mais la dualité entre les plans humain et divin se dépasse comme se dépasse celle de Ferrante, par la mort que lui a réservée l'auteur : Ferrante n'est ni condamné clairement et définitivement, ni pardonné clairement et définitivement... Le jugement reste suspendu.
Nous avons vu que le jugement humain, par le jeu des mouvements scéniques indiqué par les didascalies, allait dans le sens d'une condamnation ; mais ce jugement est-il vraiment considéré ? Nous l'avons vu, Ferrante craint ce jugement, non pas « malgré » mais du fait de sa conviction que les hommes ne peuvent juger en connaissance de cause.
Nous pouvons penser que c'est cette idée que l'auteur glisse par un moyen détourné dans la pièce, c'est-à-dire par la bouche de Pedro lorsque son arrestation le fait parler comme son père :
« C'est curieux, les hommes de valeur finissent toujours par se faire arrêter. Même dans l'Histoire, on n'imagine guère un grand homme qui ne se trouve à un moment devant un juge et devant un geôlier ; cela fait partie du personnage. » [A. 1, sc. 7, p. 53.]
Le rapprochement avec la fin de Ferrante est troublant. Mais outre cette expression de l'erreur attachée au jugement humain, il semble que l'auteur nous donne à penser que le sort de Ferrante est, d'une certaine façon, im-mérité... En effet, peut-être est-ce là le seul rôle de la trahison de Dino del Moro.
Car c'est bien avant la dernière scène que le page nous est présenté comme une incarnation du Mal :
« Un jeune démon est toujours beau. » [A. 2, sc. 5, p. 93.]
Cette formule lapidaire de l'Infante frappe d'autant plus que le page est évoqué pour la première fois ; et le portrait qu'elle développe peu après garde l'idée de sa malignité :
« Alors, ma chère, si vous ne voulez pas regarder le ciel, tournez-vous d'un coup vers l'enfer. Essayez d'acquérir le page, qui est d'enfer, et de savoir par lui les intentions du Roi. Il s'appelle Dino del Moro. Il est Andalou. Les Andalous ne sont pas sûrs. Il trahira tout ce qu'on voudra. » [p. 105.]
Pour l'Infante, nous voyons qu'il ne fait aucun doute que le page est mauvais. Et dans la scène où Iñès l'aborde, son comportement est « étrange » : il semble ne pas souffrir de l'absence de ses parents et notamment de sa mère si attentionnée (puisqu'elle veillait à le parer de fleurs ou de fils d'or porte-bonheur), mais parle de son père avec admiration, ce père qui lui a donné son nom :
« Mais on l'appelle Fernando del Moro parce que, ayant découvert que son intendant, un Morisque, continuait les pratiques païennes, il le poignarda de sa main. Mon père, il a la force de deux chevaux. » [A. 3, sc. 2, p. 112.]
Doit-on voir là un symbole, ou un mauvais présage ? Toujours est-il que le page ne suivra pas les conseils altruistes d'Iñès, ce qui le rend pratiquement coupable d'une double trahison :
« S'il vous déplaît de le servir, demandez à vos parents de vous rappeler, sous un prétexte quelconque. Ne restez pas auprès de quelqu'un qui a confiance en vous, pour le trahir.[...] Vous êtes un petit homme, avec déjà tout votre pouvoir de faire du mal. Non, ne continuez pas ainsi. Je vous le dis comme vous le dirait votre mère.[...] il faut que [les fils d'or dans vos cheveux] vous rappellent aussi que vous devez être pur comme eux. » [p. 116.]
C'est surtout la pitié que peut nous inspirer le personnage du Roi que renforce la trahison de ce subalterne, comme pour Malatesta ultimement trahi par Porcellio ; d'un enfant sans innocence, qui met en valeur par contraste celle du vieillard trompé : Montherlant ne pense-t-il pas que cette mort est imméritée, alors qu'il avoue son émotion - non sans humour il est vrai - devant elle ? :
« Les jours qui suivirent celui où je composai la mort de Ferrante, je ne pouvais relire ce passage sans que les larmes me vinssent aux yeux. Bravo ! »236
N'est-ce pas pour cette raison que l'auteur finit par faire enlever le sous-titre de la pièce, Comment on tue les femmes ? Peut-être lui aussi redoutait-il le « jugement humain », pour son personnage présenté comme un assassin (ou pour lui-même considéré comme un misogyne...) ?237
Car le « comment » de ce sous-titre est ambigu : on ne sait s'il signifie « comment on s'y prend pour tuer » ou « comment on en vient à tuer », s'il véhicule une approbation ou une réprobation...
Mais s'il n'y a pas de condamnation explicite donnée par l'auteur malgré le symbole du cadavre de Ferrante abandonné des hommes, il n'y a pas non plus de pardon explicite dans cette scène finale...
Nous avons vu que Ferrante, pour des raisons qui peuvent être multiples, ne redoutait pas le jugement divin ; mais rien ne nous dit qu'il ne se trompe pas. Car l'auteur fait en sorte que ce jugement nous reste inconnu : on peut tout autant penser que Dieu le protège ou qu'il le punit...
Nous avons parlé d'une justice divine qui « tranche » ; il est vrai que l'image du « sabre » au-dessus du Roi rappelle les images sanglantes de toute la pièce, « l'épée » crucifiant l'Infante ou la « flèche » clouant Iñès, mais surtout évoque la faux d'une mort violente :
« Oh ! Je crois que le sabre de Dieu a passé au-dessus de moi.[...] Ô mon Dieu ! Dans ce répit qui me reste, avant que le sabre repasse et m'écrase, faites qu'il tranche ce nœud épouvantable de contradictions [...] » [p. 148.]
Ces mots évoquent bien, même dans la prière du Roi, une punition divine, d'autant que l'arrivée de sa mort qu'il exprime en termes religieux survient immédiatement après son meurtre, laissant imaginer un lien direct de cause à effet entre les deux morts...
Mais cette impression est contrebalancée d'une part par notre connaissance de l'agonie « naturelle » de Ferrante, pris d'un malaise devant son fils dès la troisième scène du premier acte et évoquant son « tombeau » encore une scène avant, et d'autre part par l'impression d'un lien privilégié entre lui et Dieu à la fin de la pièce.
Quand Ferrante terrorise Egas Coelho en lui annonçant sa mort et en l'annonçant comme inévitable, il légitime cette annonce par la parole de Dieu :
« [Iñès] est morte. Dieu me l'a dit. Et toi tu es mort aussi.
- Non ! Non ! Ce n'est pas possible !
- [...] Avant d'expirer, tu verras ton propre cœur.
[hagard.] - Qui vous l'a dit ?
- Dieu me l'a dit. » [p. 147.]
Peut-être Ferrante est-il mû par la volonté de convaincre alliée à la conscience de l'échec de la simple parole humaine, ou à l'habitude de légitimer son comportement par de fausses justifications, comme celle de la raison d'État... C'est la possibilité de sa sincérité qui laisse planer l'indétermination quant à ce jugement divin, dans son affirmation à Egas comme dans sa prière, son adresse directe à Dieu :
« [Il attire Dino del Moro et le tient serré contre lui.] Que l'innocence de cet enfant me serve de sauvegarde quand je vais apparaître devant mon Juge. [...] Quand je ressusciterai...- Oh ! Le sabre ! Le sabre ! - Mon Dieu, ayez pitié de moi ! [Il s'écroule.] » [p. 148.]
Nous ne pouvons savoir si l'erreur de Ferrante s'avère un « pas » vers la condamnation ou vers le pardon, car l'auteur ne donne pas explicitement ni même implicitement la réponse divine... Enfin, nous savons par ses notes que Montherlant était tenté de « faire absoudre » son personnage : un quatrième acte, qu'il appelle « l'acte final », l'aurait uni, réconcilié avec Iñès et par là-même avec soi, puisqu'il serait monté au Paradis :
« Dans l'acte final, non écrit, de La Reine morte, on verrait Ferrante, grand, faible, assassin, pitoyable, mais qui a toujours vécu « enveloppé de la main divine », s'élever vers le ciel, emportant dans ses bras sa victime, et la présenter à Dieu : l'Assomption du Roi des rois. Pas besoin de la sauvegarde du petit faisan Dino del Moro. »238
L'intention du dramaturge est on ne peut plus claire...Tout le problème réside dans ce « non écrit » qui fait que le pardon n'est pas explicité : « J'ai toujours arrêté mes pièces à temps. Je veux dire : avant l'acte final, celui que je n'ai pas osé écrire. »239.
Ce verbe « oser » nous semble révélateur d'une conscience chez Montherlant de ne pouvoir pardonner à son personnage malgré son évidente tentation de le faire, et par là d'une conscience semblable à celle de Ferrante, d'un jugement humain pour qui la faute resterait impardonnable, et qui lui aurait fait enlever le sous-titre de la pièce... Car pour lui, « il y a deux moments où un homme est respectable : son enfance et son agonie. »240.
Finalement, si la fin de La Reine morte doit être un dénouement, est-elle une issue ou une chute ?241. L'aboutissement est-il une chute vers la destruction, ou une montée vers l'épanouissement ?
Nous revenons à cette idée que le dramaturge est le Dieu de sa pièce : Ferrante est laissé entre pardon et condamnation par son « créateur », celui-ci laisse intentionnellement planer sur son personnage une indétermination qui le suspend, littéralement, entre deux jugements... (Il nous semble que Pasiphaé laisse planer la même incertitude, même si l’héroïne comprend et assume finalement ses actes, elle qui dit à la fin du poème dramatique : « Heureuse ou malheureuse, innocente ou coupable, je suis ce que je suis et ne veux être rien d'autre. », tandis que dans Demain il fera jour, Carrion à l'inverse de Ferrante s'est compris et jugé : « Mourir, pour cesser de se connaître »...).
Voilà pourquoi un dépassement de la notion d'unité s'avère nécessaire pour fixer l'identité de Ferrante, qui correspond à la nécessité d'un plan autre, « au-delà » : en un mot, un plan mystique plus que théâtral.
Pouvons-nous parler d'une mystique, d'un mysticisme chez Montherlant ? Lui qui a reçu une éducation religieuse, qui lui a inspiré La Ville dont le Prince est un enfant, dit ne pas avoir la Foi242, en dépit du « ton janséniste » qu'il prend dans des pièces telles que Le Maître de Santiago ou Port-Royal... Blanc parle ainsi d’« athéisme chrétien » chez Montherlant243. Sa vision du monde semble tenir dans un premier temps du stoïcisme de l'Antiquité, et sa quête de « valeurs » telle que nous l'avons vue à travers la théorie de Ferrante, si elle rappelle Nietzsche, peut être prise comme une lutte contre l'absurdité de l'existence et l'angoisse du Néant, qui devient désespérée et nihiliste...
Enfin, la suspension de tout jugement définitif peut s'assimiler à un scepticisme, une attitude de doute absolu auquel il faut se soumettre, qui rappelle Pascal pour qui « à la fin de chaque vérité, il faut se souvenir de la vérité opposée », même s'il nous semble qu'il s'agit dans la pièce d'une attitude au contraire subjective. En tout cas, il ne nous paraît guère possible d'affirmer avec Banchini que, si Montherlant « détruit, en somme, tout ce qui dans l'homme est postiche et tout ce qui est ignoble », « la fin de la destruction, une morale apparaît. »...244. À notre sens, l'ambiguïté finale correspond à une sorte de moyen-terme, qui en lui même pourrait justement être pris pour a-moral... D'autant que le dramaturge s'est souvent défendu de faire de ses pièces des « prêches »...
Nous dirons que « dans » la pièce Montherlant, du fait de son aspiration à un dépassement de soi in-fini et transcendant visible à travers l'importance pour Ferrante du principe de verticalité, est moins proche de l'athéisme que du mysticisme, à partir du moment où il est question d'un ordre « supérieur » quel qu'il soit mais au-dessus du réel. Ce commentaire de L'Assomption du Roi des rois est à cet égard éloquent : « Du moins Khosrau remplit-il mon vide de cette sublime atmosphère d'imprécision sacrée, où il n'est tenu compte ni du temps ni des espaces ; où l'on ne peut identifier ni un individu ni un lieu ; [...] où tout s'échappe en autre chose ; où tout me dit : « je suis ce que je suis » et « je suis ce que je ne suis pas » ; où tout reste toujours possible ; où tout se vaut.[...] C'est la religion de cet indéterminé que j'étais fait pour incarner [...] et exprimer [...]. ». Cette description rejoint également une phrase tirée de Un voyageur solitaire est un diable : « Au-delà du réel et de l’irréel, il y a le profond. ».
Bien sûr cette suspension que nous appelons mystique peut être considérée comme purement théâtrale : ainsi de Batchelor qui, s'il voit à Montherlant plusieurs visages, « réaliste et idéaliste, rationaliste et lyrique, sensuel et mystique peut-être », considère que dans son théâtre « les personnages semblent suspendus entre l'acte toujours comprometteur et le détachement souverain. »245.
C'est surtout ici la connotation du terme « au-delà » qui nous fait parler de mysticisme : pour lui, « au-delà du réel et de l’irréel, il y a le profond », ce qui fait écho à cette phrase de Pasiphaé : « Je suis extraordinairement seule ; et il est bien que ce voile me mure plus profond, au-delà de tous et de toutes. ». Là encore nous citerons le mot présent chez Batchelor : « Montherlant est habité par une vision de la vie obsessionnellement maintenue, qui porte au-delà du rationnel pur. »246.
Outre dans le terme « au-delà », le religieux est présent dans le double sens de nombreux autres termes que nous employons depuis le début : « sacrifice », « faute », « jugement », et bientôt « suspension » et « mystère »...
Et le principe de verticalité se retrouve dans notre incertitude quant au sort ultime de Ferrante, qui peut être chute ou ascension de soi-même, comme c'est le cas pour le roi Khosrau247 ; car Montherlant se fait ambigu dans ses commentaires :
« Toute la pièce est dominée par la figure du roi Ferrante, qui grandit à chaque acte et semble lentement se séparer de l'humain jusqu'à l'instant où il tombe. »248
« Dans l'acte final [...] on verrait Ferrante [...] s'élever vers le ciel [...] : l'Assomption du Roi des rois. »249
Doit-on imaginer à nouveau une dualité entre « intérieur » et « extérieur », qui fait que le personnage chute sur un plan humain et s'élève sur un plan divin, « s'écroule », comme l'indique la didascalie, sur la scène, et reste suspendu entre les mains du Dieu-dramaturge ?
Cela pourrait être une définition du plan mystique : un plan intermédiaire, qui ne serait pas le plan divin mais qui serait « au-delà » du plan humain ; ou encore, qui serait au-delà de la dualité de ces deux plans... Nous parlions de la théorie appliquée par mais aussi à Ferrante comme d'une théorie élitiste particulière ; et il s'agit bien d'une échelle de valeurs différente, au-delà de l'échelle de valeurs humaine puisqu'elle passe outre l'acte de celui qui la prône et tend à l'incarner...
La conséquence directe de cette con-fusion du plan théâtral et du plan mystique est que Ferrante acquiert au bout du compte un statut d'exception. Est-il un cas exceptionnel donc une exception ? Ne s'agit-il pas moins d'élitisme que d'élection ?
Attention, ce plan mystique n'est pas un plan moral, à partir du moment où Ferrante est un personnage meurtrier, mais où aussi l'idée de justice implique l'égalité des personnes... Nous avons parlé de « monstre » pour qualifier Ferrante condamné et Ferrante pardonné ; ce mot fait de Ferrante un « cas particulier », un personnage a-normal au sein d'une pièce a-morale... Et si l'unité est impossible chez Ferrante, son identité ne peut être qu'absolue, exceptionnelle parce qu'elle s'appréhende au-delà de la notion d'unité et parce que le problème posé par cette identité devient un mystère.
Citons la définition du mystère par J. Guitton : « Un problème est une difficulté qui tient à notre ignorance et qui peut se résoudre par le savoir. Un mystère est une difficulté qui tient à la nature des choses et que la connaissance accroît. ». Il rejoint ainsi la pensée de Gabriel Marcel pour qui « un mystère, c'est un problème qui empiète sur ses propres données, qui les envahit, et qui se dépasse par là même comme simple problème. »250.
On peut dire de Ferrante qu'il constitue un mystère, qu'il en est un de par sa ou plutôt ses dualités, de par sa complexité in-finie, par ce qui fait sa particularité, sa singularité ; par ce qui fait sinon son unité, son originalité... A ce propos, son nom même peut aller dans ce sens : pour Lancrey-Javal, qui dénonce ces associations d'idées comme « toujours hasardeuses », le nom de Ferrante peut se diviser en « Fer » qui évoque la dureté et « errante » dont l'association est oxymorique, donnant un « rappel cruel de fera, ferox latins, dérision par la disparition du « v » de l'adjectif fervente », tandis que le fait que son nom n'ait pas de numéro fait qu'« à lui seul, il est son propre début et sa propre fin. »251.
La sonorité de son nom reste étrange, et participe au mystère du personnage. De même pour son goût de l'« étrangeté » : il l'aime parce qu'elle lui ressemble, qu'il trouve cette étrangeté dans la situation d'Iñès, dans la personne de l'Infante, dans son rapport à Egas ou dans les voies de Dieu :
« Car vous êtes restée seule au Mondego. C'était une situation un peu étrange pour une jeune fille. Peut-être faut-il regretter que je ne vous aie pas connue davantage. » [A. 1, sc. 5, p. 43.]
« L'Infante, elle... Enfin, je l'aime. Elle m'a un peu étourdi [...] mais elle est brusque, profonde, singulière. » [A. 1, sc. 3, p. 29.]
« [...] je vous fais confiance quand même. Cela est étrange, mais il n'y a que des choses étranges par le monde. Et tant mieux, car j'aime les choses étranges. » [A. 2, sc. 2, p. 73.]
« [...] avec tous mes péchés, j'ai vécu cependant enveloppé de la main divine. Encore une chose étrange. » [A. 3, sc. 6, p. 142.]
On peut considérer comme une contradiction de Ferrante que, malgré son attrait pour l'étrange, il soit irrité par l'idée d'un « secret » que lui cacherait Egas Coelho :
« Vous avez un secret. Je veux voir ce que vous êtes, après ce que vous faites paraître.
- Seigneur, que dire de plus que...
- Il y a un secret ! Il y a un secret ! [...] Alors ? - Ce n'est pas un secret contre moi, au moins ? - Je veux savoir ce que vous cachez. Je vous poursuis, et ne vous trouve pas. [...] Il y a en vous quelque chose qui m'échappe, et cela m'irrite. J'aime qu'un homme soit désarmé devant moi comme le serait un mort. Il y a en vous une raison ignoble, et je veux la percer. » [A. 2, sc. 2, pp. 70-1.]
L'acharnement du roi, montré par la répétition des tournures de phrase « il y a » et « je veux », pourrait venir de ce que l'étrangeté de la motivation d'Egas lui déplaît, uniquement parce qu'elle ne va pas dans le sens de ses propres intérêts ; ainsi Ferrante n'apprécierait l'étrange que lorsqu'il l'arrange ou ne le dérange pas... Mais il est frappant que rien dans la pièce n'indique que Ferrante n'est pas dans l'erreur à propos de l'existence même de ce « secret », alors qu'il a par ailleurs fait montre d’élans de paranoïa... Là encore subsistera un mystère, mais nous pouvons penser qu'à tort ou à raison le personnage prête à autrui ce qu'il y a chez lui : le « secret » révélé à Iñès lors de sa crise « d'identité ». Sa menace finale à Egas va dans ce sens, nous l'avons vu :
« Eh bien ? [Silence.] Un jour vous serez vieux vous aussi. Vos secrets sortiront malgré vous [...]. » [p. 72.]
Si l'on doit considérer Egas Coelho comme un personnage mystérieux, Ferrante l'est au même titre, et plus encore : car c'est malgré ses confidences à Iñès qu'il est et reste un « nœud épouvantable » de complexité, une « énigme à interroger »252.
Montherlant le qualifie bien sûr de « personnage mystérieux », et le compare à un « fantôme »253, c'est-à-dire, tout comme l'Infante le fait, à un mort-vivant, un être au-delà de la vie et de la mort...
Pour reprendre une distinction existentialiste, son existence reste mystérieuse jusqu'au bout, et son essence aussi, de par l'indétermination d'un jugement suspendu ; son mystère tient à ce statut d'exception, et cette exception est elle-même mystérieuse : Ferrante est peut-être « moins qu'un homme », ou peut-être « plus »254 ; il est au-delà.
Sur ce que nous avons appelé le plan mystique, mêlé au plan théâtral du fait d'une présence de l'auteur appréhendée comme transcendante, au-dessus de ses personnages, il y a « suspension » mystique de Ferrante, une suspension que nous nommerons « grâce théâtrale »...
Car le personnage se retrouve au-delà du jugement grâce au suspense - au « suspens », dans le langage du théâtre classique - qu'a voulu et créé Montherlant pour conclure la pièce, aussi s'agit-il également d'une suspension dans la durée, d'une fixation du personnage.
Et cette suspension relève de la transcendance, puisque Ferrante reste dans un au-delà entre le haut et le bas, peut-être quelque part sur « l'échelle de l'enfer aux cieux »255. Il est suspendu entre ce qui est, qui correspond dans la pièce au plan, à l'échelle - de valeurs - humains, et qui ne suffit pas pour l'identifier ; et ce qui n'est pas, qui correspond au plan divin256, et qui serait idéal ; du même mouvement vertical, de la même façon finalement qu'il était divisé entre la conscience, véhiculée par la parole, de ce qu'il était et l'idée, véhiculée par l'image, de ce qu'il était. C'est ainsi que nous comprenons cette conclusion de Mohrt : « Je le vois perdu [...] au milieu de la foule des hommes qui arrivent [...] en vue de leur mort. Il est parmi eux, quelque part, [...] pas beaucoup plus haut que les vilains et les criminels, pas beaucoup plus bas que les héros et les illustres. »257.
Enfin cette suspension est une grâce théâtrale, puisque son statut d'exception, quel qu'il soit, fait de sa faiblesse fondamentale une force ultime258. Montherlant n'a-t-il pas dit, dans Les olympiques, que « la moitié est plus que le tout » ?
A partir du moment où l'identité du personnage est au-delà, Ferrante est au moins soustrait par son Créateur à un jugement, sauvé du jugement humain qui est le nôtre...259
Ne pouvons-nous pas dire que la demande, le vœu de Ferrante d'être « hors d'atteinte » grâce à la mort est exaucé par son Dieu-dramaturge ? Car la peur du jugement est finalement le refus d'être défini et identifié par autrui, quelle que soit cette définition ou cette identité...
Et nous sommes bien réduits à dire que ce qui fait l'identité du personnage est de n'en avoir pas... Ou est de l'ordre de l'Absolu. Nous rejoignons ici Banchini lorsqu'il affirme que « Si l'homme a une unité, il ne la trouve que dans ses contradictions. »260.
Car il y a nécessité de dépasser la notion d'unité pour la trouver. Notons que cette idée se retrouve chez Lancrey-Javal, qui va dans le sens de l'identité mystique de Ferrante : « Omnipotence du langage (ordres décisifs de monarque) et impuissance du langage à écrire et à décrire son identité véritable, à confier avec clarté qui il est, voilà sans doute l'une des contradictions majeures du personnage, jusqu'à son agonie qui n'apporte explicitement aucune révélation dans une phrase dont l'antéposition haletante des compléments exprime le suspens du sens : « Un instant au moins avant de cesser d'être, je sache enfin ce que je suis ». C'est le paradoxe final d'un personnage théâtral qui trouve, somme toute, son identité singulière dans sa quête impossible d'identité. »261.
Son identité reste un mystère, et c'est cela qui fait Ferrante : le dépassement de l'unité le fixe dans cet au-delà de l'humain, dans ce statut de grâce théâtrale. Car tout est permis au théâtre...
CONCLUSION
Notre quête elle-même est suspendue. L'identité de Ferrante, incertaine.
Quelques critiques affirment l'avoir trouvée ; comme Batchelor, qui trouve l'unité de Ferrante dans sa passion de la raison d’État : « Ce qui se passe, une fois le rideau tombé, ne nous retiendra guère. Ce qui est important, c'est que l'apparente « philosophie du rien » ne soit pas plus chez Ferrante qu'un manque de foi dans sa capacité et son pouvoir d'accomplir ses fins.[...] ses mouvements vont de pair avec sa préoccupation, réelle et profondément enracinée, de l'avenir de la monarchie au Portugal.[...] il a été souligné qu'il est presque impossible, en première apparence, de découvrir quelque dessein auquel les héros de Montherlant se conformeraient.[...] Philippe dans L'exil et Ferrante dans La Reine morte agissent en fin de compte selon leurs désirs profonds. »262. Pourtant dès la page suivante, il revient sur la notion de retraite et l'absence des actes, pour admettre « il est clair que pareil empire sur soi est battu en brèche par l'inéluctabilité des impulsions psychologiques. ».
Blanc quant à lui la trouve ailleurs : « Où trouver l'unité du personnage ? On répondra : dans la lucidité. La conscience de ses actions et de ses états d'âme, conscience aiguë et nette, demeure le trait dominant du Roi. Certes, on peut se tromper sur soi-même [mais] il n'est pas prouvé que Ferrante se trompe. Au reste, se tromper en sachant qu'on se trompe, c'est encore être lucide »263...
Il est vrai qu'il n'est pas prouvé que le personnage s'aveugle, mais il faut bien « se souvenir de la vérité opposée » : il n'est pas prouvé non plus que Ferrante ne se trompe pas, et l'on peut penser que « se tromper en sachant qu'on se trompe », c'est encore se tromper...En outre Blanc, lui aussi une page après avoir conclu, explique que « probablement la lucidité de Ferrante est à la source de sa faiblesse profonde. »...
L'identité du personnage est donc incertaine, et quelle qu'elle soit, menacée. Le symbole de la perte est chez Montherlant significatif : perte de ce qu'on a fait (l'« œuvre » de Ferrante est menacée de destruction comme celle de Cisneros à la fin du Cardinal d'Espagne, comme la Vita brûlée par Porcellio de Malatesta) , perte de ce qu'on a senti ( Ferrante rejoint Carrion face à son enfant dans Fils de personne, mais aussi Ravier face à Christine - et Mlle Andriot - dans Celles qu'on prend dans ses bras, même Persilès face à lui-même à la fin de Brocéliande ou Carrion dans Demain il fera jour...) , perte de ce qu'on a été enfin : la perte est aussi celle de la mémoire. Ferrante cauchemarde qu'il ne peut écrire sur sa peau pourrie, parce que comme pour Goethe agonisant « l'essentiel est que ce soit écrit » ; puis il déclare « Ce que j'ai écrit, je demande : « De qui est-ce ? ». Et ce que j'avais appris, je l'ai oublié. »... L'auteur le dit bien : quand il change brusquement de sentiment, « il oublie qu'il était sincère » avant ce changement264.
La menace de la perte d'identité ne concerne pas que Ferrante mais finalement tous les personnages de Montherlant à des degrés divers, même ceux qui semblent très différents de lui : ainsi Don Juan lui, aime, mais parce que « l'acte d'amour [lui] donne des preuves qu'[il] existe. » Cette incertitude partout retrouvée265 incite à chercher chez l'auteur lui-même la vérité, sans que cette quête soit plus évidente266...
A l'époque d'Aux fontaines du désir ( 1927 ), le poète est pour lui « comme les formes sur l'échelle de Jacob, il va sans cesse, par croissance ou par bonds, de la boue de la terre aux étagements du ciel »; à celle de La rose de sable ( 1968 ), il écrit dans ses Carnets : « La foi ? Démission de l'intelligence. L'espérance ? Démission du caractère. Charité : la seule des vertus théologales qui soit inattaquable. »267.
Peut-il vivre de la seule croyance en la charité ? Montherlant est peut-être une conscience désespérée268 ; Batchelor pense que « comme Camus, Montherlant fait le pari que nous pouvons trouver, sans Dieu et sans la vie éternelle, le bonheur, l'innocence et - pourquoi pas ? - même la sainteté. »269. Il cite Jean de Beer pour qui la conduite de l'auteur est celle « du saint qui aspire à l'éternité »270.
Mais ce dernier se demande aussi si « son œuvre n'apparaît pas [...] comme une entreprise, jamais achevée, pour établir et définir ses relations avec le monde extérieur »271.
Vers quoi, ou qui Montherlant est-il tourné ? Mohrt conclut à un équilibre acquis : « Homo duplex, Montherlant est, a toujours été hanté par l'unité. Unité de l'individu, unité du monde. [...] Il a voulu être à la fois Dieu et le Diable, bon et mauvais, se dévouer et se dérober, servir et se servir. Toute sa vie ( ses premiers écrits en témoignent ) il a cherché l'un et le tout.[...] Voilà son exemple : celui d'un effort sans cesse répété, tendu, héroïque, pour se trouver, se posséder, se réaliser, pour être soi-même. »272.
Mais en 1943, il ne peut voir l'échec sur lequel l'auteur clôt toutes ses pièces et ses romans après La Reine morte ; l'échec de la communication, l'échec de la compréhension et finalement l'échec de soi que subissent ses héros...
Carrion veut « mourir pour cesser de se connaître », « il sait que personne ne le comprendra, que personne ne souffrira de sa souffrance »273 ; Bruno est un incompris : « comment ferai-je pour vivre dans un monde où les motifs de mes actes sont aussi incompréhensibles à mes semblables qu'ils pourraient l'être à un bœuf ou à un cheval ? » ; Alvaro aussi : « je ne suis entendu de personne. Parfois il me semble que tout ce qui se passe en moi se passe si loin de toute compréhension humaine... », Acilius encore : « Le monde qui m'entoure n'a même pas notion du monde qui est mon monde à moi. » etc.
Banchini hésite : « cet écrivain qui n'avait jamais cessé, dans son œuvre d'essayiste et de romancier, d'exalter le bonheur, arrive à proposer tout le long de son œuvre théâtrale, une vue désespérée de la condition humaine. » ; puis : « l'éthique de Montherlant est une éthique sévère.[...] Ses héros confrontent sans cesse leurs passions et leurs actions avec un idéal qui est toujours au-delà de ce qu'ils sont et ce qu'ils font.[...] tous nous donnent des leçons de rigueur [...], il s'agit de suivre jusqu'au bout la voie que l'on a choisie. »274.
Il nous semble que c'est le contraire : leur échec n'est pas une « leçon », ou alors la leçon inverse, implicite : ne pas suivre jusqu'au bout la voie que l'on a choisie, si l'on s'est trompé.
Nous ne pensons pas que Montherlant soit jamais sorti du « tourment de l'unité », dont il parlait dans les Textes sous une occupation. Dès Service inutile ( 1935 ) son oxymore pour en expliquer le titre se faisait double : « L'âme dit « service », et l'intelligence complète : « inutile. ». »
Ce déchirement est resté : toutes ses œuvres postérieures à La Reine morte montrent l'échec de toute ré-conciliation, tous ses héros subissent précisément cet échec, de l'austère Cisneros tenté de « n'être rien », au mi-grave mi-bouffon Don Juan qui tente de « rester soi-même jusqu'au bout. »
Peut-être « tout notre malheur est de n'être pas des saints », selon le mot de Léon Bloy ; peut-être est-il - aussi ou plutôt ? - qu'on ne peut échapper à soi-même... Si l'on en croit la définition que Montherlant donne dans ses Carnets XXII de la lucidité : « la passion de l’homme bourreau de soi-même ».
Et la Faute serait la fausseté, si l'on rappelle celui qui voulut « posséder la vérité dans une âme et dans un corps » : « Enfin, je demanderai pardon de m'être nourri de mensonge. », déclare Rimbaud à la fin d'Adieu, dans Une saison en enfer.
Doit-on parler finalement chez Montherlant de « narcissisme spirituel »275, si l'enfer n'est pas les autres mais soi ?
Doit-on s'arrêter chez Ferrante à l'idée de la faiblesse, plutôt qu'à celle de la force ?
Nous serions tenté de le faire avec Mignon : « Étrange solitude de ces êtres ! Poussés par quel obscur désespoir, ils s'emploient violemment à se hausser au-dessus de la collectivité, avec le sentiment peut-être de la dominer et d'échapper à une malédiction commune. Leur recours à l'orgueil est-il une élévation ou une fuite ? Trouvent-ils du répit dans leur orgueil ?... Le héros de Montherlant touche en effet par son mystère secret, par les interrogations que posent sa démarche et ses attitudes trop bien justifiées dans la superbe de ses discours, en somme par une faiblesse profonde qu'il ne parvient peut-être pas à surmonter. »276.
Notre sentiment est que l'orgueil est à la fois une élévation et une fuite, un haut recours qui pourtant ne permet pas de répit à long terme. Il ne nous semble pas qu'il soit possible d'éviter cette notion de faiblesse, comme le tente Simon : « nombre de personnages du théâtre de Montherlant nous déconcertent par une sorte de rupture dans la ligne de leur personnalité. Ne nous hâtons pas de croire à une faiblesse de conception : plutôt à un sentiment de la complexité mystérieuse et ondoyante des êtres. » Ce qu'il propose alors ne nous paraît guère contredire Mignon : Montherlant « tend vers cet état le plus misérable, encore qu'apparemment heureux, de la conscience : la satisfaction dans la négativité », ses pièces voient se « démen[er] ces masques appelant le dénouement de l'échec, l'écroulement plus ou moins total de la personnalité » et Ferrante est l'exemple d'« une catastrophe absolue de la personnalité [puisque] aspiré par le vide, le moi lui-même éclate. »277.
Son avis est peut-être pire : il refuse la faiblesse, mais reste sur l'échec du personnage.
Sur Ferrante, nous pouvons dire que nous savons que nous ne savons rien... Nous aussi nous restons sur un échec : celui de notre quête.
BIBLIOGRAPHIE
- BANCHINI, Ferdinando : Le théâtre de Montherlant, Roma : Fratelli Palombi éd., 1971.
- BATCHELOR, Jean : Existence et imagination. Essai sur le théâtre de Montherlant., Paris, Revue de France, 1970.
- BLANC, André : Montherlant, un pessimisme heureux., Paris, éd. du Centurion, 1968.
- BORDONOVE, Georges : Henri de Montherlant, Paris-Bruxelles, éd. universitaires, 1954.
- LAPRADE, Jacques de : Le théâtre de Montherlant, Paris, La jeune Parque, éd. Denoël, 1950.
- MOHRT, Michel : Montherlant, Paris, Gallimard, 1959.
- ROBICHEZ, Jacques : Le théâtre de Montherlant, Paris, Sedes, 1973.
- SAINT-ROBERT, Philippe de : Montherlant le séparé, Paris, Flammarion, 1969.
- SIMON, Pierre-Henri : Théâtre et destin. La signification de la Renaissance dramatique en France au XXème siècle., Paris, A. Colin, 1959.(chapitre IV. : "l'échec de l'amour dans les théâtres de Mauriac et Montherlant").
- SIPRIOT, Pierre : Montherlant., coll. Écrivains de toujours, Paris, Seuil, 1975.
STÉPHAN, Andrée : Le théâtre de Montherlant : incarnation d'une vision du monde., thèse de doctorat d’État, université de Grenoble, 1981.
- BLANC, André : La Reine morte de Montherlant., Profil d'une œuvre n°3, Paris, Hatier, 1970.
- LANCREY-JAVAL, Romain : Le langage dramatique de La Reine morte, Paris, P.U.F., 1995. (Étude comparée de La Reine morte et du Cardinal d'Espagne.)
- La Reine morte, coll. Folio, Paris, éd. Gallimard, 1947. (cette édition comprend les trois postfaces : Comment fut écrite La Reine morte, 1943 ; La création de La Reine morte, 1950 ; En relisant La Reine morte, 1954.)
- Théâtre, bibliothèque de la pléiade, éd. Gallimard, 1972.
- BARTHES, Roland : Roland BARTHES, Paris, Seuil, 1975.
- BELLEMIN-NOËL, Jean : Psychanalyse et littérature, Que sais-je ?, P.U.F., 1978.
- CHAPSAL, Madeleine : Envoyez la petite musique., Paris, Grasset, 1984.
- COUPRIE, Alain : Le théâtre, coll. 128, Paris, Nathan, 1995.
- DEVEREUX : Essais d'ethnopsychiatrie., NRF, Paris, Gallimard, 1973.
- HERSCH, Jeanne : L'étonnement philosophique. Une histoire de la philosophie., coll. folio essais, Gallimard, 1993.
- HODARD, Philippe : Sartre., éd. universitaires, J-P Delarge, 1979.
- HUISMAN, Denis, et VERGEZ, André : Nouvel abrégé de philosophie, Paris, Nathan, 1975.
- IMPACT MÉDECIN, hebdo n° 181, 26 février 1993, Les dossiers du praticien. Les schizophrénies.
- LAING, Ronald D. : Le moi divisé.( De la santé mentale à la folie.), Paris, Stock, 1980.
- LAING, Ronald D : La politique de l'expérience., Paris, Stock, 1980.
- MOUNIER, Emmanuel : Introduction aux existentialismes., coll. idées NRF, éd. Gallimard, 1962.
- SACKS, Oliver : Un anthropologue sur Mars., coll. la couleur des idées, Paris, Seuil, 1996.
1 Lancrey-Javal Romain, Le langage dramatique de La Reine morte., Paris, P.U.F., 1995., avant-propos, p. IX
2 Bordonove Georges, Henry de Montherlant, Paris - Bruxelles, éditions universitaires, 1954., p.70.
3 En relisant La Reine morte, p.147 de l'édition Gallimard.
4 Lancrey-Javal, op. cit., pp. 58-9.
5 Pléiade - théâtre, Gallimard, 1972., p.1308.
6 Les critiques de notre temps et Montherlant, présentation par André Blanc, Paris, Garnier, 1973., p.81. Cité par Stéphan Andrée, Le théâtre de Montherlant : incarnation d'une vision du monde., thèse de doctorat d’État, université de Grenoble, 1981., pp. 93-4.
7 En relisant La Reine morte, p.170 : "Le théâtre est fondé sur la cohérence des caractères, et la vie est fondée sur leur incohérence.". Ce regard objectif veut donc retranscrire le naturel de la vie au théâtre.
8 Sipriot Pierre, Montherlant., Paris, Seuil, 1975., avant-propos, p.4.
9 Robichez Jacques, Le théâtre de Montherlant, Paris, Sedes, 1973., p.7., cité par Lancrey-Javal, op. cit., p.13.
10 « Chaque protagoniste se définit aussi par le langage qu’il emploie – marque de son rang et de son caractère. L’opposition des caractères est clairement celle des langages. » Lancrey-Javal, op. cit., p. 68. Nous y reviendrons.
11 A. 2, sc. 5, pp. 94 et 97.
12 Stéphan Andrée, Le théâtre de Montherlant, incarnation d'une vision du monde., thèse de doctorat d’État, université de Grenoble, 1981, pp. 704-5.
13 Lancrey-Javal, op. cit. ., p. 216.
14 Blanc André, La Reine morte, profil d'une œuvre n.3, Paris, Hatier, 1970, p.47, dans le chapitre « le masque royal ».
15 Lancrey-Javal, op. cit. , p. 47.
16 Lancrey-Javal, op. cit. , p. 226.
17 Postface du Maître de Santiago, Ferrante et Alvaro, Plé-thé, p. 683.
18 Cité par Huisman et Vergez, Nouvel abrégé de philosophie, Paris, Nathan, 1975, p. 18.
19 « _ qui existe chez tous les êtres, mais poussé à un point extrême chez le Roi. ", Montherlant, En relisant la Reine morte, p. 170.
20 MOHRT Michel : Montherlant, « homme libre ", éd. La Table Ronde, Paris, 1943, in préface de 1989.
21 SIMON Pierre-Henri, Théâtre et Destin, Paris, A. Colin, 1959, p. 111.
22 BLANC André : Montherlant, un pessimisme heureux, éd du Centurion, Paris, 1968, p. 124 et p. 207.
23 Ainsi Montherlant affirme, dans Service inutile : « J'étais fait pour la joie toujours plus haute et toujours plus profonde. ".
24 En relisant la Reine morte, p. 170.
25 « Seuls, Iñès est toutes voiles dehors, par pureté, et Pedro, par simplicité ", ibid., p.172.
26 "Le système des personnages montre à quel point la place du roi est complexe. Ferrante se construit d'abord dans un système d'affinités avec le personnage qui, du point de vue de l'état civil, lui est le plus opposé, l'Infante de Navarre. Il est très vieux, elle est très jeune ; il est homme, elle est femme ; il est portugais et ondoyant [...] ; elle est espagnole et toute d'une pièce." Lancrey-Javal Romain : Le langage dramatique de La Reine morte, P.U.F., 1995, p.225.
27« Ce n'est pas don Pedro, c'est vous que je veux sauver ", dit-elle à cette dernière éplorée [A. 2, sc. 5, p. 102]
28 « En vous sauvant, je conquiers ces deux gloires [humaine et divine]. " [p. 96].
29 Dès Les Olympiques, Montherlant proclamait : « Admirer pour pouvoir aimer. »
30 Blanc, qui parlait de « morale de la qualité », affirme à ce propos qu’il existe des « vertus négatives qui accompagnent souvent l’audace et la valeur »… La Reine morte, p. 26. Nous reviendrons quant à nous sur la perception faussée qu’a Ferrante du Bien et du Mal.
31 le « quod est » latin cher à Montherlant.
32 in Faure-Biguet J. N. : Les enfances de Montherlant, p.154, cité par Blanc André, Montherlant, un pessimisme heureux, p.86.
33 Fongaro Antoine : Introduction au Maître de Santiago, Signorelli, Rome, 1963, p.34., cité par Banchini Ferdinando, Le théatre de Montherlant, Roma : Fratelli Palombi éd., 1971, p.164.
34 La notion de solipsisme suppose l'absence totale de communication ; or dans La Reine morte, il s'agit moins en fait d'une communication inexistante que d'une communication inefficace :nous le verrons, elle existe, mais se voue à l'échec. Notons que celui-ci se retrouve dans Le Cardinal d’Espagne, où la reine Jeanne proclame : « Il n’y a que moi qui ne sois pas un songe pour moi. ».
35 HERSCH Jeanne, L'étonnement philosophique, éd. Gallimard, 1981, pp. 375-6.
36Dans le sous-titre de La volonté de puissance : Un renversement de toutes les valeurs.
37 HERSCH Jeanne, op. cit., p. 383.
38 Il nous semble que c’est là ce que reconnaît l’auteur, sans toutefois préciser sa pensée : « Ferrante, si différent de ce qu’il veut être. ». Note de 1948 sur Fils de Personne, Plé. Thé., p. 371.
39 Stéphan montre bien que si « cette variété d’images peut paraître tout d’abord déroutante », chacune d’elles apporte « une nuance supplémentaire ». p. 583.
40 Notons la distinction qu'opère Lancrey-Javal entre les "tirades-portraits" de Ferrante, "saturées de jugements de valeur", et les "tirades-condamnation" qui "sont intéressantes dans la mesure où elles constituent un portrait double : portrait sévère de l'interlocuteur de Ferrante, mais aussi implicitement auto-portrait de Ferrante et de son intransigeance"...Lancrey-Javal, op. cit., p.198.
41 op. cit., p. 815.
42 C’est pourtant cette faille que Lancrey-Javal considère comme la plus frappante, parce que la plus évidente : « Personnage puissant, Ferrante est en même temps un personnage mouvant. […] Cette tension qui constitue le personnage de Ferrante est lisible dans sa désignation en tête de distribution : « Ferrante, roi de Portugal, 70 ans. ». Cette mention associe donc aussitôt l’autorité du monarque sur un pays, et son âge avancé qui est sa fragilité dans la pièce ». op. cit., p. 219. Nous reviendrons à la fois sur cette faiblesse physiologique et sur celle qui en découle plus indirectement.
43 Ainsi Saint-Robert parle sans difficulté de « la grandeur du faible » dans l’œuvre de Montherlant, dans Le Point du 24-09-1973... Pour Stéphan, il y a également mélange des notions : « contraste de la qualité et de la mesquinerie, de la grandeur et de la faiblesse, et surtout immixtion de la faiblesse dans la grandeur ». Op . cit., p. 741.
44 Blanc rapporte un jeu de mots de Montherlant « sur les armes qu’il aimait porter écartelées, figurant deux tours opposées avec comme devise : « tour à tour » ». Montherlant, un pessimisme heureux, p. 21.
45 Mohrt Michel : Montherlant, homme libre, Gallimard, Paris, 1943, p.252.
46 « L'inconsistance de Ferrante est une des données de La Reine morte. [_] Son état de fluence est tel qu'on le voit, au cours de la même phrase ou presque, varier de sentiment. " Montherlant, En relisant La Reine morte, p. 170.
47 A. 2, sc. 5, p. 96.
48 Montherlant, Comment fut écrite La Reine morte, p. 151.
49 Montherlant,dans En relisant La Reine morte, considère que sa pièce est « construite à la façon d'une fleur », opposant les deux premiers actes, « dépouillés », au dernier.[p.174.]
50 Lancrey-Javal, op.cit., p.213.
51 En relisant..., pp.170-1.
52 Lancrey-Javal, op.cit., p.213
53 Blanc André, La Reine morte, profil d'une oeuvre n° 3, Paris, Hatier, 1970, p.45.
54 Perruchot, op.cit., p.130.
55 Robichez Jacques, Le théatre de Montherlant, Paris, Sedes, 1973, p.76.
56 En relisant La Reine morte, pp.170-4
57 Perruchot Henri, Montherlant, Paris, Gallimard, 1959, p.100.
58 Comment fut écrite La Reine morte, p.152.
59 La création de La Reine morte, p.165.
60 Plé-thé., p.280.
61 En relisant..., p.174. Cette phrase est à rapprocher d’une affirmation de l’auteur, dans L’éventail de feu : « On sera héros en feignant de croire, sans croire. », cité par Blanc, Montherlant, un pessimisme heureux, p. 130. Ferrante est-il héros à double titre ? C’est ce que pense Banchini : « On peut bien appeler héroïques ces [personnages] qui savent que les tâches qu’ils se sont assignées sont inutiles, mais qui continuent à lutter. »…, op. cit., p. 255.
62 Lancrey-Javal, op.cit., p.106.
63 par contraste avec la pièce "en veston" Fils de personne, "poignard au manche nu". Notes de théatre, Plé-thé., p.1378.
64 « Ferrante attend sa mort, et a toujours eu peur. Iñès vit sous la menace de la mort. Pedro est mis en prison. Exécutions, guerres nationales, guerre civile, et jusqu'à la famine... » Montherlant, Notes de théatre, Plé-thé., p.1378.
65 Pedro ajoute peu après des considérations sur son courage, mais nous pouvons penser qu'il est moins question de bravoure que d'inconséquence... : « Iñès est menacée parce que je n'ai pas eu peur. ».
66 « Quelque chose » est en italiques dans le texte.
67 A. 2, sc. 1, p. 67.
68« Et que se passerait-il si nous renversions l'écritoire?
- Voulez-vous faire attention !
- Est-ce que nous serions pendus ? [Avec une mimique bouffonne] Oh ! On va être pendus ! Couic ! Couic ! " [A. 2, sc. 2, pp. 74-5]. N'ont-ils pas conscience de la dangerosité du Roi, ou bravent-ils en toute conscience le danger potentiel ?
69 A. 1, sc. 4, p. 35.
70 p. 36.
71 p. 79.
72 p. 59.
73 p. 92.
74 Notes de 1948 sur Fils de personne, Plé-thé., p.281.
75 Banchini note justement que dans le théatre de Montherlant, "c'est la vie qui, elle aussi, est cruelle" et que "cette cruauté apparaît souvent, plus que dans un acte ou dans un mot précis, dans le déroulement de l'action, dans les situations où sont plongés les personnages.", op.cit., p.158.
76 Il nous semble que c’est l’idée que résume Batchelor en ces termes : « D’un côté, le mariage d’Iñès et de Pedro : donnée extérieure, fait accompli. De l’autre, Ferrante assujetti à sa propre nécessité interne. », op. cit., p. 199.
77 C'est ce qui fait parler Mohrt de la pièce comme d'un "drame de la fatalité du péché" : "Ferrante, proche de la fin, se confesse à Iñès avec une sorte de délectation morose. Tous ces personnages ont un sens aigu du péché[...]. Tout ce qu'il y a de diabolique [en eux] vient de leur attirance fatale pour le péché." op.cit., pp.232-134. Lier la fatalité et le meurtre d'un point de vue chrétien est peut-être réducteur ; nous aborderons le problème posé par la foi de Ferrante, mais il ne nous semble pas qu'il y ait besoin d'elle et d'elle seule pour parler d'attirance vers le Mal ( d'autrui ou de soi ), comme pour Costals que l'analyse de Mohrt semble évoquer en arrière-plan.
78 C’est ce que pense par exemple Stéphan, qui affirme : « Si, d’une part, on accorde quelque portée au titre La Reine morte, c’est en effet Iñès qui apparaît comme la protagoniste accablée par son rival. Mais, de l’autre, il est clair que Ferrante ne triomphe qu’en apparence, et c’est sous l’effet de la séduction d’Iñès qu’il est terrassé un instant plus tard. Il fait périr la jeune femme, mais il meurt de l’avoir voulu. », op. cit., p. 157.
79 Comment fut écrite La Reine morte., p.153.
80 A.1,sc.3,p.27 et A.3,sc.6,p.127.
81 Lancrey-Javal, op.cit., p.261.
82 Simon, op.cit., p.108.
83 Banchini, op. cit., p. 166.
84 En relisant La Reine morte., p.172.
85 Lancrey-Javal, op.cit., p.227.
86 Simon affirme avec raison que ce texte datant de janvier 1942 (et La Reine morte de mai), Khosrau est "une première esquisse du personnage du roi Ferrante [...] dont Montherlant commençait les préparatifs à ce moment-là." op.cit., p.25.
87 A.2,sc.5,p.92.
88 « Par dessus tout, chacun de ces personnages [dont Ferrante] est habité par la vertu dramatique qui naît d’un contraste fort : conviction héroïque et plus hautes aspirations lui confèrent une ampleur hors mesure, en même temps il demeure miné par les faiblesses humaines. ». Batchelor, op. cit., p. 314.
89 voir Couprie Alain : Le théâtre, coll. 128., Nathan, 1995.
90 A. 2, sc. 2, p. 73.
91 Montherlant, En relisant La Reine morte, p.174.
92 Fongaro Antoine, Introduction au théâtre de Montherlant, Signorelli, Rome, 1963., p.24. Cité par Banchini, op. cit., p.137.
93 Titre de la « comédie en un acte » qui fut écrite après Fils de personne, et dont Montherlant explique qu'elle « marque l'incertitude qu'il est juste que nous ayons touchant la nature même de l'héroïsme »... Plé-thé., p.313.
94 p.109.
95 Lancrey-Javal, op.cit., pp.220-1.
96 En relisant La Reine morte, p.174.
97 Banchini résume cette idée : « C'est une souffrance qui naît de l'ambiguïté, donc de la complexité de ces héros. Egalement, leur singularité, la solitude qui forme autour d'eux un cercle infranchissable, l'incompréhension entre eux et les êtres auprès desquels ils vivent : tout cela est une autre occasion de douleur. » Pour lui, cette douleur liée à l'« inconsistance » du personnage est une « fatalité intérieure[qui] accroît le sentiment tragique. » op. cit., pp. 194-221.
98 Banchini, op. cit., p. 94. Notons que c’est là que Batchelor voit le pathétique : « Les malentendus, et l’écart considérable entre la pensée et l’acte, joints à l’effort d’élucidation, sont essentiellement pathétiques. », op. cit., p. 301. Nous préférons l’avis de Banchini.
99 Mounier Emmanuel, Introduction aux existentialismes, Paris, Gallimard, 1962., p. 37.
100 Simon, op. cit., p. 113.
101 « Ce qui frappe le plus chez les personnages principaux de Montherlant, c’est que tous aimeraient être selon un modèle. […] Ils veulent saisir et fixer dans leur être cette réalité unique qui sera leur âme. […] Leurs actes se comprennent alors comme des tentatives d’une synthèse totale ou d’une communion enfin claire. », Batchelor, op. cit., p. 314. Nous allons tenter de vérifier cela chez Ferrante.
102 Il nous semble que Debrie-Panel analyse clairement l'enjeu de la pièce en affirmant des héros de Montherlant qu'« ils n'arrivent pas à être ce qu'ils veulent être, ils n'arrivent pas à coïncider avec eux-mêmes, leurs actes les ramènent toujours inexorablement à l'absurde ». Debrie-Panel Nicole, Montherlant. L'art et l'amour, E. Vitte, Lyon, 1960, p. 182. cité par Banchini, op. cit., p. 94.
103 A. 2, sc. 2, p. 67.
104 p. 29.
105 C’est pourtant celle que retient finalement Batchelor dans sa conclusion : « On peut dire qu’en dernière analyse ces personnages définissent leur propre réalité dans la matérialisation des actes. Montherlant peut essayer de nous convaincre que ce n’est pas la raison d’État qui porte Ferrante à l’assassinat d’Iñès. […] Il croit, en dépit de lui-même, dans son acte et dans la raison d’être de cet acte. », op. cit., p. 301.
106 C'est cette curiosité qui le pousse à la double exclamation à la scène suivante : « Il y a un secret ! Il y a un secret ! " [A. 2, sc. 2, p. 70].
107 A. 2, sc. 1, p61.
108 A. 2, sc. 5, p. 92.
109 A. 3, sc. 6, p. 136.
110 A. 3, sc. 7, p. 143.
111 "De toutes les raisons qu'on peut donner à sa décision de tuer Iñès, la plus forte réside, probablement, dans [...] sa haine de la vie." Perruchot, op.cit., p.130.
112 A. 2, sc. 2, pp. 74-5.
113 Pour Blanc, « On retrouve la version corrigée du meurtre du père, sous la forme du sacrifice d’Abraham, avec des variantes [chez Montherlant]. Dans La Reine morte, à travers Iñès, Ferrante frappe Pedro. », La Reine morte, pp. 28-9. Il nous semble que cela est très exagéré.
114 Pour Lancrey-Javal, le personnage d'Iñès est également d'un intérêt "plus dramatique que strictement psychologique"., op.cit., p.132.
115 A. 2, sc. 4, p. 88.
116 Selon Debrie-Panel, la femme a « la possibilité de trouver dans l'amour la circonstance enveloppant d'une indissoluble unité son être et ses actes. Elle peut paraître ce qu'elle est. » op.cit., p.169, cité par Banchini, op.cit., p.104.
117 Notons que dans la bouche de Pedro, l'image de l'arbre n'est pas signe de verticalité ni de dureté masculIñès comme pour son père, bien au contraire il symbolise féminité et maternité.
118 Nous pouvons remarquer que cette notion d'amour-faiblesse,d'abnégation et de sacrifice se retrouve chez des personnages féminins tels Isotta dans Malatesta – « Que cette peine soit la dernière qui naisse de moi seule : que bientôt je n'aie plus de peines que les vôtres... » ( A quoi l'on pourrait faire répondre Malatesta : « C'est moi-même qui serai l'instrument de mon destin [...]. Enfin moi-même avec moi-même et avec toute la sécurité qui sort de moi pour moi ! » - ou Mariana dans Le Maître de Santiago – « Je veux entrer dans le mariage, et refermer la porte comme on fait quand on est entré dans un oratoire, et ne plus regarder derrière moi, jamais. [...] Perdue en lui seul pour toujours. »...
119 A. 3, sc. 6, p. 137.
120 Alors que Blanc affirme que c’est Pedro que Ferrante frappe à travers la jeune femme, Lancrey-Javal imagine que ce puisse être lui-même : « Cette « reine morte », ce peut être aussi, à l’insu de tous, Ferrante lui-même. », op. cit., p. 30. Certes Ferrante pourrait vouloir condamner à travers l’un ou l’autre sa propre faiblesse (il se compare à l’élément féminin de la « vieille poule »), mais pas, à notre sens, une médiocrité : sur ce plan, lui et Iñès sont trop différents, sinon opposés.
121 Mohrt, op.cit., pp.223-4.
122 Son intervention constitue en effet une "question curieuse de relance", comme l'explique Lancrey-Javal, op.cit., p.194.
123 Nous noterons ici que ces arguments, s'ils sont ceux qui touchent le plus efficacement Ferrante, ne sont pas les ultimes puisqu'ils feront ensuite valoir la simplicité de cet acte, à la fois dans son idée, dans sa réalisation et dans ses conséquences :
« Un geste vous fait sortir de cet abaissement. [...] Un seul acte, Seigneur, vous délivrera de tous vos soupirs. [...] il suffirait de supprimer pour que tout se dénouât [...] On tue, et le ciel s'éclaircit. [...] un meurtre est chose relativement si facile et sans danger. " [pp. 67-8]
124 Il nous semble donc qu'expliquer l'acte de Ferrante par le culte du moi, comme Blanc : "Aucun personnage ne renonce à sa qualité de sujet.[...] Ferrante, auteur d'un meurtre uniquement pour s'affirmer qu'il ose le commettre", est une erreur : il ne s'agit pas, à notre sens, de prouver son pouvoir en soi, librement, mais son pouvoir sur la vie, précisément pour se sentir vivant et non aliéné.
125 Bordonove, op.cit., p.71. Cette phrase nous paraît cruciale : il s'agit en fait moins d'une puissance qui se montre que d'une faiblesse qui se cache.
126 Mohrt, op.cit., p.77.
127 Son essai critique date de 1943.
128 Mohrt, ibid., p.263.
129 A.2,sc.4,p.90.
130 Banchini, op.cit., p.42.
131 ibid., p.95.
132 En relisant..., pp.172-3.
133 Ferrante et Alvaro, Plé-thé., p.544.
134 En relisant..., p.171.
135 L'engagement est ici synonyme exact de responsabilité puisque dans la pièce la parole tient lieu d'acte :la mise à mort d'Iñès, tout comme, d'ailleurs, la mise en prison de Pedro, se produisent hors-scène, nous n'assistons jamais qu'aux ordres donnés par Ferrante ; or ces ordres étant mis à distance temporelle et spatiale, apparaissent comme détachés de leur exécution - à défaut de leur « auteur " ( ?).
136 Notons avec Stéphan que ce thème du regard dépasse le personnage du Roi : « Vers les héros du drame convergent les regards d’une masse anonyme qui les épie et les juge : regards des hommes tournés vers Ferrante, des soldats assistant à l’étreinte passionnée d’Iñès et de Pedro, des capitaines injustement privés de leur solde, des courtisants sournois. » ; op. cit., p. 287.
137 Il nous semble que Blanc arrive mal à réfuter ce point de vue, quand il affirme : « À chaque instant l’homme est placé devant un choix, libre comme celui du héros sartrien. Le personnage de Sartre, il est vrai, s’assume dans ce choix ; celui de Montherlant, non, en particulier dans La Reine morte. Choix effrayant donc, non parce qu’il engage, comme chez nos existentialistes, mais parce qu’il n’engage pas. »… La Reine morte, p. 25.
138 Ferrante parle des trous dans un traité, « ... par lesquels [il] compte [s']évader de ses obligations. », p. 58.
139 Mounier, op.cit., pp.114-5.
140 Ce paradoxe, à une autre échelle il est vrai, est explicitement dénoncé par Mounier : « Une civilisation commence à prêcher l'existence et l'action [plus encore] lorsqu'elle ne se sent plus sûrement exister et quand ses puissances d'action vacillent. On comprend que l'existentialisme affirme d'un côté un besoin d'accomplissement total de l'acte humain, et, parce qu'il se greffe comme réaction ontologique sur une aliénation partielle, qu'il trahisse parfois ses propres exigences [...]. Le recul existentialiste devant l'action n'exprime plus toujours une exigence de l'être subjectif[...], il trahit aussi une anémie que la réaction existentialiste ( d'où son ambivalence ) recouvre et combat en même temps. » Mounier, op. cit., p. 136.
141 Mounier, op.cit., pp.74-5.
142 En relisant..., p.174.
143 « Le fait subsiste […] qu’il y a des moments, dans la psychologie de Ferrante, ou quoi qu’il en ait il s’engage. À de tels moments, il ne peut plus « agir comme si ». […] Ferrante, pourtant, n’est pas le vrai existentialiste. Il n’est pas question pour lui de « faire et en ce faisant se faire. ». », Batchelor, op. cit., pp. 199-200. À notre sens, Ferrante perçoit bien l’engagement existentialiste des actes ; mais il répugne à agir justement pour ne pas « se faire »… et agit finalement absurdement, pour la même raison.
144 Sartre. Ph. Hodard, éd. universitaires, J-P. Delarge, 1979.
145 Notons que Mounier, qui parle du sartrisme comme un « inexistentialisme » et s'y oppose, émet l'hypothèse d'un lien entre cette pensée et la pathologie : « Il semble que la plupart des existentialistes, grands nerveux ouverts par leur émotivité à la perception intense de l'être, souffrent d'une susceptibilité particulière à l'empiètement de l'être ressenti comme une altérité, sur le « je » récepteur. [...] Chez nul autre, ce sentiment n'est aussi évident que chez Sartre.[...] comme dans l'univers du paranoïaque, tout est menace hors de moi, dirigée vers moi. Lorsque le sentiment d'aliénation développe une conscience pareillement irritable, il est à se demander si l'analyse ontologique opère seule, ou si ne viennent pas s'y mêler ces sentiments d'emprise qui sont, chez les êtres à sensibilité vive, un des aspects de l'égocentrisme. » op. cit., pp. 57-8.
146 Pour Blanc, « Les héros de Montherlant sont tous déséquilibrés, en porte-à-faux, donc souvent raidis dans une position difficile. Parler de déséquilibre n’a rien de péjoratif. On rechercherait moins l’alternance, on affirmerait moins la théorie de l’équivalence si l’on pouvait trouver un équilibre véritable. On peut voir là une espèce d’existentialisme autant qu’un dilettantisme. » La Reine morte, p. 48. Il s’agit pour nous de « voir là » une faiblesse pathologique, sans que cette hypothèse soit non plus péjorative.
147 Notons que Pedro emploie le mot pour qualifier l'attitude strictement opposée à celle d'épouser l'Infante : « J'ai quarante années peut-être à vivre. Je ne serai pas fou. Je ne les rendrai pas, de mon plein gré, malheureuses, alors qu'elles peuvent ne pas l'être. » [A. 1, sc. 3, p. 31.]
148 Comment fut écrite La Reine morte, p. 152.
149 En relisant La Reine morte, p. 169.
150 En relisant...,pp. 169-70.
151 En relisant...,pp. 172-3. La neurasthénie est une faiblesse des nerfs ; nous savons l'importance que Montherlant accorde aux réactions nerveuses qui lui sont survenues dans son existence, et qui ont fait un trait caractéristique de certains de ses personnages ( ainsi il dit de Malatesta qu'il a « des nerfs de femme », par exemple.)... Mais ne pourrait-on pas parler plutôt de psychasthénie chez Ferrante, d'une faiblesse de l'âme ? Ou d'une faiblesse plus profonde et plus importante, et en ce cas laquelle ? Et pourquoi ?
152 Lancrey-Javal, op. cit., p. 221.
153 Laprade, préface Plé-thé., p.XXXIV.
154 Banchini, op.cit., p.194.
155 Banchini, ibid., p.94.
156 Blanc toutefois dira dans un chapitre sur le rêve : « Il semble qu’il faille d’emblée mettre Ferrante au rang des schizophrènes et des rêveurs […]. Il vit toujours au-dessus de lui-même. […] Il se sent solide tant qu’il vit dans son rêve. […] La mort d’Iñès est ordonnée dans un état second. […] Enfermé dans ce rêve, Ferrante est incapable de sortir de soi. » La Reine morte, p. 51.
157 Impact médecin, p. 4.
158 Impact médecin, pp. 5-6.
159 De la santé mentale à la folie. 1959. , coll. Stock-plus, Paris, Stock, 1979.
160 Laing, op. cit., p. 54.
161 Laing, op. cit., p. 85.
162 Laing, ibid., p. 155.
163 [p. 109].
164 Laing, ibid., p. 97.
165 Laing, ibid., pp. 69-70.
166 « Ce roi est si incohérent et en même temps si entier dans son nihilisme que dans ses actes nous cessons d’être en présence d’une personne. », Batchelor, op. cit., p. 192. Notons qu’il reviendra ensuite sur ce nihilisme, parce que convaincu que Ferrante agit par passion politique.
167 Laing, ibid., p. 59.
168 Pour Lancrey-Javal, ce rêve est révélateur d'un « imaginaire onirique et cauchemardesque de la déréliction. », op. cit., p. 194.
169 A. 2, sc. 4, p. 90.
170 Laing, op. cit., p. 101.
171 Laing, op. cit., p. 98.
172 A. 1, sc. 5, p. 43.
173 A. 2, sc. 3, p. 75.
174 p.110.
175 Laing, ibid., pp. 99-100.
176 En relisant La Reine morte, p. 174.
177 Laing, ibid., p. 198.
178 Laing, ibid., pp. 102-103.
179 A. 2, sc. 5, p. 104.
180 Laing, ibid., p. 156.
181 Impact médecin, p.14.
182 Laing, ibid., p. 128.
183 Devereux, Essais d'ethnopsychiatrie, p.251.
184 pp. 170-1.
185 Devereux, ibid., pp 242-243.
186 Lancrey-Javal, op.cit., p.209.
187 Laing, op. cit., p. 149. Or Lancrey-Javal d'affirmer : « Le personnage se laisse d'autant moins fixer qu'il ne semble pas avoir eu de passé et qu'il n'a pas d'avenir dans la pièce. [...] Sans mémoire parce que sans avenir, la vie du personnage ne se construit pas dans la durée, mais dans les instants successifs d'une agonie »... op. cit., pp. 224-5.
188 « Avec les réalités on peut toujours s'arranger. » : cette phrase est la dernière d'une tirade de Costals extraite de Pitié pour les femmes, reprise en épigraphe de Celles qu'on prend dans ses bras.
189 Banchini, op. cit., pp. 181-2.
190 Laing, La politique de l’expérience, p. 80.
191 Laing, ibid., pp. 205-207.
192 Lancrey-Javal, op. cit., p. 262.
193 Lancrey-Javal, op. cit., p. 228 et p. 266.
194 Mohrt, op. cit., p. 217.
195 op. cit., p. 272.
196 Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 1975.
197 Laing, ibid., p. 140.
198 Laing, ibid., p.112.
199 Laing, ibid., p. 100.
200 Banchini, op. cit., p. 193.
201 Impact Médecin, p. 16.
202 Lancrey-Javal, op.cit., p.210 puis p.271. A notre sens, Ferrante ne semble parler à personne que parce qu'il se parle plus à lui qu'à Iñès. Il ne nous semble pas que si Iñès se parle également, ce soit la marque de son échec : elle vit dans un monde stable, l'univers de l'amour, et y reste par choix : son échec ici n'est que son incapacité à atteindre le roi.
203 Lancrey-Javal va plus loin dans cette idée : « L’affrontement dramatique se déroule dans le clair-obscur de [sa] conscience », et parle d’un « théâtre intérieur » de Montherlant. Op. cit., p. 83.
204 Laing, op. cit., pp. 193-194.
205 Laing, ibid., p. 120.
206 Laing, ibid., p. 108.
207 Bellemin-Noël Jean, Psychanalyse et littérature, Que sais-je ?, P. U. F. , 1978. p. 7.
208 Sacks Oliver, Un anthropologue sur Mars. Sept histoires paradoxales, coll. la couleur des idées, Seuil, 1996. , p. 223.
209 A.3,sc.6,p.129.
210 Lancrey-Javal, op. cit., p.222.
211 Notons que pour Kierkegaard le dépassement religieux peut si peu se communiquer qu'il justifie le masque comme moyen d'authenticité, ce que Mounier appelle une « pudeur semi-sacrée semi-pathologique », Mounier Emmanuel, op. cit., p 90.
212 A. 3, sc. 8, p. 145.
213 p. 148.
214 A. 3, sc. 5, p. 120.
215 A. 2, sc. 2, p. 72.
216 A. 1, sc. 3, p. 25.
217 « une de ces mauvaises flammes qu'on voit se promener sur les étangs pourris » [A. 2, sc. 2, p. 70.]
218 A. 3, sc. 6, p. 131.
219 Il y fait allusion à trois autres reprises, devant Iñès :
« Et ce serait péché de vouloir diminuer l'image que vous vous faites du Prince [...] Encore, vous me diriez : pour sortir du péché. » [A. 1, sc. 5, pp. 45-8.]
« [...] il y a une maladie à guérir, c'est la maladie de leur âme immortelle qui sans cesse a faim du péché. » [A. 3, sc. 6, p. 129.]
220 Lancrey-Javal l'accuse ici de « retourner de manière quasi-blasphématoire et ironique les paroles célèbres du Christ », op. cit., p. 150. Il ne nous semble pas que Ferrante soit ici ironique.
221Montherlant, La marée du soir, p.60.
222Banchini, lui, va jusqu'à avancer que « c'est la Foi [de Ferrante] qui donne à ses contradictions tout leur poids tragique. ", op.cit., p.63.; il nous semble que cela est excessif, et qu'il faut voir la question de la Foi du personnage comme un paramètre supplémentaire parmi les autres.
223Mgr Péréfixe dira des religieuses : « Elles sont pures comme des anges, et orgueilleuses comme des démons. », Port-Royal, Plé-thé., p. 1054.
224 Loin de parler de « drame de la fatalité du péché », Blanc, alors même qu’il voit dans la lucidité du personnage son trait dominant, explique également que son sens du Bien et du Mal est faussé : « Regrette-t-il ses fautes ? Certainement, mais d’une façon abstraite, car […] il n’a pas le sens chrétien véritable du péché. Il ne sait pas très bien ce qui est faute et ce qui ne l’est pas. Comment se jugerait-il ? Sa seule certitude est d’être « bien meilleur et bien pire ». », La Reine morte, p. 55.
225 Plé-thé., p.280.
226Plé-thé., p.1380.
227 [A.3,sc.7,p.143.]
228 Rappelons ici la formule d'Egas Coelho pour exprimer la mort d'Iñès : « Qu'elle passe promptement de la justice du Roi à la justice de Dieu. » [A. 2, sc. 1, p. 60.] : lui aussi distingue le plan humain et le plan divin, serait-ce hypocritement.
229 [A .3, sc. 6, p. 146.]
230 Lancrey-Javal parle lui de « construction judiciaire de la pièce », op. cit., p. 256.
231 Lancrey-Javal, op. cit., p. 150.
232 « Le secret des personnages est aussi celui de leur « valeur » réelle. », Lancrey-Javal, ibid., p. 80. Nous reviendrons sur ce terme de « secret ».
233 Titres de deux ouvrages de Simon Pierre-Henri, éd. du Seuil, 1950.
234 Lancrey-Javal, op. cit., p. 209.
235 Banchini, op. cit., p. 59.
236 Comment fut écrite La Reine morte, p. 154.
237 Il nous semble que l'importance du jugement existe aux yeux de l'auteur lui-même, qui fait dire de Cisneros à la fin du Cardinal d'Espagne : « Qu'il ne croie pas que nous ayons fini de le juger.- Un jour on ne le jugera même plus. ».
238 En relisant..., p. 175.
239 [p. 174.].
240 Carnets Inédits, 1966, cité par Sipriot Pierre, in Montherlant, Seuil, 1975, avant-propos.
241 Dans En relisant..., l'auteur explique que « tout autour de la ligne d'action dramatique (par où Ferrante en viendra-t-il à tuer Iñès) s'ouvrent des abîmes », mais aussi que « la pièce est construite à la façon d'une fleur », et que le troisième acte « s'épanouit en une ombelle abondante ». p. 174.
242 Saint-Robert s’interroge longuement à ce propos dans son essai critique, et dira : « Montherlant n’a pas la foi, puisqu’il ne veut pas l’avoir. », ou « Montherlant croit à la religion, s’il ne croit pas en Dieu. », Montherlant le séparé, pp. 55 et 91.
243 Montherlant, un pessimisme heureux, chapitre « Au dessus du moi : présence ou absence de Dieu. ».
244 Banchini Ferdinando, op. cit., p. 260. Ni avec Blanc qu’« en ordonnant le meurtre d’Iñès Ferrante devient « bien pire », et que « de tels dépassements sont les signes de la qualité. », La Reine morte, p. 27.
245 Batchelor Jean, op. cit., p. 21.
246 op. cit., p. 40.
247 L'assomption de Khosrau est symbolisée par la retraite dans une montagne, la montagne de l’Unité. Aussi celle de Ferrante est-elle une ascension figurée : « Je n'ai pas à me retirer avant de mourir dans les forêts ou sur la montagne, car je suis pour moi-même la forêt et la montagne. » [A. 3, sc. 1, p. 110.].
248 En relisant..., p. 170.
249 p. 175.
250 Mounier Emmanuel, op. cit., pp. 30-1.
251 Lancrey-Javal, op. cit., p. 215.
252 Lancrey-Javal, op.cit., p.228.
253 Ferrante et Alvaro, Plé-th., p.544.
254 Nous pouvons tenter là un parallèle avec ce jugement d'Andrée sur Costals, dans Les lépreuses : « C'est de la sainteté que vous êtes le plus proche, mais d'une espèce de sainteté à rebours, d'une sainteté démoniaque. ».
255 [p.142.].
256 Un plan « divin », quel qu’il soit, apparenté à Dieu ou au Rien, comme dans Le Cardinal d’Espagne, selon les conceptions de Cisneros ou de la reine Jeanne…
257 Mohrt Michel, op. cit., p. 220. La même verticalité est implicite chez Blanc : « Disons qu’il vit écartelé entre un appel authentique vers la sainteté et la tentation du mal presque absolu. », La Reine morte, p. 55.
258 « Ce qui aurait pu être considéré comme la faiblesse de ce personnage, son incohérence, est apparu comme son intensité, sa complexité et sa force. » Lancrey-Javal, op. cit., p. 214.
259 Stéphan voit l’abstention de Montherlant dans le silence final, et donne raison à Robichez qui « appelle ce procédé d’art « l’esthétique de l’inachevé », procédé qui « permet tous les prolongements et tous les rêves », et montre […] que Montherlant ne conclut pas vraiment : une zone d’ombre subsiste où chacun s’enfonce avec son mystère. », Robichez, op. cit., p. 106, cité par Stéphan, op. cit., p. 196.
260 La différence est que pour lui, cette découverte est « la première que l'on fait dans le théatre de Montherlant », alors qu'à notre sens c'est une donnée ultime parce qu'indépassable cette fois... Banchini Ferdinando, op. cit., p. 104.
261 Lancrey-Javal, op. cit., p. 228.
262 Batchelor Jean, op. cit., p. 203.
263 Blanc André, La Reine morte, pp. 49-50.
264 En relisant..., p.171.
265 Lancrey-Javal cite les traits communs à Ferrante et d'autres personnages puis conclut : « On évitera ici le poncif « tout Montherlant est là », mais il est sûr qu'une bonne partie de la production montherlantienne se retrouve dans ce personnage protéiforme, écho des préoccupations de son auteur et comme une première condensation de bien des personnages passés et de bien des personnages à venir. », op. cit., p. 218.
266 Ainsi Stéphan, après avoir relevé que « sans doute Montherlant a pétri [Ferrante] de lui-même, et plusieurs des Textes sous une occupation permettent d'évidents parallélismes entre l'auteur et son personnage », opte pourtant pour une désolidarisation, un « désaveu » de celui-ci parce qu'« on sait aussi combien son œuvre tend souvent à dénoncer la lâcheté des hommes devant la vie immédiate [...]. La Reine morte apparaît ainsi comme une démystification des grandes phrases et des beaux principes, dont la floraison des images compte parmi les indices les plus tangibles. », op. cit., p. 577. Il ne nous semble pas que cela soit si évident : l'auteur veut-il cette démystification ? Et en est-il satisfait ?
267 cité par Perruchot, op. cit., p. 62.
268 « La réclamation de la spiritualité et le refus de Dieu, pour antinomiques qu'ils soient au regard d'une philosophie chrétienne, n'en font pas moins la réalité de l'incroyant, son expérience vécue. Ils le font entrer dans le monde de la tragédie où l'on peut dire oui à la charité sans dire oui à l'espérance, et où l'absence de Dieu implique dès la terre la transcendance des faits humains. » Secrétain Roger, cité par Batchelor, op. cit., p. 307.
269 Batchelor, op. cit., p. 291.
270 Beer, Jean de : Montherlant ou l'homme encombré de Dieu, Paris, Flammarion, 1963., pp. .22-3., cité p.75.
271 Beer, op. cit., p.12., cité p.44.
272 Mohrt, op. cit., p. 252.
273 Montherlant, Notes de 1948, Plé-thé., p. 376.
274 Banchini, op. cit., p. 195. et p. 256.
275 Mounier dénonce le « dolorisme ontologique » d'Heidegger et de Sartre en ces termes : « C'est un passage au système que marque le saut d'une expérience déchirée et obscure à l'impérialisme de l'absurde et du néant.[...] On parle beaucoup d'engagement. Mais où cet engagement nous offre-t-il des prises ? S'engager dans le rien, être fidèle au néant, embrasser joyeusement la mort ou l'absurdité est peut-être un projet excitant pour l'esprit. Il est à craindre qu'il n'excite que des esprits déshabitués des nourritures premières et qu'il nourrisse des délires plutôt que des pensées. Quand l'homme a fait le vide autour de lui et jusqu'au creux de son cœur, quand, même alors, il garde le goût de la grandeur au lieu de se livrer à des petits commerces devenus de ce moment très légitimes, il échappe difficilement à une sorte de narcissisme spirituel. », op. cit., pp. 70-1.
276 Mignon Paul-Louis, Le théâtre contemporain, cité par Blanc, La Reine morte, p.75.
277 Simon, op. cit., pp. 110-13.